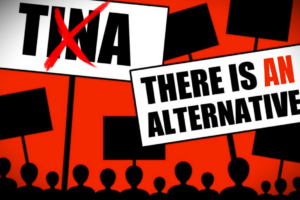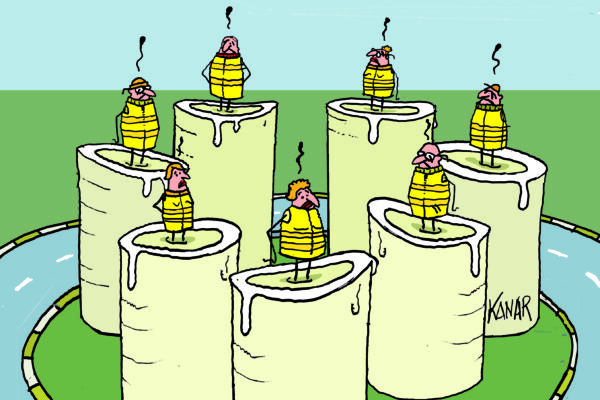Illustration : Jean Tousseul (assis au premier rang à droite avec la pochette blanche et les lunettes) et l’équipe de l’Office de Propagande et de documentation du Syndicat national des Chemins de fer, Postes, Télégraphes, Téléphone, Marine et Aéronautique dans les années 1920. ©John Stévens/Jacques Vandenbroucke
Jean Tousseul est un auteur wallon d’une importance incontestable sur le plan régional. Influencées tant par Léon Tolstoï, Romain Rolland qu’Émile Verhaeren, son œuvre et sa pensée sont d’une actualité brûlante tout en portant la marque d’une époque précise, celle des luttes et des revendications sociales pour la classe ouvrière et des guerres fratricides.
Dans le même temps, il incarne une trajectoire politique et idéologique extrêmement problématique, évoluant d’un pacifisme internationaliste à un régionalisme du sol et de la race, ce qui le rapprochera des thématiques de l’extrême droite rexiste au moment de la Seconde Guerre mondiale.
Originaire d’une territorialité située entre la Hesbaye, le Condroz et la vallée mosane (il évolue entre Landenne, Hannut, Huy et Seilles), il est en effet d’abord un pacifiste convaincu opposé à la Première Guerre mondiale, puis un militant syndicaliste et ouvriériste, avant de se faire l’apôtre de la couleur locale des écrivains du sol régional.
L’historien Jacques Vandenbroucke vient de consacrer une biographie étoffée et documentée à cet autodidacte, né Olivier Degée, qui choisit très tôt le pseudonyme de Jean Tousseul.
1. L’ouvrier pacifiste
Un temps ouvrier carrier à Seilles, Degée-Tousseul se forme comme écrivain au contact de la campagne hesbignonne et condruzienne qu’il affectionne tout particulièrement. L’attention qu’il porte au monde paysan ainsi que sa révolte constante contre les inégalités de classe l’orientent vers une littérature à la fois sociale (prolétarienne même) et pittoresque.
Anticlérical et anarchisant, Jean Tousseul défend l’instruction publique contre les crédits de guerre, l’assistance sociale solidaire pour les ouvriers plutôt que les conflits fratricides, la culture pour le peuple contre l’armement profitant aux industriels. Ces positions, et quelques articles qu’il publie en 1918 dans la presse sous censure allemande, seront qualifiées de « défaitistes ». Cela lui vaudra, après la fin de la Grande Guerre, une incarcération de 4 mois avant d’obtenir en avril 1919 un non-lieu.
2. Le militant syndicaliste
Dès les années 1920, Tousseul s’engage dans l’action syndicale et militante. Il devient alors, par nécessité, journaliste au Peuple de Liège sans toutefois cesser son activité littéraire. À Liège, il s’intéresse à la problématique de la prostitution et des maladies vénériennes, versant dans un paternalisme moralisateur à l’égard des femmes (une attitude très courante à l’époque). La rencontre de la féministe Mathilde Briamont, qui deviendra son amante puis sa seconde femme, le confrontera à ce paradoxe.
Il soutient par ailleurs les grévistes métallurgistes liégeois qui défendent la journée de huit heures, aux côtés d’un certain Julien Lahaut. Il se lie à la revue et au groupe Clarté, organisés autour de la figure du pacifiste Henri Barbusse, dans un milieu de la gauche pacifiste et internationaliste. Il donne des conférences pour la Centrale d’éducation ouvrière avant de s’engager pleinement dans le combat syndical, notamment en devenant rédacteur en chef du Ralliement, organe officiel du Syndicat national des Chemins de fer, PTT et Marine marchande (SNCPTTMA) dont les bureaux sont situés place Fontainas à Bruxelles.
Tousseul y apprécie la lutte révolutionnaire, s’engage activement pour la défense des orphelins de la famine russe. Oscillant entre le socialisme réformiste du Parti ouvrier belge (POB, ancêtre du Parti socialiste) et des positions communisantes, sa lecture des événements de la jeune URSS (assez imprécise) lui vaut les critiques du Drapeau Rouge, le journal du Parti communiste, au début des années 1920. Cela ne l’empêchera pas de publier son recueil de contes La Cellule 158 dans le périodique communiste en 1924. Protégé par le Président général du SNCPTTMA et sénateur liégeois Henri Renier, Tousseul travaille, après sa démission du Ralliement, au service documentation du syndicat.
3. Un écrivain-citoyen
C’est dans ce contexte d’engagement, au début des années 1920, que paraît le texte le plus affirmé et vindicatif de l’écrivain-militant, Aux hommes de bonne volonté (1921), qui anticipe, quelque dix années plus tôt, la célèbre fresque de Jules Romains[1]. D’écrivain-militant, il devient même écrivain-citoyen, se présentant aux élections législatives de novembre 1921 sur les listes du POB. En 1922, il dénonce le danger fasciste en Italie ainsi que les meurtres d’ouvriers et la répression antisyndicale. Pour lui, c’est par le syndicat que l’émancipation du prolétariat passera.
Il quitte en 1927 le Syndicat national pour se distancier de la vie politique et syndicale. Sans renier son œuvre d’intellectuel ouvrier engagé, Jean Tousseul incarne bien les difficultés matérielles de vivre de sa plume tout en restant un travailleur mais aussi un défenseur des luttes sociales.
La première partie de ses Méditations sur la guerre est publiée en 1941 sous censure allemande mais, l’année suivante, la seconde partie est refusée par l’occupant. Très malade, Tousseul quitte la banlieue bruxelloise pour revenir s’installer à Seilles où il décède, âgé de 53 ans, au début de 1944.
4. Un opportuniste et un collaborateur ?
De manière peut-être paradoxale, son œuvre littéraire est publiée successivement dans Le Peuple, Le Drapeau rouge mais aussi, en 1941, dans Le Pays réel, rexiste ! Il est encensé par certains quotidiens catholiques d’extrême droite et est courtisé par la propagande nazie. À la différence d’un Pierre Hubermont, autre auteur prolétarien belge, Tousseul refuse toutefois tout engagement, même symbolique, au sein de diverses organisations collaborationnistes wallonnes.
Néanmoins, il correspond avec l’universitaire nazi Hans Teske, ce qui s’apparente bien à une forme d’engagement idéologique, malgré sa conviction d’être toujours un pacifiste retiré des querelles politiques. Or, le pacifisme a changé de visage. Alors qu’il correspondait à une attitude internationaliste et révolutionnaire durant la Première Guerre mondiale, il devient à la fin des années 1930 une attitude naïve, voire très conciliante et peu critique (surtout lorsqu’elle se couple à une collaboration intellectuelle réelle).
Il est facile de juger rétrospectivement, et au vu de notre connaissance éclairée du passé, un auteur évoluant constamment dans une précarité économique et sociale. Ni ouvrier, ni pleinement intellectuel, Tousseul devra constamment vendre ses papiers pour continuer à vivre décemment. Ceci n’empêche pas une critique de son œuvre mettant en exergue plusieurs éléments conservateurs, réactionnaires, tournés vers un sol et un peuple à préserver, ce qui trouve un écho avec certaines thèses très problématiques de l’extrême droite à la fin des années 1930.
5. Un social-conservateur ?
L’ouvrage de Jacques Vandenbroucke restitue avec détail le destin humain, politique et littéraire paradoxal de cet écrivain wallon dans un siècle tourmenté. S’il ne dresse pas un portrait idyllique, il permet de s’interroger sur l’actualité de sa trajectoire.
À la suite de cette biographie, il conviendrait de creuser la tension à l’œuvre dans l’esthétique naturaliste, pittoresque et régionaliste, entre une idéologie prolétarienne et un conservatisme moral lié à la défense de la terre et de la tradition ancestrale. D’une part, l’auteur fait œuvre de romancier du social, de la misère populaire, en suggérant la nécessité d’un dépassement et d’une émancipation collective. D’autre part, il glorifie un déjà-là rural enfermant personnages, narrateurs et lecteurs dans une vision du monde passéiste et réactionnaire.
L’auteur occupe une place dans la complexité idéologique de son temps, celle des décennies 1920-1940, entre racisme naturalisant, patriotisme du sol, réalisme misérabiliste, glorification des forces populaires et militantisme socialisant, voire communisant.
Les œuvres et archives de Jean Tousseul sont disponibles sur la bibliothèque virtuelle de la mémoire d’Andenne. Par ailleurs, les deux parties de ses Méditations sur la guerre viennent d’être republiées en un seul ouvrage, de même que son Village gris, chez Edern. Et sa biographie a été rédigée par Jacques Vandenbroucke : Olivier Degée dit Jean Tousseul (1890-1944). Le campagnard mélancolique, Ediwall, 2024.
[1] Les hommes de bonne volonté, fresque romanesque en 27 tomes, publiés entre 1932 et 1946.