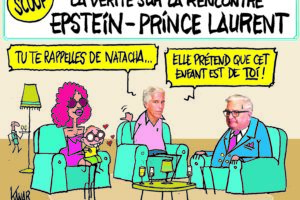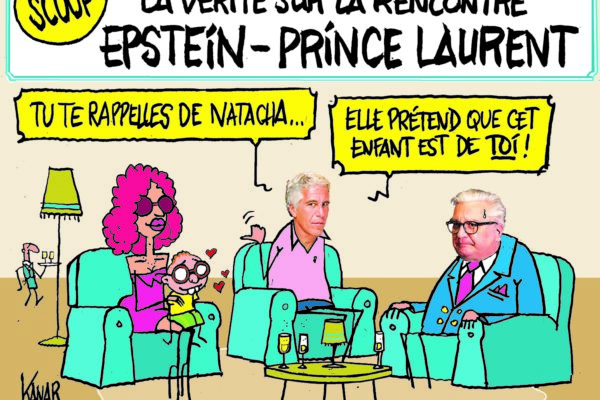Et si la SNCB impliquait davantage ses usagers et usagères ainsi que les travailleurs et travailleuses dans sa gestion quotidienne ? Le transport de personnes par chemin de fer est un service public qui répond à un besoin collectif. Il n’est dès lors pas saugrenu d’imaginer qu’il puisse être géré de manière beaucoup plus inclusive.
Etat des lieux de la démocratie participative
L’essor de la participation citoyenne est souvent identifié comme l’un des remèdes à la crise démocratique[2]. Il faut dire que les expériences démocratiques de participation de la population à la prise de décision se sont multipliées ces dernières décennies un peu partout dans le monde et ont permis de documenter les bénéfices de cette participation : renforcement de la légitimité des décisions et donc de l’adhésion populaire à celles-ci, valorisation de la voix des citoyen.ne.s, accroissement de l’implication politique, renforcement de la cohésion sociale, enrichissement des projets qui répondent mieux aux attentes citoyennes, etc.
En Belgique, la participation citoyenne fait l’objet de nombreuses démarches visant à intégrer davantage l’avis du citoyen dans un système représentatif afin d’en combler les failles (consultations populaires communales ou régionales, commissions délibératives mixtes à Bruxelles, Assemblée citoyenne permanente en Communauté germanophone, G1000, conseils consultatifs,…). Faute d’une réflexion intégrée, les différents mécanismes de participation citoyenne sont mis en œuvre de manière éparpillée, par des niveaux de pouvoir qui ne dialoguent pas entre eux et peinent à produire un résultat cohérent et donc satisfaisant pour les citoyen.ne.s[3]. Beaucoup d’études ont également porté sur la « démocratisation » de l’entreprise privée[4].
À ce jour, le grand oublié des études sur la démocratie est le service public. Les institutions de service public, créées par l’Etat sur la base du droit administratif, ne sont pas conçues de manière démocratique et égalitaire. Au contraire, les bénéficiaires du service public (« les administrés ») sont dans un rapport de sujétion à l’administration. Les institutions de service public reflètent la volonté du simple pouvoir exécutif et le contrôle du pouvoir législatif (à travers les parlementaires) est accessoire et s’exerce à travers le mythe de l’intérêt général[5]. Or, les services publics ne sont pas des lieux « neutres » et désintéressés. Ce sont des lieux politiques au sein desquels s’exercent des rapports de force.
Une manière de rééquilibrer le rapport de force est d’introduire de la participation citoyenne au sein des services publics. Entendue de manière large, elle peut aller de l’élaboration des décisions jusqu’à des formes de participation active de contrôle et de sanction.
Les critères du service public participatif
Chaque besoin collectif fondant un service public est propre, de sorte qu’il y a nécessairement autant de manières de repenser le(s) service(s) public(s) qu’il y a de besoins collectifs à satisfaire. Il est toutefois possible d’identifier des grands principes clés permettant une gouvernance participative du service public.
Un premier élément clé consiste à saisir correctement les intérêts en jeu afin de les mettre en balance par rapport à la gestion du service public orientée vers l’intérêt collectif. En ce qui concerne le rail et le transport de passagers, les intérêts tiennent à la fois à la qualité du service pour les voyageur.euse.s quel que soit leur statut, à la qualité des conditions de travail pour les cheminot.e.s mais également à la bonne gestion des infrastructures qui supportent le système.
Un deuxième élément clé consiste à construire un mode de gouvernance adapté qui intègre toutes les personnes concernées, au premier rang desquelles se trouvent les usagers et usagères du service public. Partant de l’idée que la participation des usager.e.s ne saurait être limitée à la seule consultation en vue de l’élaboration des décisions, on peut distinguer trois échelons de gouvernance participative : l’accès à l’information et à la connaissance, la participation à l’élaboration des décisions et, enfin, la participation effective à l’adoption de la décision.
La SNCB comme service public participatif ?
En tant qu’entreprise publique autonome ayant la forme d’une société anonyme de droit public, la SNCB est gérée par son comité de direction et son conseil d’administration, et est soumise au pouvoir de contrôle du ministre dont elle relève[6]. Il en résulte que ni les travailleurs et travailleuses de la SNCB, et encore moins ses usager.e.s, ne participent à la prise des décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement du rail belge.
Or, le transport de voyageurs ainsi que son accueil et son information, constituent un service public qui répond à un besoin collectif essentiel. Il est dès lors permis de rêver d’un mode de gestion qui permette de faire des choix orientés dans l’intérêt collectif.
Conformément aux grands principes esquissés ci-dessus, le premier enjeu est dès lors d’identifier les intérêts des différentes parties prenantes. L’on songe spontanément au monde politique (notamment le Gouvernement et le/la ministre de tutelle), aux usager.e.s et aux cheminot.e.s. La réflexion devrait cependant être poussée plus loin pour s’assurer qu’aucun acteur n’est oublié. On peut en effet se demander dans quelle mesure, par exemple, les personnes qui ne sont pas des usager.e.s habituels (seulement occasionnels voire même qui n’ont pas la qualité d’usager.e.s), ne devraient pas être incluses dans le modèle de service public à gouvernance participative.
Le second défi est ensuite de mettre sur pied une structure de service public ferroviaire doté d’un mode de gouvernance qui intègre les différents intérêts tels qu’identifiés.
Outre l’obligation de rendre toute l’information publique (les contrats, les financements, les accords, etc.), l’on pourrait prévoir la mise sur pied d’une assemblée publique ou d’un conseil représentant les citoyen.ne.s et/ou les usager.e.s, les cheminot.e.s et qui participe effectivement à la prise de décision, faisant ainsi contrepoids au management. Il faut relever qu’auparavant, depuis la création de la SNCB et jusqu’en 2002, les syndicats siégeaient au sein du conseil d’administration de la SNCB. Cette présence leur permettait de peser dans les décisions et, par conséquent, de garantir une certaine paix sociale. Le retour à une représentation syndicale au sein de l’organe d’administration pourrait donc être parfaitement envisagée. S’il existe bien aujourd’hui un Comité Consultatif des Voyageurs Ferroviaires, ce dernier ne dispose que d’une compétence d’avis sur toute question relative aux services de transport, qui ne lient donc pas la direction. Pour que le modèle tienne la route, il sera essentiel de prévoir un mécanisme de recours/d’accès à un juge qui permette que la décision finale ne soit pas confisquée à certains acteurs ou groupes d’intérêts.
Brève conclusion : de l’audace et de l’imagination
Il n’existe pas de système parfait. Ce constat ne doit toutefois pas nous conforter dans le statu quo et être un frein à l’imagination. Des innovations audacieuses sont possibles, même si elles ne constituent que des « gouttes d’eau » dans un système démocratique toujours perfectible et en besoin de changement. L’important consiste finalement dans l’accumulation de ces gouttes d’eau qui seront autant de manières différentes de diversifier les institutions et d’approfondir la démocratie. Cette question est d’autant plus brûlante que le modèle de la SNCB comme opérateur unique de transport ferroviaire de passagers est progressivement remis en question sous les contraintes de la libéralisation – c’est-à-dire l’ouverture à la concurrence – du rail. En effet, il se pourrait qu’à l’avenir (après 2032) la SNCB soit concurrencée par d’autres opérateurs (publics ou privés) pour la fourniture de services de transport. Comment, dans ce contexte, garantir une participation citoyenne ? La SNCB pourrait profiter de sa position actuelle pour se montrer innovante et avant-gardiste en la matière à travers un modèle équilibré.
[1] Pour une analyse approfondie de cette question, voir A.-S. Bouvy et G. Rolland, « La gouvernance participative des services publics », R.B.D.C., 2023/4, pp. 371-420.
[2] Par clarté, nous parlerons uniquement de participation « citoyenne », sachant que le terme est ici appréhendé de manière large, c’est-à-dire comme devant inclure les résident(e)s et les étranger(e)s qui n’ont pas la citoyenneté belge.
[3] J.-B. Pilet et D. Sinardet, « Écouter la voix du citoyen, du mouvement participatif à l’isoloir.Etude sur les mécanismes de démocratie participative en Belgique : pratiques, enjeux, perspectives », étude codirigée ULB-VUB, janvier 2023.
[4] Voir entre autres, le travail d’I. Ferreras, J. Battilana, D. Méda, Democratize Work. The Case for Reorganizing the Economy, University of Chicago Press, May 2022.
[5] T. Perroud, Service public et commun. À la recherche du service public coopératif, Le Bord de l’eau, 2023.
[6] À savoir le ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions. Il en va de même pour Infrabel, le gestionnaire du réseau.



![Services publics « participatifs » : et si la SNCB s’ouvrait à la participation citoyenne, cela donnerait quoi ?[1]](https://matribune.be/wp-content/uploads/2025/05/ChatGPT-Image-8-mai-2025-11_21_48.png)