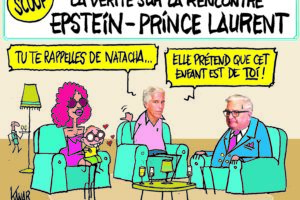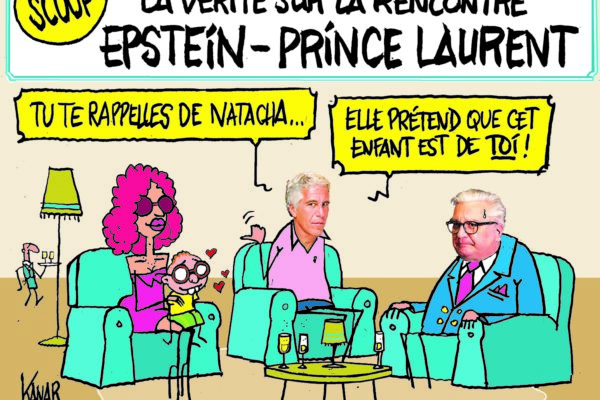Le réseau ferroviaire allemand et la Deutsche Bahn (DB), son opérateur ferroviaire historique et principal[1], ont longtemps incarné un modèle admiré en Europe : ponctualité, maillage dense reliant métropoles et villages ruraux, trains à grande vitesse intégrés à un réseau régional performant, et une capacité à faire circuler un volume conséquent de passagers. Les réformes engagées dans le milieu des années 1990, qui associaient modernisation technique et ouverture à la concurrence, ont dans un premier temps porté leurs fruits et fait de la DB un modèle à l’échelle européenne.
Son image s’est cependant nettement ternie ces dernières années. Les retards sont devenus la norme, les infrastructures montrent leurs limites et les investissements colossaux prévus ne suffisent pas à enrayer rapidement la dégradation du réseau et du service. La principale ligne du pays reliant Berlin à Hambourg est fermée pour neuf mois depuis ce vendredi 1er août pour rénovation générale. Selon son président Richard Lutz, la Deutsche Bahn traverse « sa plus grave crise » depuis la réforme de 1994. Ce qui était autrefois perçu comme un modèle de gestion et de fiabilité est désormais cité en exemple… pour mettre en garde.
Le diagnostic de la situation actuelle
Depuis plusieurs années, la ponctualité de la DB est en chute libre : seulement environ 56 % des trains roulant sur les grandes lignes arrivent dans la fenêtre officielle de 6 minutes de retard, contre 85 % dans les années 1990. Fin juin 2025, la ponctualité remonte légèrement pour atteindre à peine 63,4 %, ce qui constitue un léger progrès par rapport à 62,7 % pour l’année 2024 mais demeure très insatisfaisant.
Sur le plan financier, la DB a perdu 1,8 milliard d’euros en 2024 (ce qui est mieux que 2023, année au cours de laquelle la DB a perdu 2,7 milliards). La dette atteignait environ 32,6 milliards fin 2024. La vente de la filiale logistique « DB Schenker » pour environ 14,3 milliards a permis de réduire la dette de la DB d’environ 10,5 milliards d’euros, mais cela ne constitue qu’une opération unique et pas une solution structurelle pérenne.
À l’instar de beaucoup d’autres pays européens, les infrastructures souffrent d’un sous-investissement chronique : l’arriéré d’investissements est estimé à 92 milliards d’euros. Le matériel est vétuste et certains postes d’aiguillage datent encore du XIXᵉ siècle.
Les causes du déclin
Les facteurs expliquant les difficultés actuelles de la DB sont multiples et s’étalent dans le temps. S’il est difficile d’en dresser une liste exhaustive[2], il est toutefois possible de dégager des grandes tendances.
Il y a tout d’abord un long sous-investissement dans le rail allemand à travers un désengagement de l’État du financement ferroviaire. L’État allemand a par ailleurs investi massivement dans des projets internationaux coûteux au détriment de son réseau national.
À cela s’ajoute une structure institutionnelle hybride : la DB est à la fois une société privée détenue à 100% par l’État et un opérateur cherchant la rentabilité dans un marché ferroviaire libéralisé. Ce double statut brouille les priorités entre la poursuite de missions de service public et les impératifs de productivité, rentabilité et performance. En outre, l’organisation interne très segmentée complique la coordination et les décisions sur le long terme.
De la situation de la DB sur un marché libéralisé et ouvert à la concurrence, découlent une série de décisions politiques qui ont accru l’instabilité du groupe : la priorité est donnée à la performance réduction des coûts, parfois au détriment de la vision à long terme. Concrètement, la réduction des coûts a touché tous les pans du secteur : moins de trains en réserve, réduction du personnel et des conducteurs, réduction des coûts d’entretien et de maintenance (certaines opérations jugées trop coûteuses sont reportées ou réduites). Ces petits morcellements, mis les uns à côté des autres, contribuent petit à petit à la fragilité globale du système et à son incapacité, à terme, à répondre aux besoins de la population (en particulier en cas de crise). C’est tout le délicat problème d’une vision du service public dominée principalement par la performance, au détriment de la robustesse du système, dont nous avons eu l’occasion de parler dans un précédent article.
La stratégie de redressement
Fin 2024, la DB a lancé un plan de redressement baptisé S3 (pour Sanierung[3]) dont l’objectif annoncé est de remettre la DB sur une trajectoire fiable, rentable et de répondre aux aspirations nationales en matière de transport et de climat d’ici fin 2027.
Le programme s’articule autour de 3 piliers. Le premier concerne les infrastructures. Pour remédier à la vétusté des infrastructures, la DB et le gouvernement fédéral allemand ont lancé un chantier de rénovation « Generalsanierung » (littéralement, « rénovation générale ») qui vise à moderniser plus de 4.200 km de lignes d’ici 2035. Le budget s’élève environ à 40-45 milliards d’euros. Ce programme impose toutefois des fermetures prolongées qui perturbent le trafic.
Le deuxième pilier concerne l’exploitation. Afin d’améliorer la ponctualité, S3 introduit un système synchronisé de construction et de maintenance, où les travaux sont planifiés dès l’élaboration des horaires, pour éviter de perturber le trafic à chaque chantier. En parallèle, la DB veille à désengorger les cinq nœuds ferroviaires majeurs (Berlin, Hambourg, Cologne, Francfort, Munich), et à améliorer la qualité ainsi que la disponibilité des rames.
Enfin, le troisième pilier économique vise à améliorer la « profitabilité » du groupe sans procéder à des licenciements. L’accent est mis sur une réduction ciblée d’environ 10.000 postes administratifs et commerciaux, une baisse du ratio des coûts de personnel (objectif d’environ 50 %) et une optimisation des investissements pour renforcer l’efficacité opérationnelle.
Quelles leçons à tirer pour la Belgique et la SNCB ?
La première leçon à tirer, valable pour tous les services publics, mais en particulier ceux structurés en « réseau », est l’importance de garantir un financement stable et pluriannuel, indépendamment des cycles politiques, afin de privilégier la stabilité à long terme et la continuité du service plutôt que des objectifs de rentabilité immédiate. Nous l’avons dit à propos du cas britannique, le rail est un service public qui coûte cher et qui nécessite des investissements (d’infrastructure et d’exploitation) constants.
La deuxième leçon est que la qualité d’un système ferroviaire réside dans la mise en place d’un système de gouvernance centralisé et intégré, et une organisation claire, le tout encadré par une régulation forte. La coordination étroite entre le gestionnaire de l’infrastructure et l’opérateur est cruciale : des structures trop cloisonnées compliquent la planification et la gestion des perturbations.
La troisième leçon est qu’un service public ferroviaire de transport doit avant tout viser la stabilité et la fourniture du service fiable, ponctuel et sûr. Il doit impérativement disposer de capacités de réserve, investir en priorité dans la robustesse opérationnelle, la résilience du réseau et la qualité de l’expérience des voyageurs et voyageuses.
[1] Créée en 1994 suite à la réunification des anciens opérateurs de l’Est et de l’Ouest, la Deutsche Bahn est une société privée dont 100% des actions appartiennent à l’Etat allemand. La DB assure 67 à 74 % du transport régional / local de passagers.
[2] On peut aussi mentionner des choix politiques d’investissement discutables ou mal orientés, la régionalisation du réseau qui rend difficile la coordination entre l’opérateur national en charge de l’infrastructure et les Lander qui exploitent les trains régionaux, des décennies de politique au profit du secteur routier plutôt que ferroviaire, etc.
[3] Assainissement ou redressement.