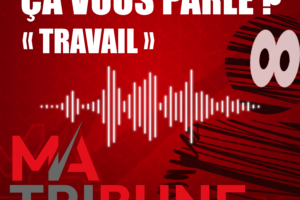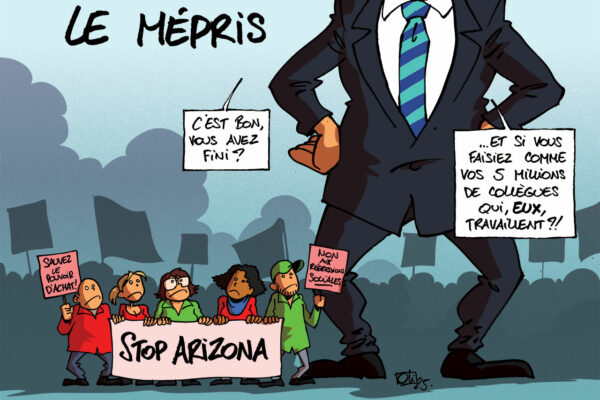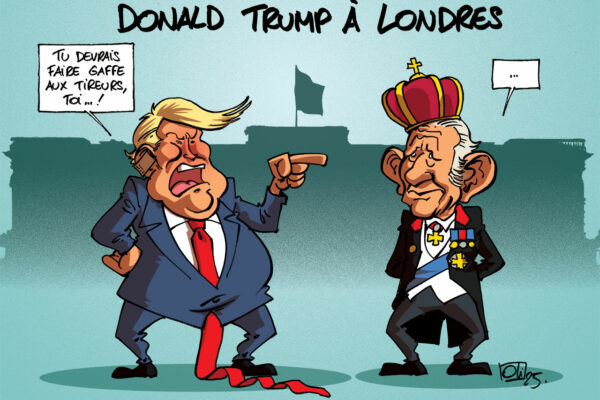Après avoir mis fin à la statutarisation des fonctionnaires de la Région wallonne en janvier 2025, le Gouvernement wallon vient de franchir une nouvelle étape : ce 1er septembre, il a adopté en première lecture une réforme en profondeur du mode de désignation et de la gestion de la carrière des « top managers » de la fonction publique wallonne. Fini le Certificat de management public (CMP), longtemps présenté comme un gage de professionnalisme et d’indépendance, et place à un modèle directement inspiré du secteur privé : recrutement externalisé, évaluations régulières, rémunération variable basée sur les résultats et ouverture accrue aux profils issus de l’entreprise privée. Officiellement, l’objectif est double : renforcer la performance et rendre l’administration plus attractive. Derrière cette « modernisation » affichée, on retrouve toutefois clairement une inflexion néolibérale qui pourrait fragiliser l’impartialité du service public, notamment à travers une politisation accrue des nominations. Vouloir appliquer ce type de « bonnes recettes » issues du privé au secteur public n’est pas nécessairement une garantie de succès, au contraire.
Qui sont les « top managers » et où travaillent-ils et elles ?
Les « haut·es managers » ou « top managers » de la fonction publique wallonne (régionale et communautaire[1]) désignent les dirigeant·es qui occupent les postes stratégiques à la tête des administrations et organismes publics (ou « unités d’administration publique », UAP), tels que le Service public de Wallonie (SPW), l’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (Forem), l’Agence pour une vie de qualité (Aviq) ou encore la Caisse publique wallonne d’allocations familiales (Famiwal). Les top managers sont souvent désigné·es sous les termes directeur·rices ou administrateur·rices généraux·ales. Leur rôle est principalement d’assurer la mise en œuvre des décisions politiques du gouvernement, de piloter les équipes et de garantir la bonne exécution des missions de service public.
Le système actuel de mandat centré sur le Certificat de management public
L’accès aux hautes sphères de la fonction publique wallonne repose sur deux piliers principaux : le premier est le Certificat de management public (CMP). Cette formation spécifique, dispensée par l’École d’administration publique Wallonie Bruxelles et sanctionnée par un examen organisé par le Selor[2], représente un passage obligé pour tout·e candidat·e au mandat de top manager. L’objectif est de garantir que les futur·es dirigeant·es disposent d’une maîtrise solide et uniforme des principes de gouvernance publique, de gestion budgétaire et de management administratif.
Le deuxième pilier est le système des mandats : les hautes fonctions sont exercées sous la forme de mandats temporaires, généralement alignés sur la durée d’une législature, ce qui permet d’évaluer périodiquement les performances et de renouveler ou non la confiance accordée aux titulaires de ces mandats.
Ce système a pour avantage de formaliser des critères objectifs de sélection et de professionnaliser l’accès aux plus hautes responsabilités. Il est toutefois aussi critiqué pour sa lourdeur et sa tendance (supposée ou réelle) à décourager des profils issus du secteur privé, rebutés par la contrainte d’une formation longue et contraignante avant même de pouvoir entrer en fonction.
La réforme vers un système de recrutement et de gestion de carrière inspiré du secteur privé
La réforme adoptée en première lecture en septembre 2025 marque une rupture radicale des deux piliers précités.
Le Certificat de management public est tout simplement supprimé. L’objectif annoncé est d’ouvrir la voie à des candidatures plus larges, y compris issues du secteur privé. Les épreuves de recrutement sont menées par un consultant externe (avec des conditions d’accès annoncées comme étant « renforcées », sans savoir ce que cela recouvre exactement) et des auditions sont dirigées par les ministres fonctionnel·les et le ou la ministre de la Fonction publique.
Le système de mandats temporaires cède la place à des contrats de travail à durée indéterminée (CDI), mais assortis de clauses résolutoires qui permettent de mettre fin à la collaboration en cas de changement de gouvernement ou d’évaluations jugées insatisfaisantes. Ces évaluations peuvent d’ailleurs devenir plus fréquentes et plus exigeantes : un·e haut·e manager pourra désormais être auditionné·e dès 6 mois après son entrée en fonction, puis une à deux fois par an.
Parallèlement, la réforme introduit une logique de rémunération variable, où une partie du salaire dépend directement de l’atteinte des objectifs fixés dans un contrat de performance conclu avec le ministre de tutelle.
Enfin, il est annoncé que le nombre de postes de haut·es dirigeant·es sera rationnalisé, dans un souci affiché de neutralité budgétaire et d’efficacité administrative.
Regard critique : une orientation néolibérale assumée
La réforme menée assume pleinement un glissement de la haute fonction publique wallonne vers un modèle de gouvernance inspiré des pratiques managériales du secteur privé, centré sur la responsabilisation, la compétitivité et la performance mesurable. Toutes les pratiques issues du secteur privé ne sont pas en soi critiquables, loin s’en faut. En l’espèce, appliquée à la fonction publique wallonne, la réforme comporte toutefois des éléments problématiques. Il y en a deux principaux à relever.
Tout d’abord, la suppression du Certificat de management public laisse penser non seulement que la formation à la chose publique n’est pas si importante, mais surtout que les compétences requises pour diriger un service public sont les mêmes que celles requises pour être manager dans le privé. Or, c’est loin d’être le cas. Un service public fonctionne sur la base de finances et de budgets qui diffèrent de ceux du secteur privé. Travailler sous la tutelle d’un·e ministre diffère du fait de travailler sous la direction d’un conseil d’administration ou avec des actionnaires privés. Plus fondamentalement encore, la finalité d’un service public – orientée sur le service, son accessibilité et ses garanties d’égalité – est différente de la logique du secteur privé, orientée prioritairement sur la rentabilité. Le Certificat de management public offrait la garantie que les futur·es dirigeant·es acquièrent toutes et tous les mêmes compétences à ce sujet, sur une base objective. Sans ce cadre commun, le risque de voir arriver des managers déconnecté·es des réalités du secteur public s’accroît, de même qu’une politisation de la fonction, en l’absence d’une exigence de formation commune qui constituait une barrière au copinage.
Ensuite, en substituant des contrats de performance aux mandats, l’accent est mis sur des critères de productivité et de rentabilité, qui risquent d’entraîner une fragilisation de l’indépendance des haut·es managers, davantage exposé·es aux pressions politiques (puisque leur maintien en poste dépendra de l’évaluation – et donc du jugement – de leurs ministres de tutelle). L’effritement de l’indépendance résulte également du système de CDI assortis de clauses de rupture qui n’offre pas les mêmes garanties de stabilité que le carcan de droit public.
La réforme du Gouvernement wallon portée par Jacqueline Galant (MR) marque un tournant dans la gestion du haut management de la fonction publique wallonne, en important un modèle et des méthodes issus du secteur privé. Si cette approche vise à renforcer l’efficacité et la responsabilisation, elle soulève des interrogations sur la compatibilité de ce modèle avec les spécificités du service public, à savoir notamment la poursuite de l’intérêt général avant tout autre objectif ainsi que la nécessité de préserver une gouvernance fondée sur la neutralité, la continuité et la transparence.
[1] La réforme concerne plus précisément les administrations publiques de la Région wallonne et de la Communauté française (Fédération Wallonie Bruxelles).
[2] Le Selor est un organisme public chargé du recrutement des fonctionnaires et des agent·es contractuel·les de la fonction publique fédérale et des administrations régionales et communautaires, les organismes d’intérêt public et les pouvoirs locaux qui le souhaitent.