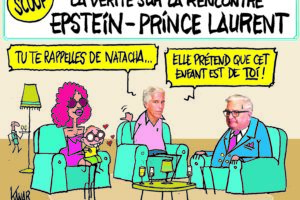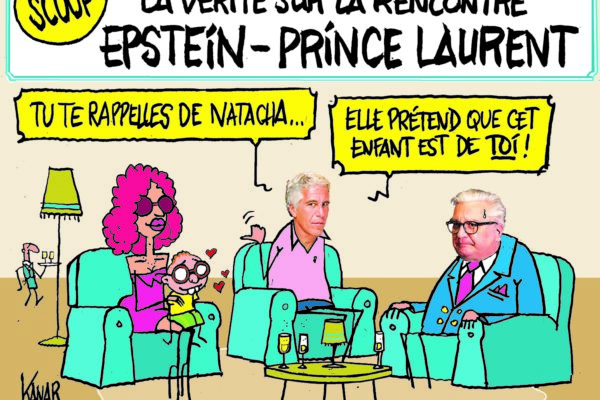Ce n’est pas un fait nouveau : les finances locales sont dans le rouge. La situation financière des villes et communes de la Région wallonne préoccupe depuis longtemps. De nombreuses communes, grandes ou petites, peinent à boucler leurs budgets ou annoncent des budgets en déficit, et ont de plus en plus de difficultés à assumer leurs missions de base : entretien des voiries, propreté publique, sécurité, aide sociale, culture, accueil extrascolaire, etc. Cette situation a déjà conduit la Région wallonne, en sa qualité d’autorité supérieure et de tutelle, à adopter en novembre 2021 un plan d’aide global aux communes – le « Plan Oxygène » – qui leur permet de contracter un emprunt – dont les intérêts sont pris en charge par la Région – en contrepartie de la mise en œuvre d’un plan d’économies et de gestion avec le Centre régional d’Aide aux Communes (Crac). Si les communes disposent d’une certaine autonomie fiscale, leurs moyens dépendent largement des autres niveaux de pouvoir, et elles sont directement tributaires des décisions prises par ceux-ci. Ainsi, les réformes prévues par le gouvernement fédéral et le gouvernement wallon vont dans le sens d’un aggravement de la situation financière des communes. Les communes sont pourtant le premier échelon de la démocratie et de la solidarité locales. Elles sont aujourd’hui dans une équation impossible : il ne s’agit pas seulement de rendre le même niveau de services avec des moyens qui stagnent ; il s’agit désormais de faire plus avec moins.
Le financement des communes repose sur deux types de « revenus » principaux : d’une part, les recettes fiscales propres et d’autre part, les dotations externes.
Les recettes fiscales proviennent principalement des centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques (IPP) et au précompte immobilier, dont chaque commune fixe le montant et qu’elle perçoit en complément des impôts fédéraux. À cela s’ajoutent diverses taxes locales (immondices, enseignes publicitaires, seconde résidence, etc.) dont le rendement varie fortement selon la richesse du territoire – essentiellement en fonction des entreprises et commerces installés sur le territoire – et selon les choix posés par les communes en vertu de leur autonomie.
En parallèle, les communes bénéficient de dotations et de subsides provenant des autres niveaux de pouvoir : la dotation générale du Fonds des communes versée par les Régions, la dotation fédérale de sécurité, les aides spécifiques aux CPAS, ou encore les subventions pour l’enseignement (communal), la culture ou le logement social. Des recettes non fiscales complètent l’ensemble et varient fortement selon les communes : revenus de patrimoine communal, dividendes d’intercommunales, redevances pour services rendus (par exemple, les entrées à la piscine communale). Ce système, historiquement conçu pour garantir une certaine autonomie financière des communes, montre aujourd’hui ses limites : les recettes et les dotations évoluent peu, tandis que les dépenses imposées augmentent.
Les principales causes de l’accroissement des difficultés financières des communes
L’aggravement de la situation financière des communes, en particulier des grandes villes wallonnes, trouve sa source dans trois causes majeures. Il existe tout d’abord un transfert croissant de charges autrefois assumées par les autres niveaux de pouvoir – particulièrement le niveau fédéral lors de la dernière réforme de l’État –, sans financement suffisant en contrepartie de la prise en charge par les communes.
Celles-ci assument en effet désormais des missions que l’État fédéral ou les Régions prenaient autrefois en charge, notamment dans les domaines résumés par les « 4 P » : police, pompiers, pauvreté (précarité) et pensions. Le financement des zones de police dépend d’un calcul dont la base n’a toujours pas été adaptée depuis la réforme des polices en 2000, conduisant ainsi les communes à devoir compenser financièrement. Le surcoût des zones de secours devrait en principe être financé à 50/50 entre le niveau fédéral et les communes. Or, l’État fédéral ne respecte pas son quota (on parle de 22 % du fédéral et de 78 % des communes)[1]. La montée de la pauvreté alourdit les budgets des CPAS, tandis que la hausse des cotisations de pension pour les agents statutaires pèse lourdement sur les finances locales maintenant et à l’horizon 2030. Ces charges structurelles, cumulées au manque de compensation qui aurait dû venir des niveaux de pouvoir qui s’en sont délestées, asphyxient lentement mais sûrement les communes.
Le coût de la transition énergétique pèse aussi largement sur les communes. Comme le souligne une récente étude menée par Belfius, les travaux visant à réduire la consommation d’énergie se heurtent à des coûts d’investissement élevés et à l’incertitude des résultats. Les pouvoirs locaux jouent pourtant un rôle central dans l’investissement public, dont ils assurent une large part en Belgique. La contraction des finances communales risque donc d’avoir un effet direct sur la qualité de vie des citoyens, par exemple en ce qui concerne les projets de rénovation énergétique des bâtiments publics, pour lesquels les communes sont souvent à la manœuvre. Ou encore pour l’amélioration de l’espace public en vue de faire face aux aléas climatiques tels qu’inondations et canicules sévères.
La troisième cause touche plus particulièrement les grandes villes et tient à leur « centralité ». Celles-ci offrent des services – hôpitaux, équipements culturels, transports, accueil social – utilisés par des usagers qui viennent de bien au-delà de leurs frontières. Les centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques, perçus uniquement sur les habitants de ces grandes villes, ne reflètent pas cette réalité : les navetteurs et usagers extérieurs bénéficient des infrastructures urbaines sans y contribuer fiscalement. Les festivités et autres événements organisés dans les grandes villes génèrent des frais qui ne sont pas supportés à l’échelle de la périphérie. Les villes supportent donc des coûts « pour tous » sans bénéficier des recettes adéquates, ce qui crée un déséquilibre budgétaire.
L’impact des réformes fédérales et régionales sur les communes
La situation financière des communes risque encore de se détériorer sous l’effet des réformes en cours aux niveaux fédéral et régional. La réforme du chômage, qui durcit l’accès aux allocations et limite leur accès à deux ans maximum, va entraîner une augmentation du nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS). Ce sont alors les CPAS communaux qui devront prendre le relais, sans disposer des moyens nécessaires, accentuant la pression sur les budgets locaux.
En Région wallonne, la réforme du dispositif APE (aides à la promotion de l’emploi) inquiète également : malgré les compensations promises, la disparition du système initial pourrait priver de nombreuses communes et associations d’un soutien structurel pour financer des emplois de proximité essentiels. Avant même cette réforme, la Région wallonne a décidé lors de son dernier conclave budgétaire de réduire de 27,5 millions d’euros les APE dans les villes et communes.
Les dotations régionales et fédérales ne suivent pas l’inflation. Ainsi, le gouvernement wallon a en effet annoncé supprimer le pourcentage de majoration de l’indexation du Fonds des communes, ce qui représente une perte estimée à 251 millions d’euros uniquement sur la législature régionale 2024-2029. D’autres mesures annoncées par les autorités supérieures pourraient encore alourdir les finances locales.
Comment sortir de l’impasse ?
La première piste de solution, évidente, est de contraindre les autres niveaux de pouvoir à assumer leurs responsabilités et garantir un financement suffisant pour chaque compétence transférée. Chaque mission nouvelle doit être accompagnée d’un moyen financier équivalent, afin d’éviter que les communes ne soient la variable d’ajustement budgétaire de l’État fédéral et des Régions. Les communes peuvent en effet citer en justice les autres niveaux de pouvoir pour inaction fautive (à l’instar de la commune d’Andenne vis-à-vis de l’État belge pour le financement des zones de secours) ou en raison du dommage (financier) qui leur serait causé (ce qu’envisage par exemple la commune de Wanze à l’encontre du Gouvernement wallon).
Une deuxième piste se trouve dans l’augmentation des taxes existantes ou la création de nouvelles. Néanmoins, ces taxes touchent rarement les plus hauts revenus mais l’ensemble des habitants de la commune, y compris les couches les plus vulnérables. Les taxes concernées par une augmentation sont souvent celles liées au ramassage des déchets par exemple. Cette piste de solution est toutefois difficile à digérer pour les communes : alors même que les gouvernements fédéral et régional répètent qu’ils ne veulent pas instaurer de nouvelles taxes, ils contraignent en réalité les pouvoirs locaux à les augmenter (à leur place).
La troisième piste de solution est plus délicate à mettre en œuvre et nécessiterait de longues négociations politiques et une réflexion générale sur la « supracommunalité ». Il s’agit d’instaurer une solidarité supracommunale renforcée : mutualiser certains services, accroître la coopération entre communes d’un même bassin de vie, partager les ressources et les équipements. Cette supracommunalité pourrait se construire sur la base des Provinces, institutions déjà existantes, dotées d’un droit de lever l’impôt et d’élus directs. Néanmoins, les Provinces, dont l’existence remonte à la création de la Belgique, couvrent un territoire qui ne correspond pas nécessairement à la volonté de mutualisation de certaines communes. Une réflexion sur la manière de concilier et concerter les intérêts communaux sur les territoires de plusieurs communes gagnera à être engagée.
Les grandes villes doivent continuer à jouer leur rôle de « centralité » et offrir des biens et services aux populations de la périphérie. Ce sont leurs rôles de grandes villes. En revanche, le modèle doit être repensé pour alléger les coûts, rationaliser les dépenses et garantir une offre de services publics de qualité sur l’ensemble du territoire, sans plomber le budget des grandes villes de manière disproportionnée. Toutefois, les communes rurales font face à d’autres défis tout aussi pressants : un territoire étendu à entretenir, des recettes fiscales parfois plus limitées et une difficulté croissante à maintenir des services de proximité accessibles. L’enjeu n’est donc pas seulement de soutenir les grandes villes, mais de repenser l’équilibre territorial dans son ensemble.
Conclusion
Le sous-financement chronique des villes et communes est un enjeu majeur de la mandature communale 2024-2030. Ce sous-financement a non seulement une incidence directe sur la qualité des services publics de proximité, mais aussi sur la qualité de vie de leurs habitants. L’absorption des coûts liés à la prise en charge des chômeurs de longue durée ayant épuisé leurs droits aux allocations de chômage aura des effets en cascade. Comment les communes vont-elles pouvoir opérer des arbitrages dans les financements accordés et les services prestés, sans porter atteinte à l’intérêt collectif ni à celui du personnel des pouvoirs locaux ?
[1] Précisons que d’ici 2030, les Provinces seront en principe tenues de reprendre à leur charge 100 % de la part versée par les Communes, selon le Gouvernement wallon MR-Engagés.