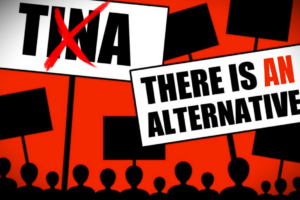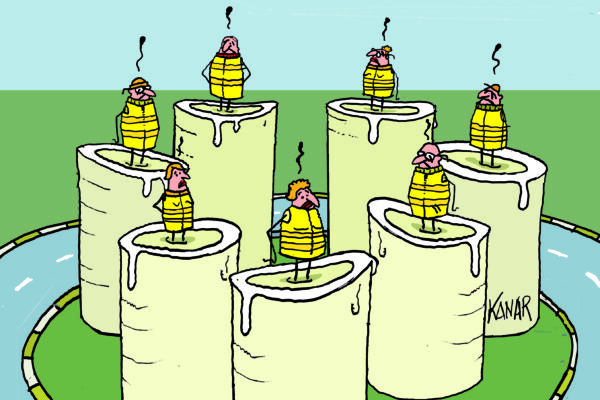La dette, toujours la dette. Elle serait trop élevée, insoutenable, menaçante. On nous répète qu’il n’y a pas d’alternative : il faut la réduire, vite, sous peine de catastrophe. La France serait « en faillite ». La Belgique pourrait « finir comme la Grèce ». Ces refrains, loin d’être nouveaux, accompagnent depuis des décennies – et même des siècles – le discours dominant du capitalisme. Au Nord comme au Sud, la dette sert de prétexte, d’alibi, d’arme politique pour justifier l’austérité et servir les intérêts des puissances économiques et financières.
Dans ce « système-dette », les agences de notation occupent une place importante. Chaque dégradation de note fait la une des médias et intensifie la pression sur les gouvernements. Récemment encore, l’État fédéral et les trois Régions (wallonne, bruxelloise et flamande) ont vu leur note abaissée, déclenchant leur lot de discours alarmistes. Comprendre ce que sont réellement ces agences est donc essentiel. Loin d’être neutres, elles sont un rouage du système capitaliste et un instrument au service des marchés financiers. Si leur influence est bien réelle, elles ne sont pas toutes-puissantes, et il est possible de les neutraliser.
Ce dossier se compose de 4 parties, qui paraitront chaque lundi jusqu’au 20 octobre.
Agences de notation | Comprendre (partie 1/4) : paru le 29 septembre
Agences de notation | Dénoncer (partie 2/4)
Agences de notation | Ne pas surestimer (partie 3/4) : à paraître le 13 octobre
Agences de notation | Neutraliser (partie 4/4) : à paraître le 20 octobre
Après avoir analysés leur origine, leur développement et leur fonctionnement de base, analysons maintenant de manière critique le rôle des agences de notation au sein de la finance mondiale. De nombreuses critiques peuvent être formulées à leur égard, en voici les principales.
1. Elles ne sont pas indépendantes (triple conflit d’intérêt)
Les agences de notations sont potentiellement en situation de triple conflit d’intérêt.
Premièrement, un peu à l’image des commissaires aux comptes ou des services externes de prévention et de protection au travail (SEPPT)[1], les agences de notation sont donc payées par les États ou les entreprises afin de noter ces mêmes États ou entreprises. Elles pourraient donc logiquement avoir tendance à donner des « meilleures » notes à leurs « bons » clients, à savoir ceux qui paient bien ?
Évidemment, les agences de notation se défendent de cette critique en affirmant qu’elles n’ont aucun intérêt à attribuer une bonne note par complaisance car cela pourrait mettre en péril leur réputation, réputation qui leur assure la confiance des marchés. Mais il est permis d’en douter. En effet, sauf pour quelques rares pays de référence et jugés parfaitement « sûrs » (AAA/AA) – par exemple l’Allemagne qui n’a aucun contrat rémunéré –, on remarque que les États dans une situation plus « vulnérables » sont plus enclins à solliciter et rémunérer les agences, afin d’obtenir une note la plus favorable possible, notamment grâce à des rencontres et des échanges réguliers parfois ou tout simplement pour être couverts officiellement malgré leur risque plus élevé.
Deuxièmement, nous l’avons déjà écrit, le conflit d’intérêt était encore plus évident dans le cas des produits structurés : les agences de notation ont été engagées par les institutions financières pour concevoir et ensuite noter les produits structurés qu’elles avaient elles-mêmes créés ! Comment s’étonner alors que, jusqu’à la veille de la crise financière, des milliers de produits financiers pourris, dont les fameux prêts hypothécaires subprimes, accordés à des ménages totalement insolvables, se sont vu accorder par les trois principales agences de la notation la plus haute note, soit triple A.
Enfin, un troisième conflit d’intérêt apparait lorsqu’on s’intéresse à l’actionnariat de ces agences. Or, qui détient réellement ces agences de notation : de grandes institutions financières telles que Barclays, Deutsche Bank, ou encore Goldman Sachs Group Inc. Nous sommes donc dans une situation où des banques paient des agences qu’elles possèdent pour que celles-ci leur donnent une note[2]. En ce qui concerne les États, la situation est également problématique : les notes qui influencent les taux d’intérêt des dettes publiques émises sur les marchés financiers sont donc données par des agences qui sont contrôlées par ces mêmes marchés financiers.
2. Elles manquent de transparence
Malgré quelques améliorations survenues après la crise de 2008, les agences de notation restent opaques sur plusieurs plans.
Comme dit précédemment, les agences notent régulièrement les États sans aucune sollicitation. Et dans ce cas, l’État n’a aucun moyen de contrôler ni de discuter la méthodologie ou les informations utilisées. Il ne peut donc pas vérifier que l’analyse repose sur des données correctes ou complètes. Cependant, ces notes ont potentiellement un impact sur ses finances et sa crédibilité sur les marchés, puisque les investisseurs et les médias prennent ces notes comme référence. Par ailleurs, depuis 2009 on sait si une note a été sollicitée (et donc rémunérée) ou non, mais le montant payé par un État ou une entreprise aux agences n’est pas du domaine public et est protégé par le secret commercial.
Ajoutons que si les agences publient leurs décisions ainsi que les principaux critères qui ont été pris en compte (stock de la dette, ratio dette/PIB, croissance économique…), les rapports détaillés, la méthodologie, les pondérations entre les critères, etc. ne sont pas connus.
De la même manière, les interactions entre les agences et les émetteurs ne sont ni encadrées ni publiées.
3. Elles ne sont pas neutres
Bien qu’elles prétendent se contenter d’« informer les marchés », les agences de notation ne sont pas des observateurs neutres et objectifs. En effet, leur analyse se place à partir d’un point de vue précis : celui des créanciers. La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ? L’amélioration des services publics ? La préservation des écosystèmes ? Rien de cela ne compte vraiment. La seule chose qui compte, c’est la capacité des États à rembourser leurs dettes aux créanciers. Elles sont donc, de fait, parties prenantes du système financier et défendent les intérêts des détenteurs de capitaux.
Ainsi que le rappellent fort justement Tom Duterme et Damien Piron dans leur récente carte blanche : « Les critères d’évaluation mobilisés par les agences de notation ne sont pas aussi « neutres » et d’une « objectivité incontestable » que ne le suggère le concert des réactions politiques en Belgique. Ils représentent les intérêts de la communauté financière, celle-là même qui prête son argent à l’État en achetant ses obligations. Telle est leur fonction, explicite et assumée. Ainsi, un équilibre entre recettes et dépenses est-il bien accueilli, non pas parce qu’il témoigne d’une bonne gouvernance, mais parce qu’il garantit le respect des remboursements. Pareillement, dans son rapport dévolu à la Belgique, Fitch Ratings salue les réductions des allocations de chômage adoptées par le gouvernement Arizona, non pas parce qu’elles « mettent en valeur » le travail, mais parce qu’elles diminuent les dépenses publiques. »
Les agences vont donc avoir tendance à saluer positivement tout ce qui va dans le sens des intérêts des marchés financiers. Inversement, toute politique progressiste allant à l’encontre des intérêts du capital – par exemple des mesures de justice fiscale, de redistribution ou d’amélioration des services publics – aura tendance à être considérée négativement.
Leur fonction est politique. Elles ne notent pas simplement un « risque ». Elles jugent également de la conformité d’un État aux dogmes de l’économie de marché. Et quand un pays s’en écarte, la punition tombe sous forme de dégradation. Les agences de notation constituent une courroie du système capitaliste, un outil au service du grand capital en général et des créanciers en particulier.
4. Elles sont incompétentes
Alors qu’elles sont censées jouer un rôle central dans l’évaluation des risques financiers, les agences de notation ont démontré à plusieurs reprises leur incapacité à anticiper les grandes crises financières, par exemple :
- La crise asiatique (1997) : les agences n’ont pas vu venir l’effondrement brutal des économies de la Thaïlande, de la Corée du Sud ou de l’Indonésie ;
- Les scandales financiers du début des années 2000 : le 28 novembre 2001, soit quatre jours avant sa faillite, le géant de l’énergie Enron bénéficiait toujours de la meilleure note des trois grandes agences ;
- La crise des subprimes (2007-2008) : les agences ont accordé la note maximale (AAA) à des milliers de produits financiers toxiques qui se sont totalement effondrés quelques mois plus tard. Quant à la banque Lehman Brothers, juste avant sa faillite en septembre 2008, elle était encore notée « A », un niveau censé signaler une institution solide.
Les agences ne prévoient pas les crises. Au mieux, elles les constatent, souvent a posteriori. Ce fonctionnement pose la question de leur réelle valeur ajoutée en tant qu’évaluateurs de risque.
5. Elles sont néfastes (prophétie auto-réalisatrice)
Ne l’oublions pas, les agences de notation portent une part de responsabilité importante dans la crise financière de 2008.
Alors que les agences de notation sont normalement là pour éviter aux acteurs du marché des mauvaises surprises, leurs actions ont souvent pour conséquence d’aggraver le diagnostic qu’elles posent. C’est ce qu’on appelle le phénomène de prophétie auto-réalisatrice : au lieu de régler le problème, une modification de la note peut concrétiser une situation qui n’était pas existante. Par exemple, si une agence dégrade une note d’une banque en affirmant que celle-ci fait face à un risque de solvabilité, la banque peut, suite à cette décision, se retrouver face à des difficultés de solvabilité … Citons ici Pier Carlo Padoan, secrétaire général adjoint et chef économiste de l’OCDE, ne pouvant en aucun cas être qualifié d’économiste de gauche, qui déclare en juillet 2011 : « Ces derniers temps, les agences de notation ont montré qu’elles sont fortement procycliques et qu’elles produisent des prophéties autoréalisatrices. ( …) C’est comme pousser quelqu’un déjà au bord d’une falaise. Cela aggrave la crise. »
[1] Les SEPPT sont payés par les entreprises pour identifier et en évaluer les risques liés à la sécurité, à la santé et au bien-être psychosocial au sein de ces mêmes entreprises.
[2] À titre d’exemple, l’agence Fitch est une filiale de la compagnie financière Fimalac, un des leaders dans le domaine de la gestion du risque financier. La Fimalac est elle-même propriété du Groupe Marc de Lacharrière, administrateur du groupe Casino, de L’Oréal, de Renault et membre du Conseil consultatif de la Banque de France. À la tête d’une fortune estimée à plus de 1,6 milliards d’euros, Marc de Lacharrière est une des personnes les plus riches de France. En résumé, c’est donc une filiale d’une société financière, possédée et dirigée par un milliardaire français, qui note la Belgique et la Région wallonne.