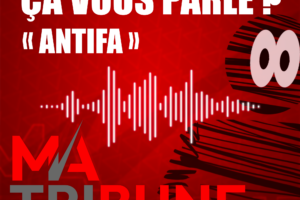C’est une paradoxale semi-victoire juridique, mais une victoire démocratique : les associations bruxelloises perdent leur recours contre l’ordonnance « Bruxelles numérique », mais gagnent l’essentiel. Dans un arrêt rendu le 25 septembre dernier (n°126/2025), la Cour constitutionnelle a mis un frein net à la tentation du « tout-numérique » dans les administrations bruxelloises. Saisie par vingt-quatre associations et syndicats, soutenus dans leur démarche par Unia, la Cour confirme que chaque Bruxellois doit disposer d’un accès physique garanti à l’administration. Un signal fort adressé à un pouvoir politique parfois trop empressé d’ériger la numérisation en horizon indépassable du service public.
Un recours né d’une inquiétude très concrète
Tout commence avec l’ordonnance « Bruxelles numérique », adoptée par la Région en janvier 2024. Le texte, censé moderniser la relation entre l’administration et les citoyens, ambitionnait de généraliser les démarches en ligne tout en prévoyant – en théorie – certaines garanties d’accessibilité. Mais dans les faits, le dispositif laissait des failles béantes : il autorisait les administrations à se dispenser des guichets, services téléphoniques ou courriers postaux si ceux-ci représentaient une « charge disproportionnée ».
L’article 13 du texte, au cœur de la controverse, prévoyait bien trois voies d’accès – guichet, téléphone et courrier postal – mais ajoutait deux échappatoires : la possibilité de « mettre en place des alternatives » et la possibilité de s’en dispenser en cas de « charge disproportionnée ».
C’est ce flou – et le risque d’exclusion qu’il entraîne – qui a poussé vingt-quatre associations et syndicats bruxellois à déposer, le 19 août 2024, une requête en annulation devant la Cour constitutionnelle contre certains éléments de l’ordonnance « Bruxelles numérique ». Leur cible : essentiellement deux phrases de l’article 13 de l’ordonnance du 25 janvier 2024, menaçant l’accès hors ligne aux services publics.
Parmi les associations : Lire et Écrire Bruxelles, la Fédération des services sociaux, la FGTB, la CSC Bruxelles, ATD Quart Monde, la Fédération des maisons médicales, la Ligue des droits humains ou encore Brussels Platform Armoede. Quelques mois plus tard, Unia – l’institution publique chargée de la lutte contre les discriminations – s’est jointe à la procédure, soulignant le risque d’exclusion des personnes en situation de handicap ou âgées.
Leur objectif : empêcher la disparition du contact humain dans les services publics.
À Bruxelles, rappelle Lire et Écrire, 36 % des habitants – et 70 % des personnes peu qualifiées – se trouvent en situation de vulnérabilité numérique. Derrière ces chiffres, il y a des parcours concrets : ceux d’usagers qui peinent à remplir un formulaire en ligne, d’aînés qui ne disposent pas d’adresse e-mail ou de personnes en situation de handicap dont les logiciels ne permettent pas d’interagir avec certaines plateformes administratives.
Une défaite juridique, mais une victoire d’interprétation
Dans son arrêt, la Cour rejette formellement le recours : les articles contestés ne sont pas, en soi, inconstitutionnels.
Mais elle impose une lecture protectrice de ces dispositions, et cela change tout.
La Cour précise que les trois canaux – guichet, téléphone et courrier – constituent une garantie cumulative et minimale ; ils ne peuvent être remplacés que par des services nonnumériques offrant un niveau de qualité équivalent, comme des permanences décentralisées ou des visites itinérantes.
Surtout, la Cour tranche un point clé : la notion de « charge disproportionnée » ne s’applique pas à ces garanties minimales. En d’autres termes, une administration ne peut plus justifier la suppression d’un guichet ou d’une ligne téléphonique par un manque de moyens.
Ce détail juridique change tout. Car il ne s’agit pas seulement d’un débat sur la modernisation des services publics : c’est une question d’égalité d’accès aux droits. En confirmant la triple garantie, la Cour reconnaît que le numérique peut être un outil utile, mais qu’il ne saurait devenir une condition pour les citoyens d’accéder à leurs droits.
Une mobilisation de longue haleine
Cette victoire d’interprétation ne doit rien au hasard. Elle est le fruit d’une mobilisation de fond qui a commencé bien avant le dépôt du recours.
En réalité, tout a vraiment commencé en octobre 2022, quand circule un brouillon d’avant-projet d’ordonnance « Bruxelles Numérique » préparé par le cabinet du ministre Bernard Clerfayt (Défi, en charge de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux). Le gouvernement régional ne s’est alors pas encore positionné sur le texte. Un texte qui ne prévoit aucune alternative hors ligne pour les administrations bruxelloises, juste un accompagnement vers le numérique pour les personnes en difficulté !
Le projet suscite un tollé auprès des associations bruxelloises qui se mobilisent rapidement. Le 14 novembre 2022, 200 associations signent une Carte Blanche qui dénonce le caractère discriminatoire de cette ordonnance et réclame que la numérisation s’accompagne de garanties d’accès hors ligne. Le 6 décembre, elles se rassemblent publiquement pour réclamer des guichets physiques et garantir l’accès aux droits. Puis la mobilisation s’intensifie : actions de sensibilisation, manifestations devant les administrations, campagnes de communication sur les « droits numériques », focus sur les actions dans des communes bruxelloises… Pendant de longs mois, les associations tiennent des rencontres avec le cabinet du ministre et des parlementaires bruxellois, soutenues par l’opposition (Ecolo, PS, PTB).
Ces pressions aboutissent à plusieurs amendements avant le vote final de janvier 2024, mais les associations jugent ces garanties encore trop fragiles. D’où la décision, en août 2024, d’aller jusqu’à la Cour constitutionnelle.
Un message politique
Au-delà du cas bruxellois, cet arrêt envoie un message plus large à toutes les administrations publiques : la transition numérique ne peut se faire contre les citoyens, ni au détriment du lien social.
L’arrêt du 25 septembre crée une jurisprudence : il s’imposera à toutes les autorités, communales ou régionales, au-delà de la Région bruxelloise, et rendra plus difficile toute tentative de supprimer le contact humain au nom de la simplification administrative ou de restrictions budgétaires. Reste à voir comment les communes bruxelloises appliqueront concrètement cette décision.
Les associations promettent de rester vigilantes et appellent les pouvoirs publics à renforcer la qualité des services hors ligne.