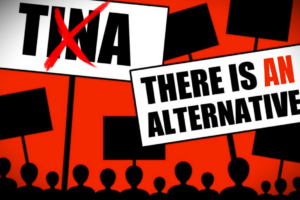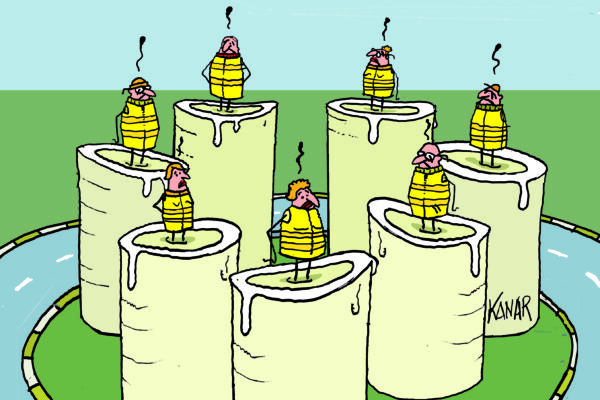Si vis pacem, cole justitiam
Si vis pacem, cole justitiam. Si tu veux la paix, cultive la justice ! Avant que cette devise ne devienne celle de l’Organisation internationale du Travail (OIT) en 1919, la boucherie de la guerre de 14 portait aux limites extrêmes de l’horreur les logiques d’escalade militaire qui prévalaient jusque-là sous le principe de « qui veut la paix, prépare la guerre ».
La mort, pour ne pas dire le sacrifice, de millions de travailleurs lors de la Première Guerre mondiale a forgé, dans l’indignation, l’idée qu’il n’y a pas de justice sociale sans démocratie. C’est-à-dire sans respect des droits humains, sans protection sociale et sans garantie des libertés fondamentales. Ces conditions n’existent qu’en temps de paix. Depuis 1919, le mouvement ouvrier, notamment en Belgique, n’a eu de cesse de rappeler que la paix est le socle de toutes nos libertés.
La nuée et l’orage
Avant 1914, le concept de paix n’est pas absolu, il cède la place à la question sociale. En effet, l’Association internationale des Travailleurs (AIT) – nom officiel de la Première internationale fondée en 1864 – dénonçait moins la guerre comme « un mal en soi, que comme un des fruits de l’impérialisme et du capitalisme et un frein à l’émancipation de la classe ouvrière[1] ». C’est le socialiste français Jean Jaurès (1859-1914) qui n’aura de cesse de mettre le thème de la paix au centre de ses préoccupations car il savait que « le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l’orage ».
Au moment où s’exacerbent tous les nationalismes, la paix devient pour le fondateur de L’Humanité le premier de tous les combats, la priorité sans laquelle aucun espoir de se libérer de l’oppression n’est permis. Aussi plaide-t-il pour la mise en place d’un droit international, le développement de l’éducation, de la culture, le rapprochement entre les peuples et la suppression des inégalités. Alors que les bruits de bottes sont assourdissants, il œuvre pour la paix en dénonçant la course aux armements et l’impérialisme.
Il préconise la grève générale immédiate si un conflit devait être déclaré !
Ces revendications gardent aujourd’hui tout leur intérêt. Alors que la guerre semble à nouveau la seule échappatoire qu’ait trouvé un capitalisme à bout de souffle, il appartient à toutes les forces de gauche et humanistes de défendre, à cor et à cri, la paix, seule condition de possibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Guerre à la guerre !
Le traumatisme de la boucherie de 14-18 hante tous les pacifistes. Le mouvement ouvrier ne peut jamais oublier cette leçon apprise en lettres de sang : quand les pays se font la guerre, c’est la classe ouvrière qui meurt et qui en paie le prix ! « Quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent », résumera Jean-Paul Sartre !
Alors que la guerre a fait voler en éclat l’AIT, se crée en 1919 à Amsterdam, la Fédération syndicale internationale (FSI). Elle fonde ses espoirs sur la Société des Nations (SDN) et l’Organisation internationale du Travail (OIT) que met en place le Traité de Versailles. Le préambule de la Constitution de l’OIT stipule « qu’une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la justice sociale ». Animée d’un esprit de réconciliation, la FSI appelle à faire entrer l’Allemagne au sein de la SDN. Pour elle, parmi les tâches essentielles d’un syndicat, se trouve la lutte contre le militarisme et la guerre. Elle décrète que : « tous les travailleurs ont le devoir de s’opposer à toutes les guerres, y compris par le recours à la grève générale. »
Dans l’entre-deux guerres, le combat pour la paix se transforme progressivement en une lutte contre le fascisme, le nazisme et le franquisme. Il s’exprime notamment par des actions de solidarité avec les organisations syndicales allemandes menacées de disparition ou avec les Républicains espagnols. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la Confédération générale du travail de Belgique (CGTB) – ancêtre de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) – sera mise hors la loi et poursuivra des activités dans la clandestinité et surtout, dans la Résistance.
Guerre froide
À la Libération, la CGTB fusionne avec plusieurs autres organisations syndicales pour former la FGTB. La Centrale générale des services publics (CGSP) se recrée également et s’affilie à la FGTB. Ensemble, ils favorisent la mise sur pied de la sécurité sociale en Belgique. L’espoir de voir s’établir enfin la justice sociale se concrétise. La défense d’un pacifisme absolu va toutefois se nuancer avec les débuts de la guerre froide. Cela explique la méfiance envers les camarades communistes « qui constituent alors le fer de lance du mouvement pacifiste en Belgique, mais que leurs détracteurs accusent d’être manipulés par Moscou[2] ».
Pourtant, dès 1951, lors du congrès statutaire de la CGSP, son président, Georges Debunne déclarait : « le rôle historique qui doit être dévolu à la FGTB est d’établir un programme de paix qui ne tienne compte ni de la « Pax americana » ni de la « Pax sovietica », mais bien de la paix des peuples, de la volonté de paix des ouvriers. » Pour le Président de la CGSP, la concrétisation de cette volonté de paix se fonde sur l’existence de nombreux services publics comme instruments de la redistribution des richesses et de la justice sociale.
Si tu veux la paix, organise la paix !
Mais le capitalisme n’apprend jamais rien de ses leçons. Au contraire, il arrive même à tirer profit de ses propres contradictions, à faire du bénéfice avec ses propres tares. Aujourd’hui, le libéralisme a à nouveau pratiquement fini de casser toutes les régulations qui jugulent son avidité atavique. L’austérité, les libéralisations et autres privatisations détruisent l’État social de services publics. Les inégalités étranglent comme jamais la justice fiscale et sociale. Le travail est à nouveau une marchandise ; le salaire se négocie à vil prix. La nuée d’inégalités provoquées par le libéralisme actuel porte en elle l’orage du conflit. La guerre réapparait sous ses airs les plus méprisables : la haine de l’autre, l’exaltation des passions identitaires, l’impérialisme le plus sournois.
Et l’économie de guerre signifie bien sûr moins de moyens pour les services publics. Chaque euro dépensé pour un char, c’est un hôpital qui ferme, une école qui n’est pas construite. L’endettement accru pour se réarmer est-il autre chose qu’une vaine tentative de relancer un capitalisme pourrissant ?
« Faire parler les armes est probablement le meilleur moyen de tuer le travail syndical[3] ». Depuis que la menace atomique pèse sur le monde, la CGSP, avec l’ensemble de la FGTB, n’a cessé de mettre en avant la nécessité d’un désarmement général, l’importance de la négociation comme moyen de résoudre les conflits, le renforcement de l’ONU et du droit international, la coopération au développement, la lutte contre les inégalités, la pauvreté, l’extrême droite et la dictature.
En se mobilisant en faveur de la paix, les syndicats de ce pays ne veillent pas uniquement à la paix sociale. La conscience aiguë qu’il n’y aura jamais de travail décent sans lutter contre l’exploitation et la domination les réunit dans la défense de la démocratie, la promotion du droit et la protection des biens communs. Ils préservent comme un des plus précieux trésors collectifs le lien essentiel entre la justice sociale à l’intérieur de chaque pays et la paix internationale.
Il s’agit de forger les chaînes d’union, les seules à même de briser toutes les autres.
[1] Voir l’étude de Ludo Bettens, Le combat pour la paix, un combat syndical ?, IHOES, n°174, novembre 2017.
[2] Voir Ludo Bettens, Le combat pour la paix.
[3] Résolution du Congrès IRW-CGSP de 2004.