« Grève générale » : voilà bien une formule chargée de sens et d’affect. Dans la bouche des uns, elle sera synonyme de « contestation organisée » contre des mesures économiques, d’« arrêt de travail total » concerté par tous les travailleurs et travailleuses, d’« unité » dépassant les divisions, voire de moment d’« effervescence collective ». Pour d’autres, elle sera présentée comme une « entrave méchante », comme un « frein à la production », peut-être même comme de la « fainéantise » (c’est oublier que la grève est toujours une perte de salaire) ou, plus grave encore, comme une « prise d’otage » (c’est oublier la distinction entre un droit et un crime).
D’autres qualificatifs sont souvent associés à la grève : « grève sauvage » ou « grogne » pour animaliser un mouvement social ; « grève insurrectionnelle » pour insister sur sa dimension révolutionnaire ; « grève sectorielle » pour montrer le caractère situé ; « grève préventive » pour dire son anticipation ou sa supposée précipitation et la fameuse « grève politique » pour disqualifier l’acteur social qui la porte.
1. Le pléonasme « grève politique »
L’expression de « grève politique » est utilisée de manière récurrente par les gouvernements libéraux-autoritaires quand une opposition sociale se manifeste contre leurs choix politiques. Elle vise à disqualifier un mouvement de protestation en vilipendant le caractère supposé « politique » d’une grève pour en démontrer l’illégitimité.
Mais c’est en réalité un total pléonasme, c’est-à-dire une figure de style où l’expression d’une idée est soit renforcée soit précisée par l’ajout d’un ou plusieurs mots du même sens. Une grève n’est-elle pas politique par essence ? A fortiori une grève dans la fonction publique dont l’employeur est l’État n’est-elle pas par définition politique ?
Comment en effet imaginer d’une grève qu’elle ne soit pas politique, qu’elle ne soit pas dirigée contre des politiques publiques ou qu’elle ne soit pas porteuse d’un autre projet politique ? À moins de considérer la grève comme une action limitée à une seule revendication interne à l’entreprise, déconnectée de toute société humaine. Ce à quoi la grève ne s’est pourtant jamais limitée. Doit-on encore rappeler que la première grève générale belge l’a été pour obtenir le droit de vote non censitaire en 1893 ?
2. L’essence de la démocratie, c’est le conflit
Cet usage disqualifiant de la « grève politique » révèle en réalité l’inconfort pour un pouvoir dominant de voir un contre-pouvoir s’opposer à lui. C’est alors qu’il s’offusque d’un supposé « déni de démocratie » parce que, issu des urnes, il représenterait le choix majoritaire des citoyens contre lequel on ne pourrait se mobiliser. C’est oublier que la démocratie ne se limite pas aux moments électoraux tous les cinq ans. Et que les gouvernements portent atteinte aux droits des travailleurs par leur action.
Or, dans un sens large, la politique concerne la gestion de la cité, la polis. Et cette gestion est traversée de conflictualité entre intérêts divergents, qui est elle-même la source des contestations et des revendications au sein d’une société démocratique. Bien souvent, il s’agit de revendications des travailleurs, de leurs représentants syndicaux, de celles et ceux qui se sentent non reconnus ou exclus des politiques dominantes.
Certains exécutifs espèrent-ils sans doute que leurs décisions ne se voient imposer aucun frein, aucune entrave (ni de la part du Parlement, ni de la part des syndicats, les contre-pouvoirs institutionnalisés). Dans une conception verticale du pouvoir, la « grève politique » n’aurait d’autre fonction que de nuire à la bonne politique d’en haut.
3. La grève, un fait économique, politique ou social ?
Que serait alors une grève non politique, une grève dont le caractère politique serait absent ? Serait-ce une « grève économique » ? Une « grève syndicale » ? Une grève « sociale » ?
Or, postuler une différence entre ces grèves est une manière de dépolitiser l’économie, les rapports sociaux et la lutte syndicale. Cette dépolitisation est d’autant plus paradoxale que l’État néolibéral opère sans cesse une politisation de l’économie (c’est le processus de constitutionalisation de l’économie qui consiste à inscrire dans les traités et les textes légaux des décisions marquées d’une orientation idéologique, d’une vision économique située).
Politique et économie sont intrinsèquement liées dans les nouvelles formes de l’État néolibéral (c’est presqu’une formulation oxymorique, c’est-à-dire contradictoire). Celui-ci finance par subsides et réductions de cotisations des aides aux entreprises ; il ôte des parts de revenu aux allocataires et aux pensionnés ; il sanctionne pécuniairement des malades et il avantage fiscalement certains statuts.
Les mesures portées par les gouvernements appliquant austérité, coupes budgétaires et favorisant une politique sociale et fiscale peu ambitieuse, voire très clairement profitable au capital, sont une manière de reconduire les inégalités de classe. Il semble dès lors cohérent qu’une lutte politique en même temps qu’économique, émanant de la lutte de classes produite par ces inégalités,se déploie au sein de mouvements de grève opposés tant à un pouvoir politique qu’à un mode d’organisation du travail.
4. De la pureté politique d’une grève
Plutôt que d’être dirigée contre un employeur que l’on veut contraindre, la grève politique serait ciblée sur le pouvoir d’un gouvernement et sur des mesures strictement politiques (droits des minorités, accès à la démocratie, contestation d’une coalition, rejet d’un type d’organisation du pouvoir, etc.).
Le sujet interpelle même à l’échelon européen puisqu’en décembre 2023 a été publiée une étude relative aux « droit de grève politique au sein de l’Union (européenne) ». L’étude, commandée par la commission Affaires constitutionnelles du Parlement européen, a été rédigée par le Belge Olivier De Schutter (deuxième – non élu – sur la liste européenne d’Ecolo). Elle va encore plus loin puisqu’elle distingue les « grèves politiques » des « grèves purement politiques » et cet ajout d’un adverbe intrigue.
D’après son auteur, les « grèves politiques », qui prennent souvent la forme de grèves générales, sont dirigées contre les politiques menées par les gouvernements ou visent à influencer les programmes législatifs de ces derniers. Elles seraient protégées par l’article 28 de la charte (des droits fondamentaux de l’Union européenne) « dans la mesure où ces grèves visent des questions relatives aux intérêts économiques et sociaux des travailleurs (allant au-delà de leurs “intérêts professionnels” stricto sensu). »
Par contre, les « grèves purement politiques », c’est-à-dire étrangères à la défense des intérêts des travailleurs, ne le seraient pas. Un exemple ? Des travailleurs qui se mobilisent par une action de grève pour dénoncer le manque d’action gouvernementale sur le changement climatique… Pourtant, les travailleurs et leurs organisations représentatives sont bien au cœur des processus décisionnels qui mènent les entreprises et administrations publiques à poser des actes en faveur du climat et de la biodiversité. Ils en sont des acteurs à part entière et l’état déséquilibré des rapports de force ne permet pas toujours d’éviter d’user de la « grève » pour être entendus.
5. Alors, c’est une « grève partisane » ?
Bien plus triviales, les formules « grève purement politique » ou « grève partisane », voire « grève politicienne » sont souvent une manière d’identifier négativement un acteur politique supposé être derrière le mouvement social de protestation. Qu’il s’agisse d’un parti (PS ou PTB par exemple) ou d’un syndicat (la FGTB est régulièrement dans le viseur de ces accusations), ces formules visent à disqualifier l’adversaire d’une politique gouvernementale, l’acteur collectif qui proteste et se mobilise, en le dénonçant comme un agitateur.
Elles cherchent également à réduire la portée des mobilisations de ces grands mouvements de grève en les limitant à des organisations dites politiques. Mais considérer ainsi que la politique concerne seulement les partis et les syndicats, c’est nier l’engagement de nombreux citoyens et citoyennes en dehors de ces structures. Leur action politique (celle des associations, des collectifs ou des simples groupes d’un soir) ne peut être balayée du revers de la main sous prétexte qu’ils agiraient (consciemment ou inconsciemment) sous l’autorité de structures organisant la grève. Et les actions en cours en ce printemps 2025 ne font que confirmer que, décidément, la grève est politique et que les citoyens et citoyennes comptent bien s’en saisir.




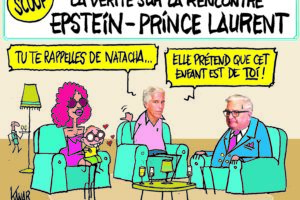


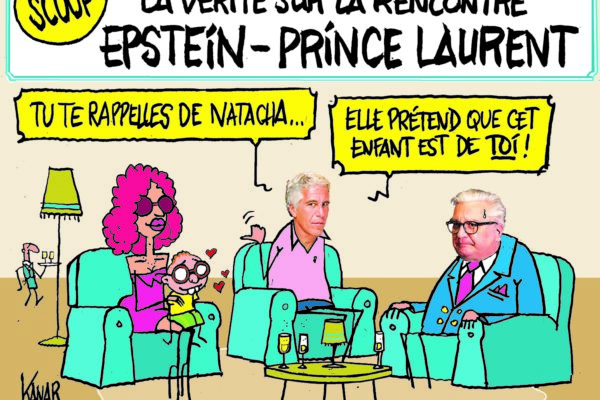


Un commentaire sur