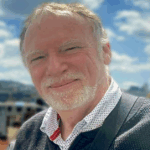Chronique d’un moment historique qui a réuni plus de 140.000 manifestants ce 14 octobre à Bruxelles.
Bruxelles. Gare du Nord ce 14 octobre. À peine sorti du train et déjà bloqué. Le quai est rempli d’une foule bigarrée toute heureuse de quitter la promiscuité des wagons pour s’ébrouer dans l’air frais bruxellois. Les premiers pétards font sursauter. Il faut se réhabituer à ces bruits, à cette clameur de la foule, à ces petits pas rythmés pour descendre vers la profondeur de la gare du Nord… À gauche, à droite, il faut éviter des personnes qui tentent de retrouver un des leurs. On se donne toujours des rendez-vous à des endroits précis, en oubliant qu’on sera mille à se rendre au même endroit.
À la sortie de la gare, c’est la première vision. Ouf, il y a du monde… Même si nous n’en doutions pas, la vue de ces milliers de personnes rejoignant le départ de la manifestation est un véritable soulagement. Ainsi donc, nous ne sommes pas seuls à s’être levés ce matin en emportant le matériel ad hoc : chasuble, casse-croute, bouchons d’oreilles et bouteille d’eau.
« No Gouvernement Arizona ! »
Sur le trottoir, une jeune fille afro-descendante porte un carton où elle a simplement écrit : « No Gouvernement Arizona ! ». Un excellent résumé de la manif. Je l’aborde. Elle s’appelle Adèle, est âgée de 34 ans et se présente comme étudiante : « Cela fait un an que j’ai arrêté de travailler pour reprendre des études d’assistante sociale. Avant, j’étais aide-soignante. J’ai arrêté parce que ce n’était plus possible les horaires de travail avec des enfants en bas-âge. L’augmentation du minerval va devenir un vrai problème pour moi. C’est déjà compliqué pour moi cette année, alors si ça augmente encore, ce ne sera plus possible ! Il faut se battre contre ces injustices. Je suis venue soutenir les personnes qui sont dans la précarité, que ce soit les jeunes ou les personnes âgées ».
Un peu plus loin, c’est un monsieur âgé à la barbe blanche et coiffé d’un bonnet rouge qui m’interpelle. Son silence en dit long sur sa détermination. Sur sa pancarte, Jean-Pol, 72 ans, imprimeur liégeois pensionné, a écrit : « Radicalement contre la violence des mesures du gouvernement ». Jean-Pol se présente. Liégeois âgé de 72 ans, il est retraité du secteur de l’imprimerie : « Je suis venu manifester parce que ce gouvernement détricote tout ce que les gens ont obtenu en luttant. La génération précédente a laissé un peu faire, mais heureusement aujourd’hui des jeunes luttent à nouveau. Cela, c’est réconfortant pour l’avenir ».
Le cortège s’ébranle lentement. Il y a tellement de monde que l’on peine à avancer. Entre la gare du Nord et la place Rogier, il nous faudra pas moins de deux heures pour faire quelques centaines de mètres. Malgré tout, la foule reste calme. Pas de mouvement d’humeur ou de grogne, au contraire l’atmosphère est plutôt festive. On discute…
Tiens, et toi, tu es venu pour quoi ? Dans un groupe de jeunes, Martin, 26 ans, doctorant à l’ULB, me répond : « Pourquoi est-ce important de descendre dans la rue aujourd’hui ? Pour les droits des travailleurs, pour lutter contre ce gouvernement qui s’attaque aux plus précaires, qui retarde nos pensions, qui précarise les étudiants, qui investit dans l’armement. On est quand même avec un gouvernement de va-t-en-guerre. Moi, quand j’avais 18 ans, je trouvais ça impensable d’imaginer que peut-être un jour je serais mobilisé (NDLR dans le cas d’une guerre). Et aujourd’hui, j’ai des discussions avec des gens de mon âge et on se demande s’ils ne vont pas oser envoyer des travailleurs se battre ».
« Ce gouvernement fabrique de la précarité »
Cette fois, on marche enfin… Il est près de 13h00. Les organisations structurées placent leurs calicots géants en travers de la rue. C’est le cas du Rassemblement wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP). Les militants sont venus par dizaines et se pressent derrière la grande bannière où Christine Mahy, la porte-parole, lance quelques chansons dont les paroles ont été détournées pour critiquer la politique du gouvernement. Christine Mahy : « On est manifestement face à un gouvernement qui vide les poches de ceux qui n’ont déjà pas assez dans leurs poches pour vivre, qu’ils soient travailleurs ou non travailleurs, qu’ils soient malades ou pas. Et donc, c’est une injustice terrible puisqu’on ne se pose pas la question de savoir comment on gère un État en étant juste, équitable, et en tendant vers la réduction des inégalités. Qu’est-ce qu’on fait avec les richesses qui ne sont pas captées ? Quel est le projet solidaire de société qu’on veut ? On ne se retrouve pas du tout derrière ce que propose ce gouvernement. On ne se retrouve pas du tout derrière les orientations de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région wallonne pour ce qui concerne la partie francophone du pays. Mais nos collègues flamands qui sont là ne se retrouvent pas non plus dans les décisions prises de l’autre côté du pays. »
Oui, Christine, ça, c’est le discours de la porte-parole du RWLP, mais toi, concrètement, quelles sont les mesures qui vont te toucher ?
« Moi, concrètement, c’est probablement mon pouvoir d’achat qui sera touché par l’augmentation des taxes communales. En effet, les communes et les entités fédérées vont devoir compenser les dépenses qui ne seront plus supportées par le fédéral. J’ai la chance d’arriver plutôt à la fin de ma carrière… Mais de nombreux travailleurs seront touchés sur leurs pensions, seront touchés sur leur pouvoir d’achat, sur l’augmentation des frais qu’ils devront assumer, dans tous les champs sociétaux, que ce soit dans l’enseignement, au niveau des communes… Tous les travailleurs vont souffrir ».
Tiffany, 50 ans, non syndiquée, ne dit pas autre chose. Elle travaille à l’Espace social/télé services, une association bruxelloise qui lutte depuis plus de 60 ans contre la précarité et l’exclusion sociale : « Nous apportons une aide individuelle aux plus précarisés, mais nous menons également des actions collectives dans le but de recréer du lien social. Aujourd’hui, nous sommes venus défendre les droits des usagers. C’est de plus en plus compliqué pour eux d’avoir accès à ces droits élémentaires. Concrètement, ce gouvernement fabrique de la précarité. De plus en plus de personnes vont se retrouver sous le seuil de la pauvreté. Et face à cela, on ne peut pas rester les bras croisés sans rien faire ».
Travailleurs des arts et enseignants, même combat !
C’est exactement ce que se sont dit des centaines d’enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles, après l’annonce de la ministre de l’Enseignement Valérie Glatiny (MR) d’augmenter la charge horaire de deux heures pour les enseignants du secondaire. Cette annonce a été ressentie, au mieux comme une méconnaissance de leur travail, au pire comme du mépris.
De nombreux enseignants ont donc rejoint le cortège, comme Christelle, prof de langues à l’Institut Sainte-Marie à Huy. Cette question du nombre d’heures, selon elle, est à rapprocher du combat idéologique que mène le MR pour supprimer le statut de fonctionnaire des professeurs, remplacer les nominations par des contrats CDI : « Ajouter deux heures de cours à tous les masters et licenciés, c’est autant d’emplois qui vont passer à la trappe pour les jeunes. Et je me souviens des propos de Mme Glatigny qui disait qu’elle voulait protéger, sécuriser les jeunes enseignants. Je me demande bien comment, en leur proposant des contrats d’employés. Les nominations, cela a été voulu pour permettre aux fonctionnaires d’être indépendants. C’est la volonté première. Pour éviter les pressions d’où qu’elles viennent : des politiques, des parents, des membres de la direction. La nomination a un côté protecteur ».
Un combat idéologique, c’est aussi le point de vue de Sifian. Ce metteur en scène bruxellois lance un véritable cri de révolte sur les réseaux sociaux : « Est-ce qu’on a bien conscience que nous avons été portés, pendant des décennies, par une vague de progrès, de modernisation, d’acquis sociaux que nos parents et nos grands-parents ont construits à la sueur du front, voire par le sang ? L’enseignement pour tous, les soins accessibles, la culture considérée comme un droit. Tout cela, c’était le socle. Un pays où l’on peut se soigner sans s’endetter, apprendre sans payer, créer sans mendier. Et voilà qu’aujourd’hui, on voudrait nous faire croire que tout ça est négociable et inévitable, que la santé, l’éducation et la culture ont un prix, que ce sont des dépenses à réduire. Mais non. Ce ne sont pas des coûts, ce sont des fondations. Et on est en train de nous les arracher. Alors oui, je ne vais pas être poli : on se fait voler ».
Sifian est syndiqué, chez les rouges. Ce texte, il a voulu le partager pour agiter les consciences, m’explique-t-il. Et de me montrer un communiqué rédigé par l’ensemble des représentants de son secteur, un texte où il est démontré que les travailleurs des arts, en particulier, verront leur pension amputée de 400 à 1.600 euros par mois par rapport à un travailleur d’un autre secteur. Pourquoi ? Simplement parce que, pour le calcul de la pension, ces années de travail, sous ce statut très particulier de travailleur des arts, ne sera comptabilisé qu’à concurrence de 20 % de leur carrière. Concrètement, pour une carrière complète de 45 ans sous le statut de travailleur des arts, seules 9 années seront prises en compte dans le calcul !
Une manifestation populaire
Travailleurs des arts, travailleurs du non marchand, travailleurs dans le secteur des soins de santé, malades, chômeurs… Tous impactés par les réformes annoncées par ce gouvernement. Et le citoyen l’a bien compris. Ce qui surprend ce jour dans la rue, c’est le côté cosmopolite des manifestants. Bien entendu, les affiliés aux syndicats traditionnels ont répondu en masse à l’appel de leurs instances. Vert, bleu, rouge… les trois couleurs se côtoient fraternellement. Par contre, ce qui est plus étonnant, c’est le grand nombre de manifestants descendus dans la rue mus par l’irrépressible besoin de crier leur révolte. De nombreux calicots sont rédigés aux feutres sur de simples bouts de cartons. On voit des familles entières manifester, les enfants jouant de la corne de brume encadrés par leurs parents… Et puis, il y a la présence de nombreux jeunes. Certains se regroupent autour des podiums qui diffusent de la musique techno… Les temps changent.
Près du Botanique, le cortège est ralenti à l’entrée du boulevard Pacheco. Tous les regards convergent vers un grand bâtiment gris où se trouvent de nombreux policiers et des autopompes. Des manifestants se sont retrouvés « nassés ». Ils attendent une improbable libération. La foule scande : « libérez nos camarades »… Jusque-là, la manif était bon enfant. La foule se crispe en passant devant le bâtiment dont plusieurs vitres ont été brisées. Ceux qui connaissent expliquent : « C’est le bâtiment de l’Office des étrangers ». On comprend un peu mieux. Certains manifestants ont focalisé leur colère sur la politique menée par Anneleen Van Bossuyt (N-VA), ministre de l’Asile et de la Migration. Elle qui négocie avec les Talibans le retour au pays des Afghans réfugiés en Belgique pour fuir ce régime. Comme si le gouvernement de Kaboul passerait l’éponge aux opposants ainsi renvoyés par charters entiers. Par ces quelques vitres brisées et ces tags sur les murs, ces manifestants (que de nombreux médias qualifieront de casseurs) nous rappellent qu’il y a plusieurs degrés dans la violence… Et que celle qu’on nous présente comme étant « inacceptable » cache en fait une violence qui est, elle, purement insoutenable.
C’est mon chiffre, ma bataille…
« Nous sommes plus de 100.000, camarades ! ». En passant devant un des podiums des partis politiques de l’opposition au gouvernement, le chiffre est lancé… Puis en viendront d’autres : 80.000 manifestants selon la police ; 140.000 pour les syndicats, organisateurs du rassemblement. D’autres, encore, estiment que nous étions 180.000 personnes, en ajoutant ceux qui sont restés sur les quais des gares, par manque de convois suffisants pour amener cette marée humaine à Bruxelles.
Ces chiffres sont historiques. Et pourtant, ce n’est pas une surprise. Quand l’amer monte, il est juste d’afficher son opposition…
Cet après-midi-là, à Bruxelles, la manifestation se disloque dans le plus grand calme. Au loin, des sirènes témoignent que des incidents se déroulent. Les images tourneront en boucle sur les médias mainstream. Nous, nous garderons le sentiment d’avoir partagé un moment de résistance, avec calme et fermeté.
Avant de reprendre le train, bondé, du retour, je me souviens de cet appel lancé sur les réseaux sociaux par mon amie Isabelle Loodts, journaliste de cœur et témoin de son époque… Ce sont ces quelques mots, extraits d’un long texte tout aussi inspirant, que je garderai en tête pour la suite…
« Alors oui, demain, nous serons dans la rue.
Pas seulement pour dire non.
Mais pour dire assez.
Assez des mots retournés contre nous.
Assez qu’on nous fasse croire que la solidarité coûte trop cher pendant que les profits explosent.
Assez qu’on présente la destruction du commun comme une modernisation.
Assez que la peur serve de programme politique.
Nous serons dans la rue pour dire nous,
mais aussi pour rappeler que le nous n’est pas une posture morale :
c’est un rapport de force.
Ce n’est pas en demandant poliment qu’on arrête une machine qui broie.
C’est en se mettant en travers, ensemble.
Nous ne serons pas seulement des manifestants :
nous serons la mémoire de ce qu’ils détruisent,
et la preuve que le désir de solidarité est vivant, qu’il n’a pas disparu.
Nous marcherons avec la colère de ceux qu’on a trahis,
avec la patience de ceux qui savent que le temps long finit toujours par fissurer les murs.
Nous marcherons pour reprendre le langage, le travail, les droits, la dignité,
pour remettre de la justice dans les chiffres,
du sens dans la loi,
de la vie dans la politique.
Parce que ce qu’ils appellent “réalisme”,
c’est souvent de la résignation.
Et ce qu’ils appellent “utopie”,
c’est simplement le courage d’imaginer encore.
Alors oui, demain, nous serons là —
en colère, ensemble,
non pas pour tout brûler,
mais pour rallumer ce qu’ils éteignent :
la possibilité d’un avenir juste, vivant, partagé. »