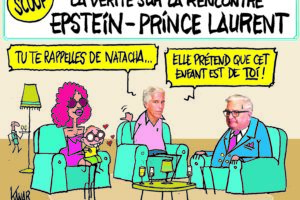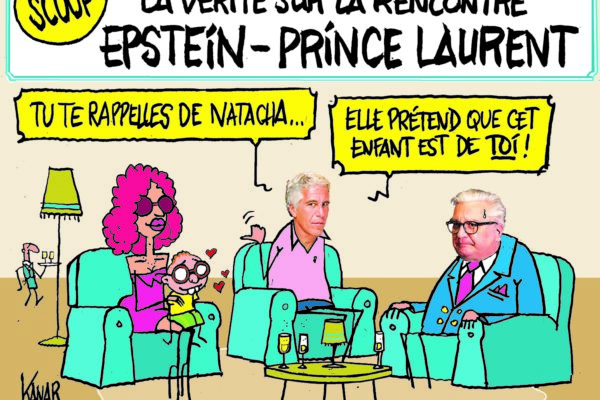Pour économiser dans les soins de santé, le gouvernement Arizona et son ministre de la Santé Franck Vandenbroucke (Vooruit) veulent réduire le remboursement de nombreux médicaments. La plupart devraient donc tous augmenter de près de deux euros mais pour certains, comme les anticholestérols, ça sera du simple au triple. Ce n’est pourtant pas la surconsommation des patients qui est en cause mais le prix exorbitant des nouveaux médicaments, négocié en secret avec l’industrie pharmaceutique.
Pour financer en 2026 ses économies de 907 millions d’euros, dont 104,5 millions d’euros d’économies dans le budget des médicaments, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) veut augmenter fortement le prix de certains médicaments. Une évidence s’impose aux yeux du ministre de la Santé : c’est la surconsommation des médicaments qui fait exploser les budgets de remboursement par l’Inami. Il vise tout particulièrement les statines (anticholestérols) mais aussi les antiacides (comme le Pantomed). C’est-à-dire, constatons-le, des médicaments liés à des pathologies dont souffrent particulièrement les personnes en situation de vulnérabilité socioéconomique… Habitué à culpabiliser le patient, le ministre a donc décidé de réduire le remboursement de ces médicaments. Plutôt que d’aller chercher des moyens en taxant les plantureux bénéfices de l’industrie pharmaceutique, ce sont, une fois encore, les patients qui supporteront les coûts de l’austérité des soins de santé.
Selon les chiffres de la mutualité socialiste Solidaris, un million de patients devront débourser entre 130 et 190 euros de plus par an pour leurs médicaments. Il faut craindre que de nombreuses personnes, parmi les plus précaires, ne doivent interrompre leur traitement pour des raisons financières. Dans son étude, Solidaris rappelle que le dérapage répété du budget médicaments est lié à l’explosion des prix exigés par l’industrie pharmaceutique : « alors que l’on pourrait récupérer près d’un milliard d’euros par an en payant le juste prix à l’industrie, le ministre choisit de faire porter l’effort prioritairement sur les patients. Cette augmentation, qui s’ajoute aux autres mesures d’économie à mettre en œuvre dans le cadre du budget 2026, représente à elle seule près de 12 % de l’effort budgétaire à réaliser. »
Pourquoi de telles hausses budgétaires ?
Ces dernières années, le budget médicaments est passé de 4 à 7 milliards, augmentant chaque année. Il s’agit de l’un des secteurs qui connaît la plus forte hausse dans le budget de l’Inami. Selon Frank Vandenbroucke, cela serait dû au gaspillage et à la surconsommation. Mais est-ce bien exact ?
Le 6 octobre dernier, le parti du Travail de Belgique (PTB), via sa cheffe de groupe au Parlement fédéral, la docteure Sofie Merckx, lançait un pavé dans la mare. Ce ne sont pas les médicaments anticholestérols les plus prescrits qui font exploser les coûts, mais les nouveaux médicaments plus onéreux. Selon l’étude du PTB, basée sur les chiffres de l’Inami, une année de traitement aux statines coûte 104 euros de remboursement par patient à la Sécu ; en revanche, le nouveau médicament anticholestérol Leqvio coûte jusqu’à 4.471 euros par patient par an à notre assurance maladie. C’est 43 fois plus cher. Ces prix élevés pèsent sur le budget des médicaments : « un quart de l’augmentation du budget consacré aux anticholestérols entre 2022 et 2023 est à imputer au seul Leqvio. En effet, si le Leqvio n’a été utilisé que par 0,17 % des patients en 2023, il représentait tout de même près de 10 % des dépenses totales en matière d’anticholestérol ».
Et, de surcroît, c’est le ministre Vandenbroucke lui-même qui autorise ces prix élevés via des accords secrets négociés avec les firmes pharmaceutiques.
Des contrats secrets ?
Le problème n’est donc pas la surconsommation des patients, mais l’utilisation de nouveaux médicaments plus chers. De surcroît, les contrats établis avec les laboratoires par chaque État sont négociés en secret afin que les autres opérateurs ignorent les prix négociés et ne proposent un prix d’achat réduit. Bien sûr, les firmes pharmaceutiques justifient leur prix par les coûts de la recherche et du développement de leurs médicaments. Pourtant, malgré les importants crédits recherches alloués par le secteur public, il est patent désormais que les prix ne correspondent plus aux coûts réels mais viennent essentiellement enrichir les actionnaires[1].
Franck Vandenbroucke est familier de ce système ; il a déjà signé plus de 120 accords secrets de ce genre. Le budget total de ces contrats s’est élevé en 2023 à 3,2 milliards d’euros, soit la moitié du budget des médicaments. En 13 ans, leur coût a été multiplié par 218 selon l’enquête du Pôle Investigation des médias du groupe IPM. Un record absolu.
Ces contrats secrets constituent un problème majeur car des milliards d’euros disparaissent de la sécurité sociale, sans aucun contrôle démocratique. L’opacité entretenue ne permet pas de connaître les prix réels des médicaments et donc n’autorise aucune évaluation correcte des politiques menées.
Alors que les multinationales pharmaceutiques réalisent des bénéfices et continuent d’absorber subventions publiques et crédits impôts, le ticket modérateur pour une boîte de statines passera de 6 à 20 euros. Il s’agit pourtant d’un enjeu de santé publique puisque ces médicaments traitent une maladie chronique. Il n’a d’ailleurs jamais été prouvé qu’un prix plus élevé entraîne une baisse de la consommation.
S’attaquer aux prix, pas aux patients
Ce manque de transparence est un choix politique. C’est pourquoi, à l’automne 2024, le PS, le PTB et Ecolo ont déposé chacun une proposition de loi au Parlement fédéral visant à modifier le cadre réglementaire concernant la justification et l’objectivité des prix des médicaments (propositions qui sont toujours en discussion). Sur base du modèle proposé par Solidaris et l’Association Internationale de la Mutualité (AIM), ces trois textes demandent d’intégrer un modèle de « fair price » – de « juste prix » – dans les négociations avec l’industrie pharmaceutique.
Devant l’opacité organisée sur les prix réels des traitements, l’objectif de ce modèle est de fixer un prix équitable et transparent pour l’État et l’industrie pharmaceutique en lui reconnaissant ses innovations thérapeutiques. Ce modèle calcule le prix du médicament sur la base des coûts de recherche, de production et de vente et garantit des marges raisonnables (fixées à minimum 8 %) à l’industrie. De plus, afin de stimuler la recherche vers les besoins non rencontrés, les médicaments innovants pourront bénéficier jusqu’à 48 % de profits[2].
Ainsi, les prix excessifs ne sont pas une fatalité. Dans son étude, Solidaris démontre que l’utilisation de ce modèle permettrait de payer, chaque année, un milliard d’euros en moins à l’industrie pharmaceutique. De plus, la transparence des prix permettrait également de lutter contre l’organisation systématique de la pénurie de certains médicaments. En effet, à l’heure actuelle, la rareté de certains médicaments place les prix très hauts. En Europe, c’est le pays où le médicament sera le plus cher ou le pays le plus offrant envers la firme pharmaceutique qui recevra, en général, des quotas plus importants. Avec comme conséquence de priver d’autres pays d’un approvisionnement suffisant.
Fixer un juste prix
Dans ce contexte, quelle place pour les médicaments génériques ? Un médicament générique est conçu à partir de la molécule d’un médicament déjà commercialisé dont le brevet est tombé dans le domaine public. Produit en plus grand nombre, il est alors bien moins cher et très rarement en pénurie. En avril 2024, la commission de la santé de la Chambre des représentants a décidé que les accords secrets seraient interrompus dès qu’une variante générique d’un médicament arrive sur le marché.
En cette matière, les Pays-Bas montrent l’exemple. Ils y appliquent le modèle kiwi, initié par la Nouvelle-Zélande. Au moyen d’appels d’offres publics, la version la moins chère d’un médicament est remboursée, afin que les médicaments restent abordables pour les patients et pour le budget de la sécurité sociale. En se basant sur les besoins des patients et non plus sur l’offre des compagnies pharmaceutiques, le modèle kiwi peut induire une baisse du prix des médicaments de 50 à 90 %.
En fixant un prix juste, trois fois plus de médicaments pourraient être remboursés pour le même budget. Le milliard d’euros à gagner serait bien plus profitable que ces 80 millions que tente d’obtenir Frank Vandenbroucke de l’industrie pharmaceutique. L’effort qui leur est demandé reste largement inéquitable comparé à la hausse du ticket modérateur et les énormes bénéfices engendrés par le secteur. Ce qui n’empêche pas l’industrie d’être particulièrement en colère et de dénoncer des ruptures de contrat propres à entraîner de nouvelles pénuries de médicaments… Bref, au prétexte que tout le monde devrait participer aux efforts budgétaires, le ministre de la Santé a réussi, à nouveau, le tour de force de se mettre tout le monde à dos.
[1] Selon le rapport 2024 de Novartis, société qui produit le Leqvio, les ventes de son produit anticholestérol ont rapporté 754 millions de dollars. La même année, ses bénéfices totaux s’élevaient à 15,8 milliards de dollars. Depuis trois décennies, ses dividendes augmentent systématiquement chaque année.
[2] Sur base de ce modèle, l’AIM a développé un « calculateur » qui permet de déterminer un prix juste pour les nouveaux traitements. Solidaris en a développé la version en français disponible sur www.lejusteprixdesmedicaments.be.