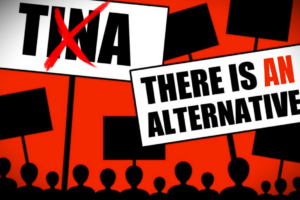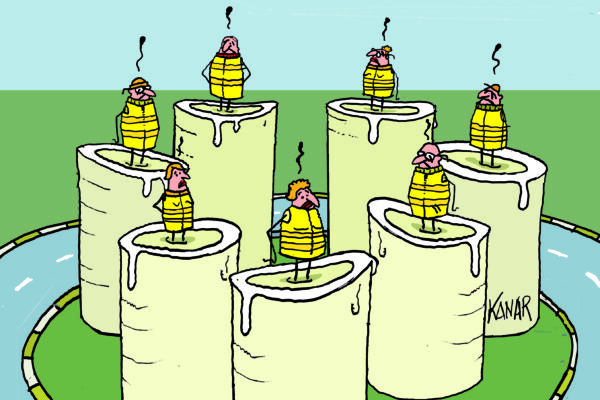La société est marquée par un déclin notable de la confiance envers l’État et les institutions politiques, économiques et sociales. Ce phénomène s’observe tant en Europe qu’à travers le monde. Dans sa dernière enquête « Baromètre social de la Wallonie » (février 2024), l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) souligne une forte baisse de la confiance dans les institutions politiques :
- Le niveau de confiance des Wallon‧nes dans l’État belge passe de 71 % en 2018 à 39 % en 2023.
- Pour les institutions politiques de la Région wallonne (Parlement et Gouvernement wallons), on passe de 69 % en 2018 à 35 % en 2023.
En Europe, la France se distingue par son niveau de confiance extrêmement faible envers la politique. Seul·es 26 % des Français‧es déclarent avoir confiance dans la politique, contre 47 % en Allemagne et 39 % en Italie.
Cette perte de confiance, qu’on rattache parfois plus largement à la « crise de la démocratie », est un phénomène documenté de longue date, qui traverse l’ensemble des démocraties majoritairement fondées sur une logique de régime représentatif.
Un élément nouveau a toutefois fait son apparition plus récemment. La montée en force de dirigeant‧es « anti-système » ou autoritaires (tels que Donald Trump aux États-Unis, Javier Milei en Argentine ou encore Giorgia Meloni en Italie) est le reflet de cette nouvelle dynamique. L’Europe est (encore) pour l’instant relativement épargnée bien que, selon la dernière étude de la Fondation « Ceci n’est pas une crise », près de 7 Belges sur 10 seraient en faveur d’un·e dirigeant·e fort·e sans contre-pouvoirs. La défiance envers l’État et les institutions se double d’une réelle remise en question du modèle démocratique en tant que tel et des institutions politiques et sociales qui le fondent[1].
Comment réagir face à l’arrivée de ces nouveaux leaders, soutenus par les oligarques de la tech (Musk, Bezos, Zuckerberg, Thiel…) dont le projet est de réduire au minimum, voire de détruire, les capacités d’action des États et renverser les démocraties ? L’un des éléments de réponse à cette question se trouve dans les services publics.
Idée reçue : la baisse de confiance s’explique par l’inefficacité des services publics
L’une des explications les plus répandues à propos du déclin de la confiance du public dans l’État et les institutions concerne l’inefficacité supposée de l’État et du secteur public : on pointe alors les lenteurs de l’administration, le nombre trop important de fonctionnaires ou la lourdeur « bureaucratique ».
Or, cette affirmation n’est pas prouvée empiriquement. Il n’existe pas de données disponibles et concluantes démontrant que l’érosion de la confiance serait liée à une baisse certaine d’efficacité (qui est en outre difficile à mesurer)[2]. Le manque d’efficacité pourrait d’ailleurs être davantage « perçu » que réellement vécu[3]…
D’autres explications sur la perte de confiance dans l’État et les institutions sont en revanche bien établies.
Facteurs expliquant la défiance du public à l’égard de l’État et des institutions
Selon une étude récente (2024) de l’OCDE sur « les déterminants de la confiance dans les institutions publiques », la baisse de confiance trouve son origine dans les doutes du public sur la responsabilité et la transparence des institutions. La population attend des dirigeant‧es qu’ils et elles soient réactif‧ves, fiables, capables de relever des défis complexes et de répondre à ses besoins et attentes.
Le sentiment d’avoir son mot à dire sur ce que font l’État et les institutions est également un facteur prépondérant sur la confiance. Ainsi, le manque d’implication dans les décisions prises a une incidence négative sur la confiance. C’est vrai au niveau européen, mais également au niveau belge : selon une enquête commandée par le G1000 en octobre 2024, 69 % des Belges déclarent avoir peu ou pas confiance dans les partis et les responsables politiques. Parmi les éléments permettant de rétablir cette confiance, est pointé le renforcement de la participation citoyenne : seule une personne sur quatre (24 %) pense que les citoyen‧nes ont suffisamment leur mot à dire sur les politiques publiques, et à peine 13 % pensent que les dirigeant·es tiennent suffisamment compte de leur opinion avant de prendre des décisions.
Plus largement, l’érosion de la confiance s’explique aussi par un bouleversement, voire un éclatement des structures et organisations traditionnelles de la société : fragmentation et désertion des organisations politiques traditionnelles (partis et syndicats), affaiblissement du clivage gauche-droite ou encore du sentiment d’appartenance à un collectif ou une classe sociale.
Le rôle-clé des communes dans la confiance du public
Les études sur la confiance mentionnées ci-dessus montrent que les autorités locales bénéficient généralement d’une plus grande confiance de la part du public que le gouvernement national ou les autorités régionales. En France, les résultats font clairement apparaître que le ou la maire de la commune dispose d’un niveau de confiance largement supérieur à tous les autres niveaux de pouvoir, en particulier le gouvernement national et le Président de la République.
Les communes sont non seulement le premier niveau de pouvoir et d’interaction avec la population mais aussi celui qui fait partie quotidiennement de la vie des citoyennes et citoyens. Justement, l’étude menée par l’OCDE souligne que les interactions courantes et satisfaisantes avec les institutions publiques contribuent à entretenir la confiance.
Comment restaurer la confiance ? Des services publics…
Précisons tout d’abord que la confiance qu’il convient de restaurer dans l’État et les institutions n’est pas une confiance absolue mais bien une confiance relative, au sens où la défiance des gouverné·es vis-à-vis des gouvernant·es est nécessaire pour contrôler démocratiquement leur action et leur réclamer des comptes[4].
L’étude de l’OCDE 2024 sur les déterminants de la confiance dans les institutions publiques aboutit à une conclusion sans ambiguïté : l’investissement dans des services publics fiables et équitables, l’amélioration de la prestation de services et la prise en compte des avis des usager·es renforcent la confiance. La confiance dans l’État et les institutions est plus grande dans les pays au sein desquels les services publics sont forts et les personnes y ont recours. Ces dernières déclarent alors être relativement satisfaites des services nationaux de santé, d’éducation et administratifs et ont confiance dans le fait que leurs demandes de services ou de prestations sont traitées en toute égalité. Il n’est donc pas surprenant de constater que la confiance est plus élevée et se maintient globalement comme telle dans les gouvernements et institutions de pays tels que la Suède, la Norvège, la Finlande et le Danemark, caractérisés par un haut degré de protection sociale conjugué à une offre importante de services publics.
… locaux et si possible, participatifs !
Si l’investissement dans les services publics constitue un élément-clé dans la restauration de la confiance, c’est particulièrement vrai pour le niveau local, qui demeure le premier point de contact avec la population. Il est donc indispensable de maintenir et de renforcer les services publics locaux, en garantissant leur accessibilité, tant physique (on pense à la présence de guichets ou bureaux physiques auxquels on peut s’adresser) qu’économique (idéalement tendre vers une forme de gratuité de certains services), à toutes et tous.
Il faudrait également assortir les services publics de mécanismes de participation pour permettre aux citoyennes et citoyens de contribuer de manière significative à la prise de décision. Évidemment, chaque service public est différent (confier son enfant à une crèche présente des enjeux différents que d’emprunter le tram ou le métro) et il faut réfléchir au cas par cas à la manière d’impliquer les citoyen·nes. Au minimum, faute de leur donner un véritable pouvoir décisionnel, il doit être possible de tenir compte de l’avis des usager·es et des suggestions émises en internes par les travailleurs et travailleuses des services publics. À défaut, le fossé de la confiance entre la population et le politique risque de se creuser encore davantage…
[1] Q. Slobodian, Le capitalisme de l’apocalypse. Ou le rêve d’un monde sans démocratie, Seuil, 2025.
[2] S. Van de Walle, S. Van Roosbroek, et G. Bouckaert, « La confiance dans le secteur public : existe-t-il des signes d’un déclin à long terme ? », Revue Internationale des Sciences Administratives, 2008, Vol. 74(1), pp. 51-70.
[3] D. Bok, The trouble with government, Cambridge MA, Harvard University Press, 2001.
[4] P. Rosanvallon, La contre-démocratie, la politique à l’âge de la défiance, Paris, Seuil, 2006.