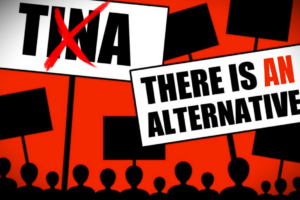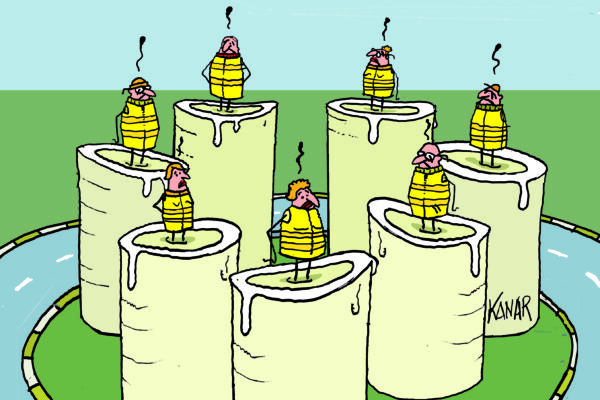Quels sont les liens, politiques, idéologiques et économiques, entre le fascisme et le grand capital ?
Dans cette seconde partie, il est question d’analyser les connivences de plus en plus évidentes entre les partis d’extrême droite et le grand capital, qui est souvent lié aux magnats des médias : certains grands groupes médiatiques ont soutenu – financièrement, par la propagande et par le travail idéologique – les fascismes historiques. Ces observations rouvrent la question du travail idéologique et culturel réalisé par les droites réactionnaires et le milieu de la finance.
Sommaire
Partie 1. Une convergence d’intérêts
1. Détruire le rôle protecteur de l’État
2. Protéger les intérêts capitalistes bourgeois
3. Éradiquer les dangereux ouvriers communistes
4. Des hommes et des partis à la manœuvre
Partie 2. Une presse au service de l’extrême droite ?
1. Détenir les médias pour travailler l’opinion publique
2. Le rôle des « libéraux autoritaires » dans l’amalgame entre « extrême gauche » et « extrême droite »
3. La peur des rouges
Il est communément admis que la propagande a joué un rôle majeur dans la victoire du fascisme dans les années 1920 et du nazisme dans les années 1930. Cette idée n’est pas fausse mais elle est souvent réduite au seul fait des partis eux-mêmes. Or, un travail idéologique beaucoup plus profond a été rendu possible par l’activité médiatique de grands groupes économiques et grâce aux financements de banquiers et d’industriels.
1. Détenir les médias pour travailler l’opinion publique
Il y a moins d’un siècle, l’union entre les nazis, les partis conservateurs et les capitaux médiatiques s’était opérée très tôt, dès le début des années 1930. L’économie avait été confiée en 1933 à un magnat des médias, Alfred Hugenberg. Après avoir diffusé massivement les idées racistes du NSDAP, Hugenberg lui avait cédé son empire médiatique (Chaupoutot 2025).
Un relativisme quant aux faits y est clairement assumé : les journaux à sensation et d’« information » incarnent une opinion qui construit le rapport au réel, une vision partiale des faits. Une nouvelle vérité est dès lors possible afin que la société fasciste puisse advenir. Cette torsion relativiste du réel rend pensable et dicible un discours qui se prétend « alternatif » et qui prend sa place au nom d’une liberté d’expression absolument idéologique et motivée par des fins politiques.
Alfred Hugenberg incarne cet idéologue d’extrême droite investissant massivement dans les médias afin d’y diffuser les thèses racistes du DNVP (parti populaire national) et du NSDAP (parti nazi). On parle couramment du « trust Hugenberg » (en allemand le « Hugenberg-Konzern »), qui intègre autant de la production cinématographique qu’une multitude de médias et même une agence de publicité. L’objectif est de former avec le parti nazi et d’autres nationalistes un « front national » afin de diffuser des idées pangermanistes et antisémites, et surtout de lutter contre la presse marxiste mais aussi libérale. L’audience dont les nazis bénéficieront grâce à l’empire médiatique de Hugenberg et à son projet d’une union des droites (intégrant les milieux patronaux) les portera au pouvoir, avec le soutien d’une publicité financée par le grand patronat.
Un autre exemple emblématique, plus récent cette fois (nous sommes au début des années 1970), est celui du Chili de Pinochet. Le journal El Mercurio, détenu par le milliardaire Augustin Edwards et soutenu par des fonds privés chiliens et américains, a activement participé au contexte de coup d’État de septembre 1973 contre Salvador Allende et à l’instauration d’une dictature militaire ultranationaliste. Les grands groupes, comme ITT (International Telephone and Telegraph) ont financé et soutenu la réaction meurtrière des militaires dirigés par Pinochet et par l’extrême droite dont les premières victimes ont été les partis de gauche et les syndicats.
2. Le rôle des « libéraux autoritaires » dans l’amalgame entre « extrême gauche » et « extrême droite »
Avant l’alliance effective de la droite avec l’extrême droite au début des années 1930 (voir le premier épisode de cet article publié le 17 mars), les libéraux autoritaires ont participé autant au discrédit de la gauche (KPD et SPD de plus en plus amalgamés) qu’à sa résistance : les mesures austéritaires des années 1930-1932 ont accentué la conflictualité sociale. C’est un paradoxe de reprocher l’agitation sociale dans le chef des communistes et des socialistes alors que cette agitation résulte de décisions politiques anti-sociales, déflationnistes et autoritaristes (recours incessant à l’article 48 qui outrepasse le pouvoir du Parlement). Ces mesures entrainent une paupérisation et une hausse du chômage qui sont l’origine de la grogne ouvrière portée par les partis sociaux-démocrates, communistes et les syndicats.
Au fondement de l’idéologie capitaliste des libéraux autoritaires, il y a le discours amalgamant « extrême gauche » et « extrême droite », qui aboutit à ostraciser la première tout en dédiabolisant la seconde. Les campagnes médiatiques discréditant les « marxistes », les « bolcheviks » ou les « communistes » (on ajouterait aujourd’hui le qualificatif réducteur de « wokistes ») furent menées par des médias détenus tantôt par des grands groupes économiques, tantôt par des soutiens avérés de l’extrême droite.
De la même manière, certains économistes « centristes », néolibéraux ou se définissant comme « anti-totalitaires » (voir le cas emblématique de Stéphane Courtois) relisent l’histoire de la violence fasciste comme le résultat d’alliances politiques qui ne seraient pas seulement le fait des fascistes et de la bourgeoisie. Le pacte germano-soviétique (1939) est souvent pris comme un cas d’alliance entre stalinisme et nazisme, alliance supposée être au fondement d’une pensée « totalitaire ». Cette lecture oblitère d’autres alliances avec certaines démocraties et d’autres faits antagonistes entre communistes et fascistes. En outre, certains considèrent que la crise politique des années 1930 résulterait de l’action des « extrêmes » qui auraient agité, de la même manière, l’échiquier politique. Autant l’extrême gauche que l’extrême droite auraient leur part de responsabilité dans le déploiement des violences extrêmes.
Ce relativisme historique et politique occulte le fait que l’extrême gauche allemande (KPD et syndicats), comme la gauche (SPD et syndicats), ont majoritairement combattu l’alliance du capital et du fascisme. Par la voie politique autant que par les armes. Elles ne se sont en outre jamais alliées avec le fascisme et l’électorat ouvrier est resté minoritairement attiré par le NSDAP, contrairement à la bourgeoisie. C’est davantage une union entre l’extrême droite, les libéraux autoritaires, la droite réactionnaire et le grand capital qui s’est opérée, bien loin du discours des « extrêmes qui convergent ».
3. La peur des rouges
Plus encore, c’est souvent par peur des revendications sociales de la gauche que les industriels se tournent vers une extrême droite qui se veut toujours très rassurante (et finalement fort peu hostile) à l’égard des marchés et de la finance. Chapoutot (2025) montre bien en quoi l’étiquette « socialiste » des nazis repose sur de la communication propagandiste visant à leurrer la classe ouvrière : les faits sont indéniablement ceux d’une économie soumise à l’entreprenariat privé, à l’inégalité économique et à l’autoritarisme propre à l’économie de guerre.
L’anticommunisme est une nette convergence entre la droite et l’extrême droite allemande des années 1930 (parfois même avec le Zentrum). C’est cette gauche, définie comme ennemie de l’ordre, que la droite qualifie de plus en plus d’« extrême gauche » lorsque cette même droite se rapproche de l’extrême droite.
Déjà chez les oligarques allemands (ces « barons ») réunis dans les derniers gouvernements de l’année 1932 (voir le premier volet de cet article déjà publié), le rapprochement s’opère dans leur discours dans la dénonciation conjointe des « marxistes » et des sociaux-démocrates pour rejeter tout parti de gauche, au profit d’une alliance avec une droite de plus en plus extrême.
Les dirigeants allemands ont bien à l’esprit l’éphémère République des conseils de Bavière (1918-1919) qui, avec l’aide de juifs progressistes, avait conféré des droits à la classe ouvrière. C’est l’accentuation du mythe judéo-bolchevique qui s’impulse à la fin des années 1910. Ce mythe structurera très profondément l’imaginaire nazi, autant anti-marxiste qu’antisémite. Il justifiera une répression politique et raciale qui s’incarnera dans les camps de concentration (avec leurs prisonniers politiques et leurs prisonniers « raciaux »).
***
Le travail idéologique s’est donc opéré autant au niveau de l’extrême droite qui, grâce à des organes de presses et à la propagande, a diffusé des idées de plus en plus radicales qu’au niveau des libéraux autoritaires, qui ont rendu possible une alliance avec cette extrême droite. La diffusion des idées s’est couplée à leur banalisation et à la possibilité de leur réalisation politique. Les mêmes conceptions économiques, la haine d’ennemis communs et la destruction de la démocratie parlementaire ont uni la réaction au point de la transformer en un appareil dirigiste et totalitaire.
Contre ces alliances, un autre travail culturel est possible, à l’instar des unités historiques construites au sein des fronts populaires (en France et en Espagne en 1936, au Chili en 1970). L’héritage de cette histoire comme de celle de l’antifascisme est absolument nécessaire en ce début de XXIe siècle ; il offre la possibilité d’étoffer nos lectures critiques des périodes passées et présentes mais aussi de contrer cet imaginaire grâce à des politiques et des prises de position claires.
Bibliographie de travail
Brissaud, Constantin. 2019. « Les extrêmes se rejoignent… ». In Le Monde Diplomatique. N°781. P. 14-15.
Chapoutot, Johann. 2020. Libres d’obéir. Le management, du nazisme à aujourd’hui. Paris : Gallimard.
Chapoutot, Johann. 2025. Les Irresponsables. Qui a porté Hitler au pouvoir ? Paris : Gallimard.
Deleuze, Gilles et Guattari, Félix 1972. Capitalisme et Schizophrénie. L’Anti-Œdipe. Paris : Minuit.
Delruelle, Edouard. 2024. « Constitution matérielle et constitution mixte. Du pouvoir constituant aux corps intermédiaire ». In Jus Politicum. N°31.
Douet, Yohann. 2024. « Poulantzas Nicos, Fascisme et dictature. La IIIe internationale face au fascisme, Paris, Maspero, 1970, 404 p. ». In Terrains Théories. N°18.
Enderlin, Nils. 2024. « Les testicules du castor : du néolibéralisme au fascisme ? » In AOC.
Foessel, Michaël. 2019. Récidive. 1938. Paris : PUF.
Geuens, Geoffrey. 2003. Tous pouvoirs confondus. Etat, Capital et Médias à l’ère de la mondialisation. Berchem : EPO.
Gramsci, Antonio. 1990. Cahiers de prison. Cahiers 14, 15, 16, 17 et 18. Paris : Gallimard.
Guérin, Daniel. 2014. Fascisme et grand capital. Montreuil : Libertalia.
Hoare, George et Sperber, Nathan. 2019. Introduction à Antonio Gramsci. Paris : La Découverte.
Krotlica, Igor. 2024. Gilles Deleuze-Félix Guattari. Une philosophie des devenirs-révolutionnaires. Paris : Amsterdam.
Offerlé, Michel. 2021. Ce qu’un patron peut faire. Une sociologie politique des patrons. Paris : Gallimard.
Plottu, Pierre et Macé, Maxime. 2024. Pop Fascisme. Comment l’extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet. Paris : Divergences.
Rzepski, Grégory. Juin 2024. « Droites en fusion ». In Le Monde Diplomatique. N°843. P.21.
Vuillard, Éric. 2017. L’Ordre du jour. Arles : Actes Sud.