Quels sont les liens, politiques, idéologiques et économiques, entre le fascisme et le grand capital ? Dans un ouvrage paru pour la première fois en 1936, l’écrivain et militant communiste libertaire français Daniel Guérin a montré les relations attestées entre, d’une part, le grand capital et, d’autre part, le fascisme mussolinien et le nazisme allemand. Le grand capital correspond aux grands propriétaires (surtout de l’industrie lourde mais aussi des grands groupes médiatiques) qui privilégient leurs intérêts économiques au détriment de l’égalité démocratique.
La croissance de l’extrême droite et la résurgence des références au fascisme historique interrogent notre compréhension présente des précédentes expériences et de leur arrivée au pouvoir (Mussolini en 1922 et Hitler en 1933). Cette première partie du dossier s’intéressera donc au contexte historique des années 1920-1930 afin de comprendre les alliances de la bourgeoisie avec le fascisme.
Sommaire
Partie 1 – Une convergence d’intérêts entre la droite et l’extrême droite
- Détruire le rôle protecteur de l’État
- Protéger les intérêts capitalistes bourgeois
- Éradiquer les dangereux ouvriers communistes
- Des hommes et des partis à la manœuvre
Partie 2 – à venir le vendredi 21 mars 2025
L’histoire se répète-t-elle ? Le développement de nouvelles formes de fascisme est-il inhérent à une certaine fatigue démocratique ? Est-il consécutif aux krashs boursiers et aux crises économiques ? Ou est-il le fruit de mesures austéritaires accentuant un déjà-là critique ? Il y aurait plutôt récidive que recommencement, selon la lecture de Michaël Foessel (2019). Le contexte politique, économique et social est totalement différent au XXIe siècle, ce qui n’empêche pas l’émergence de discours analogues, marqués de nationalisme, de désir d’autorité et de stigmatisation. Mais il est toujours capital d’étudier précisément chaque contexte historique pour en comprendre les logiques de causalité.
Les origines du fascisme des années 1930 ne sont pas celles de la recrudescence de néo-fascismes dans les années 2020, bien qu’il puisse y avoir entre les deux nostalgie et analogie – les cas de l’AFD en Allemagne et du FPÖ en Autriche sont symptomatiques à cet égard. De même, les possibilités de lutter contre cette croissance réactionnaire existent et doivent être interrogées à partir d’un travail historique et critique.
1. Détruire le rôle protecteur de l’État
On connaît le contexte de précarité économique induit par le krach boursier mondial de 1929 et l’instabilité géopolitique qui en résulte au milieu et à la fin des années 1930. Ce contexte est marqué par différents types de régimes :
- des gouvernements ouvertement fascistes (Italie et Allemagne),
- des démocraties libérales (Angleterre, Belgique, États-Unis, France),
- et des formes hybrides de communisme, de social-démocratie et de capitalisme d’État (Espagne républicaine, URSS).
On connaît moins l’austérité organisée par les gouvernements allemands de droite et de centre-droit de 1930 à 1932 qui ont joué un rôle prépondérant dans l’exacerbation d’un ressentiment nationaliste et d’une paupérisation de la population allemande.
En outre, plusieurs décisions politiques de la République de Weimar (1918-1933) ont participé à un contexte d’instabilité politique. Les dissolutions successives du Reichstag (dissolutions de l’assemblée en 1930, juillet 1932, novembre 1932), les lois d’exception (recours abondant à l’article 48 de la Constitution qui permettait au gouvernement de diriger sans l’accord du Reichstag, par le biais de décrets présidentiels, en cas d’urgence nationale immédiate), l’autorisation des Sturmabteilung (SA) ou section d’assaut et Schutzstaffel (SS) ou escadron de protection ainsi que les états d’urgence ont favorisé l’accès au pouvoir des nazis. Ce sont le « gouvernement hors-sol » de Franz Von Papen (1932, catholique de droite), avec l’appui du très réactionnaire Paul Von Hindenburg (militaire autoritaire, élu Président de la République en 1932) et du magnat des médias Alfred Hugenberg, ainsi que le gouvernement de Heinrich Brüning (1930-1931, unissant le Zentrum à la droite), pourtant opposé à Hitler, qui ont fini de mettre à genou une démocratie à coup d’austérité, de diminution des droits sociaux et de transformation de l’État social en un État subsidiant les entreprises privées (Johann Chapoutot le montre bien dans son ouvrage récent, Les Irresponsables, 2025).
Certes, la crise économique de 1929 a joué un rôle indéniable (ce que l’histoire rapide considère souvent comme une cause isolée) dans l’arrivée au pouvoir d’Hitler. Mais toute la politique libérale-conservatrice qui suivit le crash boursier a accentué la pauvreté et le ressentiment nationaliste, exacerbé quant à lui par des médias et par une propagande aux mains de grands propriétaires soucieux de faire triompher leur idéologie en même temps que leurs intérêts financiers (cf. partie 2 à venir).
On utilise le terme, a priori paradoxal, de « libéral-conservateur » à la suite de Chapoutot. Celui-ci montre en effet bien en quoi les mesures économiques antisociales et favorisant l’économie de marché des années 1930-1932 se couplent de plus en plus à un conservatisme moral, idéologique et politique : il est question, pour ces « libéraux autoritaires », de favoriser le grand capital tout en mettant à mal le fonctionnement démocratique et, surtout, le principe de redistribution sociale.
2. Protéger les intérêts économiques capitalistes bourgeois
Le fascisme n’est jamais une complète rupture avec une « démocratie pure ». L’idée que 1933 en Allemagne (ou 1922 en Italie) serait un moment de bascule absolu d’un régime à l’autre biaise la perception d’une réalité historique. Cette dernière est faite de rapprochements progressifs entre partis et personnes influentes, de soutiens politiques et économiques, d’évolutions des votes et des discours à l’égard des partis d’extrême droite.
Pour autant le fascisme et le nazisme ne sont pas non plus une « fatalité démocratique » selon une idée convenue qui circule. Que du contraire : « l’arrivée des nazis au pouvoir procéda d’un choix, d’un calcul et d’un pari. Choix des élites économiques (industriels, financiers, assureurs) et patrimoniales (rentiers, actionnaires, Besitzbürgertum – bourgeoisie possédante, en allemand) » (Chapoutot 2025 : 33-34).
On peut ainsi relever la constitution, dès 1932, du cercle Kepler qui réunit le grand patronat allemand autour du NSDAP (parti nazi) : le banquier Schacht, l’aciériste Vögler, l’armateur Helfferich ou encore le banquier Schröder. Ceux-ci n’hésitent pas à rédiger des principes et des programmes pour les nazis, dont le contenu libéral-conservateur pro-patronal est assez identique à une politique classiquement libérale. Bien avant cela, plusieurs klub patronaux avaient rendu Hitler fréquentable.
On renverra à l’excellent récit L’Ordre du jour d’Éric Vuillard (2017) qui expose la parade des industriels allemands (dont Opel, Bayer, Siemens et bien d’autres) aux côtés des nazis, leur financement du Reich et le bénéfice que certains d’entre eux ont tiré du travail forcé, voire de l’exploitation de déportés.
Ce sont bien des stratégies politiques autant que des manœuvres économiques qui poussent des dirigeants libéraux-conservateurs à se faire les alliés de l’extrême droite.
3. Éradiquer les dangereux ouvriers communistes
Cette alliance des droites trouve sa réalisation dans un renforcement du rôle du président du Reichstag et une militarisation de la répression, essentielle pour maintenir l’ordre économique et motivée par un anticommunisme commun profondément ancré.
En Allemagne plus encore qu’en Italie, une logique revancharde des magnats de l’industrie lourde s’est exprimée contre les conquêtes sociales des comités ouvriers et de soldats au lendemain de la Grande Guerre (1914-1918). Un contexte d’insurrection ouvrière s’est en effet développé dans les deux pays à la fin des années 1910, faisant vaciller l’édifice capitaliste.
Au début des années 1920, les grands industriels (allemands et italiens) étaient inquiets de l’agitation ouvrière et regrettaient les conquêtes sociales obtenues par des grèves importantes dès la fin des années 1910. Le fascisme leur offrait l’opportunité d’un retour en arrière par la répression des ouvriers, de leurs partis et syndicats.
La revanche de cette industrie lourde à la fin des années 1920 et au début des années 1930 a été rendue possible par la soumission et le recours à la violence d’extrême droite, la bourgeoisie possédante recourant notamment aux bandes fascistes « anti-bolcheviques » (des groupes paramilitaires violents agissant au nom d’un anticommunisme primaire et au nom d’un prétendu « ordre social »). On renverra à ce propos à l’article intéressant d’Ugo Palheta concernant l’opposition des groupes antifascistes à ces bandes fascistes organisées en Allemagne et en Italie.
4. Des hommes et des partis à la manœuvre
Ce sont donc des hommes politiques de la droite réactionnaire (inscrits de longue date dans le fonctionnement démocratique de la République de Weimar) qui ont poussé le NSDAP d’Hitler au pouvoir, avec le soutien de grands industriels. C’est ce qu’Antonio Gramsci, mort en 1937 dans les prisons fascistes italiennes, avait déjà relevé en pointant le fait que la bourgeoisie délègue historiquement son pouvoir politique aux forces réactionnaires (en Italie puis en Allemagne) pour préserver son hégémonie économique (Hoare et Sperber 2019 : 58-60 et Enderlin 2024).
Ce n’est pas par la voie démocratique directe que les nazis sont arrivés au pouvoir (malgré un succès électoral majeur en 1932, sans majorité parlementaire) mais par des stratégies et des coalitions des droites qui leur ont conféré de plus en plus de pouvoir. C’est bien le Président von Hindenburg qui nomme Hitler chancelier en 1933 (non le peuple allemand), alors que le score du NSDAP a baissé aux dernières élections, et tandis que le KPD (le parti communiste) a gagné du terrain. Une coalition à gauche était possible, intégrant SPD (les sociaux-démocrates) et KPD. Or, cette coalition était impensable pour les droites, motivées par un antimarxisme bien plus que par un antifascisme (et cela n’a pas vraiment changé).
***
Ce n’est donc pas en s’alliant au fascisme qu’on le combat ni en adoptant sa rhétorique. Au contraire, c’est lui offrir un terrain de développement propice sur les cendres d’une démocratie à bout de souffle. À l’inverse, c’est par la lutte politique et sociale que l’antifascisme s’est développé, avant d’être douloureusement réprimé.
Fort heureusement, l’antifascisme a hérité de cette histoire de répression et les possibilités de son organisation sont réelles aujourd’hui. Certes, le contexte semble propice à une recrudescence des extrêmes droites les plus dures, aidées par des groupes médiatiques (ce qu’on étudiera dans la seconde partie), mais le travail de mémoire et la conscience de l’histoire sont des acquis indéniables. Le contexte actuel n’est absolument pas identique sur ce point, et là est l’espoir le plus grand. Sans glorifier ce travail de mémoire (ni en faire une moralisation culpabilisante), il convient de l’actualiser pour faire prendre conscience de la nécessité du combat antifasciste au XXIe siècle.
Bibliographie
Chapoutot, Johann. 2025. Les Irresponsables. Qui a porté Hitler au pouvoir ? Paris : Gallimard.
Enderlin, Nils. 2024. « Les testicules du castor : du néolibéralisme au fascisme ? » In AOC.
Foessel, Michaël. 2019. Récidive. 1938. Paris : PUF.
Guérin, Daniel. 2014. Fascisme et grand capital. Montreuil : Libertalia.
Hoare, George et Sperber, Nathan. 2019. Introduction à Antonio Gramsci. Paris : La Découverte.
Palheta, Ugo. 2020. « Antifascisme et mouvement ouvrier dans l’entre-deux-guerres : débats stratégiques autour d’une défaite historiques ». In Mouvements. N°104.
Vuillard, Éric. 2017. L’Ordre du jour. Arles : Actes Sud.





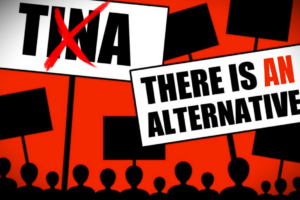


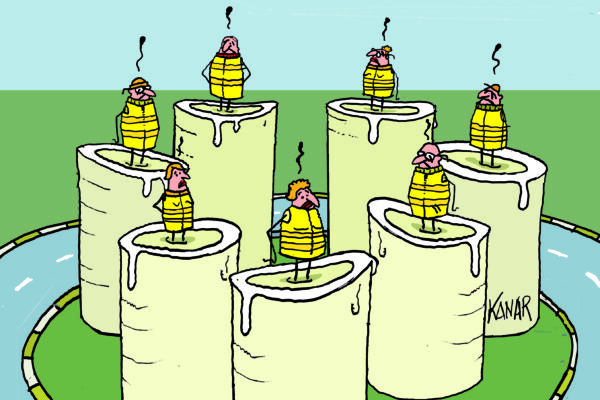
Un commentaire sur