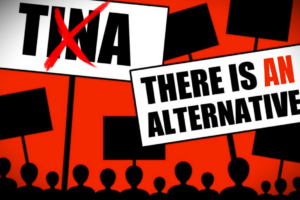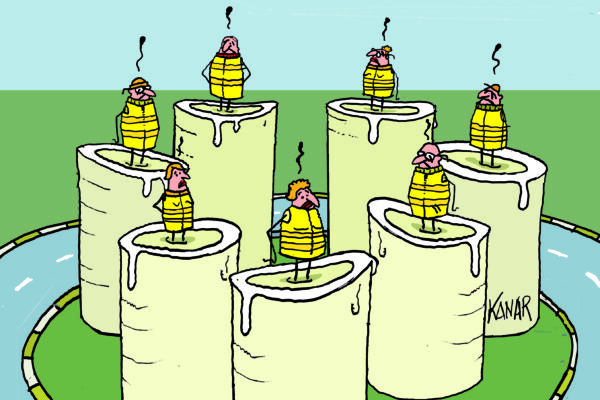Compte-rendu de Cédric Durand et Razmig Keucheyan, Comment bifurquer. Les principes de la planification écologique, Paris, Zones, 2024.
Notre époque est traversée par l’urgence écologique, au point de nous obliger à repenser en profondeur notre façon de vivre, de produire et d’organiser la société. Dans Comment bifurquer, Cédric Durand et Razmig Keucheyan proposent une réflexion ambitieuse : il ne s’agit plus simplement d’adapter le système en place, mais d’opérer une véritable bifurcation – un changement de direction radical. Pour ce faire, ils articulent deux idées centrales : la bifurcation comme moment de rupture systémique, et la planification écologique comme manière d’organiser démocratiquement nos priorités en fonction des limites planétaires.
L’escroquerie du « capitalisme vert »
Les auteurs critiquent d’abord le « capitalisme vert », qu’ils décrivent comme une illusion visant à concilier croissance économique et transition écologique, tout en préservant les logiques destructrices du capitalisme. Derrière les discours sur la consommation responsable ou les énergies renouvelables, ce sont toujours les mêmes intérêts industriels et financiers, souvent soutenus par les États, qui orientent les politiques. Pour Durand et Keucheyan, ces solutions prolongent la crise écologique en refusant d’en affronter les causes profondes : extraction illimitée, recherche de profit et exploitation du travail humain.
Ils défendent au contraire une économie écologique planifiée, capable d’anticiper les besoins à venir en fonction de critères biophysiques, plutôt que de se reposer sur le jeu aveugle des marchés (l’anarchisme du capitalisme libéralisé). Cette vision suppose de changer notre rapport au temps : il faut agir dans le présent pour structurer l’avenir, en orientant les investissements vers les besoins essentiels. La planification, loin d’être synonyme d’autoritarisme (les auteurs tiennent à distance l’imaginaire soviétique, moins celui du capitalisme d’État chinois), est ici pensée comme une coordination démocratique et collective, où les citoyens – notamment les travailleurs – participent à la définition des choix économiques majeurs. À ce titre, les auteurs mentionnent l’expérience de l’Unité populaire chilienne au début des années 1970 (sous Salvador Allende) et celle de la Suède au même moment (sous Olof Palme). Toutes deux sont des exemples de planification concertée mobilisant les travailleurs dans le processus décisionnel.06
Comment sortir du technosolutionnisme ?
Cependant, malgré leur critique du capitalisme de marché, les auteurs restent ambigus sur les fondements du système capitaliste lui-même. La question du travail, de l’exploitation salariale et de la plus-value est peu abordée, de même que les inégalités structurelles et les formes d’extractivisme néocolonial liées à la « transition verte ». De même, on ne perçoit pas bien la stratégie politique qui permettra de mener à cette bifurcation-planification. Ce qui prime dans la réflexion est le pouvoir conféré aux consommateurs, qui risquent à tout moment, si l’on suit leur modèle, de devenir des consommateurs-travailleurs ou, pire, des bénévoles. L’ouvrage tend à reconduire des instruments de gestion issus du capitalisme, comme la comptabilité, même reconfigurée autour du capital naturel. Certains passages, comme la référence aux technologies de surveillance ou aux « cybersoviets », soulèvent des réserves, en reconduisant une approche technocratique et centralisée qui peine à intégrer les conflits sociaux et les luttes écologistes locales.
En fin de compte, Comment bifurquer ouvre des pistes puissantes pour penser une économie écologique non marchande et planifiée, mais reste parfois prisonnier de logiques réformistes ou technomanagériales. La dimension politique du changement reste floue : à qui revient la tâche de porter cette bifurcation ? Quelles forces sociales sont appelées à l’incarner et quelle est la vision commune à défendre ? Le livre pose des questions essentielles, mais laisse en suspens celle du désir collectif et du sujet politique capable de rompre vraiment avec l’ordre établi. Derrière l’obsession de la comptabilité (qu’elle soit marchande ou « écologique »), on perçoit mal la manière dont les désirs, les affects et les consciences subjectives et collectives pourront opérer le pas nécessaire à cette bifurcation (qui nous apparaît comme une réelle euphémisation du principe de révolution). Il est pourtant urgent de construire de nouveaux récits collectifs misant sur l’émancipation collective, les luttes communes et le potentiel révolutionnaire à construire.