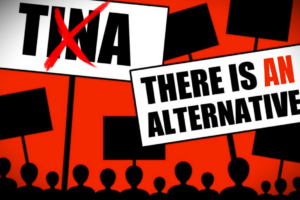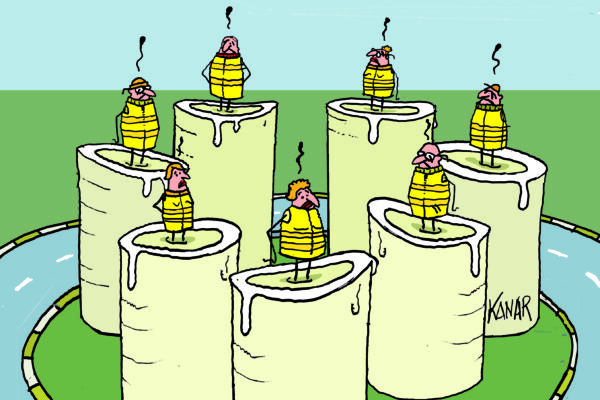Après avoir démonté l’argumentaire qui distinguerait la fraude de l’évasion fiscale la semaine dernière (rappel : il n’y a pas de distinguo), le spécialiste de l’évasion fiscale Christian Savestre revient aujourd’hui sur les montants transférés vers les paradis fiscaux depuis la Belgique et l’absence de réactions politiques et citoyennes sur le sujet.
1. Dans votre article paru en 2024 dans la revue Politique qui détaille ce que la droite ne fera pas au gouvernement – empêcher l’évasion fiscale –, vous mentionnez un montant vertigineux de 383 milliards d’euros transférés vers des paradis fiscaux en 2020. D’où provient ce chiffre, qui l’a rendu public, et pourquoi ne dispose-t-on plus aujourd’hui de données actualisées ? Le gouvernement a-t-il officiellement cessé de communiquer à ce sujet, malgré d’éventuelles interpellations parlementaires ?
383,0 milliards d’euros. De quoi s’agit-il ? Du montant des paiements des entreprises belges (au nombre de 765) vers des paradis fiscaux, effectués en 2020 et déclarés en 2021. L’équivalent de 83,2 % du PIB de l’année concernée ; en constante et vertigineuse augmentation depuis le premier montant communiqué par le Service public fédéral (SPF) Finances au titre de 2015. Vertigineux, certes ; mais pas autant que l’impossibilité pour le citoyen d’en connaître la composition, suite au rapport de la Cour des comptes du 27 juin 2022, qui s’était autosaisie de la question, considérant que « les montants considérables en jeu suscitent l’intérêt constant du Parlement et de la presse ». À ce jour, le vertige est tel que l’administration fiscale et son ministre de tutelle n’ont plus communiqué aucune donnée en la matière depuis lors ! Quid des paiements effectués en 2021, 2022, 2023 et déclarés en 2022, 2023 et 2024 ? Mystère bien gardé.
Les données communiquées par le passé provenaient du SPF Finances et étaient en général reprises chaque année par les médias mainstream sans analyses particulières, sinon celles fort sommaires fournies par l’administration fiscale. Elles mettaient en évidence que la première destination de ces règlements vers des paradis fiscaux était les Émirats Arabes Unis, considérés par les spécialistes comme le centre international de la criminalité financière.
À notre connaissance, le gouvernement n’a pas procédé à une communication indiquant qu’il ne procéderait plus à information sur cette question, mais de fait, il ne donne plus de chiffres. Il suffit de procéder à des recherches sur Internet pour s’apercevoir qu’effectivement, le gouvernement n’a pas la même opinion que la Cour des comptes quant à l’intérêt à porter aux règlements des entreprises belges vers des paradis fiscaux.
Quant aux interpellations parlementaires relatives à la disparition de cette information autrefois annuelle, nous n’en avons pas connaissance. Faut-il s’en étonner ? Non, au regard du très peu d’intérêt (c’est un euphémisme) porté par les membres de la Commission Finances & Budget au questionnaire que nous (Pour.Press et Attac Bruxelles) leur avons adressé en mars 2023.
2. Comment cette évasion fiscale se passe-t-elle concrètement ? Et quel mécanisme concret permettrait de garder cet argent, au profit d’une économie locale et d’un refinancement public, en contraignant les acteurs de cette évasion organisée ?
Ces centaines de milliards de paiements déclarés depuis 2015, qu’est-ce que ça peut bien être ? La déclaration des règlements vers des paradis fiscaux, en vigueur depuis le 1er janvier 2010 et n’ayant pas connu depuis lors de changements significatifs, est simple. Très simple même puisque les explications fournies par l’administration à propos de la nature des paiements tiennent en quelques mots : « l’objet du paiement doit être succinctement repris en indiquant par exemple : loyers, intérêts, redevances, achats de marchandises ou d’immobilisations, prestations de services, rémunérations, commissions, courtages, honoraires, etc. ».
Des loyers, intérêts, redevances, achats de marchandises ou d’immobilisations, prestations de services, rémunérations, commissions, courtages, honoraires, etc. réglés par quelques entreprises belges pour des montants représentant soit une part si importante du PIB des pays bénéficiaires, soit dépassant carrément et de beaucoup le PIB de ces pays bénéficiaires pose question ! Les sommes réglées dans ces paradis fiscaux recouvrent d’autres natures de règlements qui ne peuvent trouver leur raison d’être que dans le statut proprement dit de paradis fiscal de ces pays bénéficiaires. Cela ne veut pas dire que les autres règlements semblant correspondre à des transactions telles que définies dans la notice explicative de l’imprimé déclaratif fournie par l’administration n’aient pas à voir non plus avec les avantages fiscaux procurés par ces « pays d’accueil ».
Le peu de précisions fournies par l’administration quant à la nature des règlements effectués par les entreprises belges témoigne, c’est le moins que l’on puisse dire, du peu de curiosité manifestée par cette même administration pour comprendre et analyser le contenu de ces mouvements financiers faramineux. Cela pose d’ailleurs problème par rapport aux dizaines de milliards de corrections à la baisse apportées aux déclarations des entreprises par l’administration et validées par son ministre de tutelle : comment opérer ces corrections aux déclarations d’origine, lesquelles comportent si peu de précisions ? Comment expliquer qu’à l’issue de sa 12e année d’existence, le document déclaratif n’ait quasiment pas évolué, notamment pour la structuration des natures de paiement ? Comment l’expliquer autrement que par ce que l’on ne voudrait pas évoquer, mais qui semble s’imposer : l’absence de volonté d’y voir clair. C’est l’impuissance d’État volontaire qui caractérise ce scandale. Rien de tel pour entretenir la confusion et le doute que d’être aussi vague dans la formulation de l’exigence déclarative et de sa non-structuration ! À noter que dans ses recommandations, la Cour des comptes se tait à ce propos. Alors que ces déclarations devraient aboutir à une cartographie fort instructive de ces flux financiers, par pays destinataire, par nature de règlement, par type d’entreprise, etc., c’est l’opacité la plus complète, doublée d’incohérences apparentes, qui prévaut.
Pour.Press et Attac Bruxelles ont énormément travaillé sur la question en s’emparant de ce rapport de la Cour des comptes, en l’examinant ligne à ligne et en l’analysant dans le cadre global de la lutte (prétendue) contre l’évasion fiscale. Et c’est ainsi qu’ils s’adressaient à leurs lecteurs en septembre 2022 :
« C’est l’histoire d’un fiasco, mais pas importe quel fiasco ! Un fiasco délibéré, organisé. Depuis le 1er janvier 2010, la loi impose aux entreprises belges de déclarer leurs paiements vers des paradis fiscaux. Le citoyen lambda était alors en droit d’en attendre efficience et efficacité. Résultat ? Un silence assourdissant de 2010 à 2015. En 2016, il apprend enfin que 840 entreprises belges ont payé 82,9 milliards € en 2015 vers 30 paradis fiscaux, qui ne sont pas les plus importants parmi la centaine existant dans le monde. Et puis les chiffres s’emballent pour atteindre 288,1 milliards € en 2018, l’équivalent de 62,6 % du PIB. Pour 2019, les chiffres ne sont pas encore définitifs mais s’élèvent déjà à 265,3 milliards. Quant à 2020 le record est littéralement pulvérisé puisque l‘on atteint 383 milliards ! soit 83,2 % du PIB et les chiffres ne sont sans doute pas non plus définitifs. Pourtant le nombre d’entreprises déclarantes reste globalement stable. En-dehors des chiffres globaux, pas d’autre information ou si peu ; une sorte de black-out généralisé de l’administration, des gouvernants, des médias et de l’extrême majorité des femmes et hommes politiques. Le citoyen lambda, mais aussi contribuable lambda auxquels les politiques pétris de culture de gouvernement ne cessent d’expliquer qu’ils ne peuvent laisser à leurs petits-enfants la dette publique qui atteignait 620 milliards € fin 2021 se disent que quelque chose ne va vraiment pas puisque depuis 2010, c’est de l’ordre de 3 fois la dette publique à fin 2021 qui est partie dans 30 paradis fiscaux. Quelle somme stratosphérique atteindrait-on si cette obligation légale concernait la centaine de paradis fiscaux répertoriés sur la planète, s’appliquait aussi aux riches particuliers et ne se déclenchait pas seulement à partir de 100.000 € par an et par entreprise ? Quelle somme incommensurable atteindrait-on si cette obligation légale était en vigueur dans les autres pays, ceux de l’Union européenne, notamment ? Seul face à ses questions, ce même citoyen, en train de se demander comment il va bien pouvoir payer ses factures (d’énergie notamment), apprend que la Cour des comptes, à son initiative, a publié le 27 juin 2022 un rapport d’audit sur ces paiements vers des paradis fiscaux. Et quelle n’est pas sa stupeur quand il découvre que les réponses de la Cour des comptes aux 3 questions qu’elle s’était posées sont les suivantes :
– la réglementation relative aux paiements effectués vers les paradis fiscaux est-elle claire et cohérente ? Elle n’est ni claire, ni cohérente.
– l’administration fiscale est-elle suffisamment organisée en vue d’un contrôle efficient et efficace des paiements effectués vers les paradis fiscaux ? Elle n’est pas suffisamment organisée.
– l’obligation déclarative et sa réglementation contribuent-elles à la réalisation de l’objectif stratégique en matière de lutte contre la fraude fiscale internationale ? Elles n’y contribuent pas.
Le constat de la Cour des comptes est implacable mais ne concerne qu’une toute petite partie des très nombreuses questions auxquelles réponses devraient être fournies par qui de droit.
Vous allez ainsi pouvoir vous régaler, tout au long des 9 chapitres de cette histoire qui s’avère être une énorme supercherie : celle d’une prétendue lutte des gouvernants (7 gouvernements successifs) contre l’évasion fiscale qui ne peut avoir pour raison d’être que de vous anesthésier pour mieux vous cacher que, oui décidément, la politique économique se fait, en Belgique comme ailleurs, « à la corbeille » ! Vous découvrirez que toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres de l’Union européenne et entre les États membres de l’Union européenne et pays tiers sont interdites et permettent ainsi aux organisateurs de l’évasion fiscale, ces multinationales du fiscotrafic, de mettre en place les circuits les plus sophistiqués pour échapper à l’impôt, cependant que les gouvernants désarment leurs propres administrations fiscales nationales, à un point tel que ces organisateurs pourraient s’exclamer, à l’instar de Staline qui déclarait « le Pape, combien de divisions ? », « les Administrations fiscales, combien de divisions ? » à une différence de taille près : Staline ne conseillait pas le Pape, les fiscotrafiquants conseillent eux les gouvernants ! C’est un véritable apartheid fiscal qu’ils ont tous ensemble mis en place et vous, contribuables captifs, n’êtes pas conviés aux réunions internationales auxquelles eux participent officiellement ou en sous-main, pour mettre en place ce qu’ils dénomment la bonne gouvernance internationale. Normal, vous n’êtes pas invités à la table (de négociations). Vous faites partie du repas ! ».
3. Comment expliquez-vous le désintérêt et la relativisation des ministres des Finances successifs, sachant que ces trente dernières années le portefeuille des Finances a été aux mains de la N-VA, du CD&V, de l’Open VLD, du MR (de 1999 à 2010) et du PSC (dans les gouvernements Dehaene de 1992 à 1999) ?
Combien y a-t-il eu de ministres des Finances socialistes depuis la création de la Belgique ? Deux, je crois, qui se sont succédé dans les années 1930-1940 et dont l’un a fini collabo…
Au-delà de la Belgique, la lutte contre l’évasion fiscale n’est que discours jusqu’à présent. Et pour cause ! L’instauration de la liberté absolue de circulation des capitaux sans aucune contrepartie fiscale et sociale a ouvert les vannes de l’évasion fiscale. Lutter contre implique de remettre en cause ce qui est devenu un dogme.
À défaut de remettre ce dogme en question, il faudrait, comme l’écrit Guillaume Vuillemey dans son ouvrage « Le temps de la démondialisation, protéger les biens communs contre le libre-échange », taxer les flux financiers :
« La seule réalité tangible que peuvent saisir les autorités fiscales d’un pays sont les flux financiers entre entreprises, au moment où ils transitent d’une filiale domestique vers une filiale étrangère. Une taxe sur les flux de capitaux entre filiales d’un même groupe, ou plus largement sur les flux de capitaux entre pays, permettrait de restaurer un équilibre en reterritorialisant des capitaux qui, sinon, échappent presque complètement à l’impôt. »
4. Le désintérêt collectif pour ce type de pratique résulte-t-il d’une victoire idéologique ?
Oui, incontestablement ! Et le déploiement sémantique utilisé pour légitimer l’évasion fiscale dite légale y contribue fortement.
Les administrations fiscales nationales se gardent bien de fournir au citoyen les indicateurs qui lui permettraient de cerner les enjeux de la fiscalité et de juger de son degré de justice ou d’injustice. La batterie d’indicateurs à mettre à disposition du contribuable lambda réclamée depuis bien longtemps par Thomas Piketty n’existe toujours pas.
Par ailleurs, les mouvements citoyens qui s’intéressent à la fiscalité dans le souci de la rendre plus juste se réfugient trop souvent dans la technique et oublient bien involontairement que leurs préconisations ne vont pas s’appliquer aux contribuables mobiles, mais qu’en revanche, elles s’appliqueront aux captifs qui, dans certains cas, auront le sentiment d’être encore plus pressurés.
Enfin, le prélèvement à la source selon la terminologie française (précompte professionnel en Belgique) a des conséquences tout à fait néfastes pour ce qui est de la compréhension de l’impôt. Le salarié oublie son salaire brut, ne connaît que son net et mélange allègrement impôt et cotisations sociales ! Ce qui conduit à ce discours sur les prélèvements obligatoires si efficace pour les tenants de l’idéologie dominante. En effet, c’est l’occasion pour cette dernière de comparer abusivement entre pays, sans susciter de réaction, ces fameux prélèvements obligatoires incluant les cotisations sociales, alors que les systèmes sociaux dont ils relèvent (retraites, chômage, maladie…) sont profondément différents d’un pays à l’autre. Bref, il s’agit de comparaisons totalement biaisées, assénées comme des vérités et « acceptées » par le commun des mortels qui a oublié de quoi est constituée la différence entre son salaire brut et son salaire net.
N’oublions pas non plus la complexité souvent délibérée introduite dans la matière fiscale, qui favorise grandement ce que les experts nomment « l’ingénierie fiscale » pour ne pas l’appeler « évasion fiscale ».