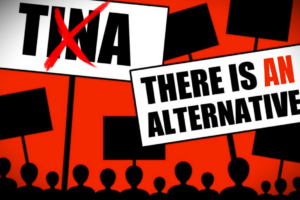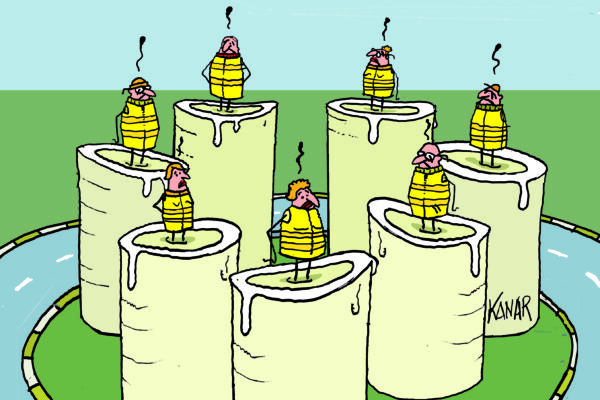Souvent annoncée mais encore jamais réalisée, la privatisation de Proximus, à travers la vente totale ou partielle des actions de l’État belge, revient à l’agenda du gouvernement Arizona. Proximus n’est pas une entreprise comme les autres. Héritière de l’ancienne régie publique Belgacom, Proximus est une entreprise publique autonome[1] qui incarne de longue date le rôle stratégique de l’État dans les télécommunications, le numérique et la cybersécurité. À l’heure où le gouvernement fédéral Arizona cherche à faire des économies et refinancer certains secteurs jugés prioritaires – comme la défense –, la question d’une vente des actifs de Proximus s’invite de nouveau à la table du Gouvernement. Cette question revêt une dimension profondément idéologique : faut-il confier davantage de leviers économiques au secteur privé ou maintenir la main publique sur des secteurs jugés essentiels ? Elle touche aussi à des enjeux très concrets : la santé financière de l’État, la compétitivité d’une entreprise dans une société fondée sur le principe de concurrence, la protection de l’emploi et la maîtrise des infrastructures stratégiques.
Pour bien comprendre ce que la privatisation impliquerait réellement, il faut revenir sur ce qu’est Proximus aujourd’hui : une entreprise hybride, à mi-chemin entre le service public et la société cotée en bourse[2].
Brève histoire de Proximus
Ancienne « Régie des télégraphes et des téléphones » (la RTT créée en 1930), l’entreprise était au départ directement gérée par l’État belge. Devenue Belgacom en 1992 dans un contexte de libéralisation européenne (c’est-à-dire d’ouverture à la concurrence), elle devient une société anonyme de droit public qui ouvre progressivement son capital au privé. En 2004, Belgacom fait son entrée en bourse mais l’État belge reste son actionnaire majoritaire. En 2015, Belgacom change de nom pour devenir Proximus dans le cadre d’une réforme d’envergure visant à rapprocher le régime qui lui est applicable de celui qui s’applique aux sociétés privées. Depuis lors, Proximus a été plusieurs fois restructurée pour s’adapter à un marché marqué par la concurrence, l’arrivée du mobile et de la fibre, et depuis peu, la montée en puissance de l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, l’État belge détient une participation de 53,51 % dans Proximus, selon les données d’actionnariat au 30 septembre 2025, faisant de lui l’actionnaire majoritaire. En ce sens, Proximus est déjà partiellement « privatisée ».
Quel est le projet du gouvernement Arizona ?
Lorsque l’État belge parle de privatiser Proximus, vendre (céder) tout ou partie de ses parts (ou actions) dans Proximus, cela recouvre à la fois une même réalité – à savoir que l’État belge se défait (de tout ou partie) de ses parts dans l’opérateur – mais qui diffère selon que l’État belge reste ou non actionnaire majoritaire dans la structure. Il pourrait être question d’une privatisation complète si l’État belge perdait son statut d’actionnaire majoritaire au profit des investisseurs privés.
La privatisation des entreprises publiques autonomes[3] ne date pas du gouvernement Arizona. Dès 2015, le gouvernement de Charles Michel avait déjà posé les bases légales d’un désengagement partiel de l’État. La loi du 16 décembre 2015[4] a en effet modifié le cadre juridique prévalant alors, en supprimant l’obligation pour l’État belge de détenir une participation majoritaire dans Proximus. Elle prévoyait également l’assouplissement de certaines règles pour les entreprises publiques actives dans des secteurs concurrentiels ainsi que l’alignement des règles de corporate governance sur celles applicables aux sociétés cotées privées.
Dix ans plus tard, le gouvernement Arizona s’inscrit ainsi dans la continuité du gouvernement Michel : il utilise le cadre juridique actuel en envisageant concrètement la vente d’actifs ou une ouverture accrue du capital de Proximus. Dans l’accord de gouvernement fédéral, il est annoncé qu’« en cas d’intérêt stratégique, [l’État belge] peut chercher à acquérir ou à conserver une participation dans des entreprises dans le but de générer ou d’organiser des stratégies industrielles, financières ou commerciales dans des domaines clés pour l’économie du pays. La présence de l’État peut prendre la forme d’une participation majoritaire ou minoritaire et s’accompagner de clauses conventionnelles ou légales permettant à l’État d’assurer le maintien du siège, des centres de décision et de l’emploi en Belgique, ou d’autres objectifs jugés pertinents en fonction de l’entreprise concernée. L’Etat gère aussi ses participations en fonction de leur rendement financier et définit sa stratégie de sortie en prenant en compte le rendement des dividendes par rapport aux taux d’emprunt auxquels il accède, ainsi que la maximisation de la plus-value réalisée lors de la cession ». Si le gouvernement actuel prévient donc qu’une privatisation plus poussée de Proximus (ou d’autres entreprises publiques) pourrait être envisagée sans entrer dans le détail, il précise toutefois qu’il va mettre sur pied un nouveau Fonds de défense financé par la vente d’actifs, avec une première tranche avant le 31 décembre 2025. Théo Francken (ministre de la Défense) n’a pas précisé de quelles participations l’État belge se déferait en premier. Proximus pourrait être l’une des entreprises visées. Son CEO Guillaume Boutin précise toutefois que, compte tenu des investissements en cours (notamment pour l’installation de la fibre optique), la vente par l’État belge de ses participations ne serait pas intéressante actuellement.
Que gagnerait l’État belge ?
Une vente de ses participations dans Proximus représenterait avant tout pour l’État belge une opération financièrement avantageuse à court terme. La vente permettrait de dégager des liquidités immédiates, utiles pour alléger la dette publique ou financer des priorités budgétaires pressantes, comme la défense. La valeur de marché de Proximus et de ses filiales en fait un actif attractif, susceptible de rapporter plusieurs centaines de millions d’euros. Cette vision est toutefois très court-termiste : plutôt que de continuer à percevoir des dividendes annuels, l’État se séparerait de sa poule aux œufs d’or.
Certains avancent que, libérée d’une certaine forme de tutelle politique et d’un carcan juridique de droit public, Proximus pourrait être « dépoussiérée », investir plus librement dans la fibre et renforcer sa compétitivité face à des acteurs internationaux plus agiles. C’est possible, quoique très incertain et ce « gain » hypothétique (pour qui ?) ne compense pas nécessairement les pertes que subirait l’État belge en cas de privatisation.
Que perdrait l’État belge ?
La privatisation de Proximus risque tout d’abord d’entraîner une perte de contrôle stratégique sur des infrastructures de réseau essentielles : réseaux de communication, fibre optique, services numériques liés à la sécurité et aux données publiques. Une diminution de la participation de l’État pourrait réduire son influence sur les décisions relatives à ces domaines sensibles, voire exposer certaines activités à des intérêts étrangers ou purement commerciaux.
L’État perdrait ensuite un levier politique conséquent : grâce à son rôle d’actionnaire majoritaire, l’État a un droit de regard sur ce qui se passe au sein des instances de décision et peut peser sur des décisions de restructuration, de perte d’emplois ou encore d’orientation plus générale (rentabilité versus service public).
Enfin, l’État perdrait une source de revenus stable. Les dividendes versés par Proximus constituent chaque année une rentrée financière non négligeable pour le budget fédéral. On parle de 3,3 milliards d’euros de dividendes depuis 2013. À terme, la privatisation pourrait coûter davantage qu’elle ne rapporte, en privant l’État d’un flux récurrent au profit d’un gain ponctuel.
Conclusion
La question de la privatisation de Proximus est une illustration non seulement de deux visions différentes de la société, mais aussi de la tension entre une logique budgétaire à court-terme et une gestion des actifs stratégiques de l’État à long terme dans un objectif de service public. Les risques pour l’État belge à ce stade (perte de contrôle sur des infrastructures essentielles, réduction des revenus futurs et impact potentiel sur l’emploi et le service public) prévalent largement sur le dégagement de liquidités qui, au surplus, sembleraient a priori investies majoritairement dans la défense plutôt que dans le secteur de la transition écologique.
[1] Au sens de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
[2] Voir le rapport annuel 2024 de Proximus (notamment p. 271).
[3] On peut également citer Bpost, la SNCB ou Skeyes (anciennement Belgocontrol).
[4] Loi du 16 décembre 2015 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, M.B., 12 janvier 2016, p. 763.