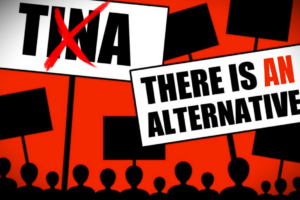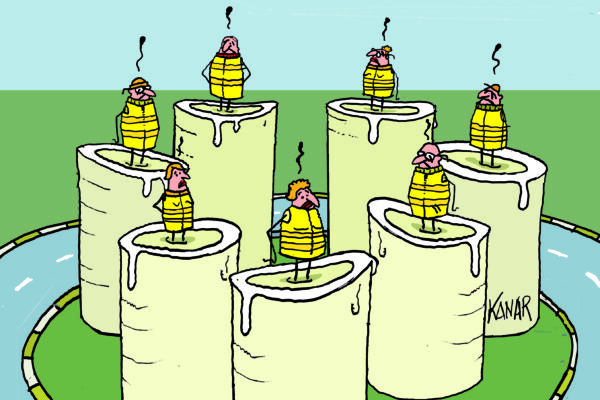Un petit tour et ça revient. En mars 2017, le ministre Van Overtveldt (N-VA) avait tenté une mise en bourse partielle de Belfius. Échec. Huit ans plus tard, c’est au tour du ministre Jan Jambon (N-VA) de demander à Belfius de préparer une cession de 20 % de son capital à des investisseurs privés. Est-ce que cela va se concrétiser cette fois-ci ? Ce n’est pas sûr. Mais cette opération est loin d’être un simple geste comptable : c’est un choix politique majeur qui touche à la souveraineté économique, à la protection des services publics et à l’orientation sociale du pays. Voici dix raisons de s’opposer à la privatisation – même partielle – de Belfius et de proposer, au contraire, son renforcement démocratique et public.
- Un processus non démocratique
Belfius est une des quatre plus grandes banques de Belgique. Elle est entièrement détenue par l’État. Belfius a en effet été acquise par l’État belge en 2011 suite à la deuxième faillite de Dexia, pour 4 milliards d’euros. Cette acquisition s’est faite via de l’argent public, c’est-à-dire celui des contribuables. Belfius doit donc être considérée comme la banque de tous les Belges. C’est d’ailleurs inscrit dans son nom : pour rappel, Belfius signifie : « Bel » pour Belgique, « Fi » pour finance, « us » pour « nous » en anglais.
La décision du gouvernement de vendre une partie du capital de Belfius a été prise sans véritable débat public ni consultation citoyenne. Une privatisation d’une telle importance devrait au minimum faire l’objet d’un large débat parlementaire. Les citoyennes et citoyens, qui ont sauvé Dexia de la faillite, à hauteur de plusieurs milliards d’euros, méritent d’avoir leur mot à dire.
2. Une vision budgétaire de très court-terme
Cette décision se fait au nom de l’urgence budgétaire : l’État cherche des leviers pour réduire la dette et financer l’explosion des dépenses militaires. L’objectif est de dégager 2 à 2,5 milliards d’euros de recettes publiques. Mais c’est une opération « one-shot », limitée à l’année 2026. Or, Belfius affiche une santé financière robuste. En 2024, la banque publique a dégagé un bénéfice net record de 1,1 milliard d’euros, tout en gérant quelque 200 milliards d’euros d’épargne et de placements, et en distribuant chaque année environ 400 millions de dividendes à son unique actionnaire : l’État belge.
Se priver de ressources financières structurelles n’a vraiment pas de sens. En cédant une part de Belfius, l’État perdrait une source stable de revenus à long terme : les dividendes. Sacrifier une rente durable pour boucher en partie un trou budgétaire sur une année, cela n’a rien de responsable dans un contexte de finances publiques déjà tendues.
Notons que c’est loin d’être la première fois que le gouvernement belge utilise cette méthode de vente du patrimoine national pour diminuer le poids de la dette. Dans les années 2000, l’État a vendu plusieurs de ses biens immobiliers afin d’augmenter ses recettes et diminuer l’endettement. Mais beaucoup de ces opérations ont été des ventes suivies de locations (opérations de « sale & lease back »), ce qui, selon la Cour des comptes, a coûté très cher à l’État sur le long terme. Par exemple, en 2002, un bâtiment administratif du quai de Willebroeck à Bruxelles, a été vendu pour 4,3 millions d’euros. Mais l’État a ensuite loué ce bâtiment pour un loyer annuel de 1,03 millions d’euros …
3. Cela ne changerait strictement rien à l’endettement du pays
La plupart des analystes estiment la valeur de la banque Belfius autour de 12 milliards. Une cession de 20 % pourrait donc rapporter jusqu’à 2,4 milliards. Mais en réalité, un investisseur négocie toujours une décote. C’est ainsi qu’on parle plutôt d’une recette équivalente à 2 milliards d’euros.
Admettons que l’entièreté de ce montant soit consacrée à la réduction de la dette publique et prenons notre calculette. La dette belge en 2024 : 675 milliards. Le PIB belge en 2024 : 642 milliards. Cela fait un ratio dette/PIB de 105,1 %. Ces deux milliards de réduction de dette feraient donc passer l’endettement de 105,1 % à 104,8 % du PIB. Cela se passe de commentaire…
Par ailleurs, vendre un actif pour réduire une dette ne modifie pas la richesse nette du pays : on remplace simplement un patrimoine (des actions) par un autre (de la trésorerie). Les agences de notation et les marchés financiers ne considèrent d’ailleurs pas ce type d’opération comme une véritable amélioration structurelle.
4. Dire non à l’augmentation massive des dépenses militaires
Cette privatisation s’inscrit dans un contexte où le gouvernement cherche à financer l’explosion des dépenses militaires imposée par l’Otan et l’Union européenne. Dès son entrée en fonction en janvier 2025, le gouvernement a annoncé que la Belgique consacrerait 2 % de son PIB au budget militaire avant la fin de la législature, soit une augmentation d’environ 5,5 milliards d’euros du budget annuel de l’armée belge. En avril 2025, l’Arizona décide de passer à 2 % du PIB dès 2025, ce qui fait 4 milliards d’euros supplémentaires à trouver immédiatement. Et il fait directement contribuer Belfius par un dividende exceptionnel supplémentaire de 500 millions d’euros. Mais la course folle à l’armement ne s’arrête pas là : à la suite du sommet de l’Otan de juin 2025, suite aux pressions de l’administration Trump, les États membres décident de faire passer les dépenses militaires de 2 % à 5 %, et ce dès 2035. Cela représenterait pour la Belgique une augmentation annuelle de 22 à 24 milliards de son budget militaire… Ahurissant et inacceptable.
Vendre une banque publique pour acheter des avions de chasse ou financer l’effort de guerre est une orientation plus que discutable. L’argent public doit servir à renforcer la justice sociale, la transition écologique et les services collectifs, pas à soutenir la militarisation de l’Europe.
5. Perte de souveraineté et impact sur l’orientation stratégique
Contrairement à 2017, il ne s’agit pas cette fois d’une mise en bourse, mais d’une cession directe à quelques grands investisseurs privés. Comme en 2017, le gouvernement tente toutefois de présenter l’opération non pas comme une privatisation, mais comme une « ouverture raisonnable » au capital privé, censée ne pas affecter l’orientation stratégique de la banque.
C’est faux. Même minoritaire, l’entrée de capitaux privés modifie profondément la gouvernance et les priorités. Qu’ils soient étrangers ou belges, les investisseurs privés chercheront avant tout à maximiser le rendement de leur participation, avec plusieurs conséquences possibles : fermeture d’agences et réduction du maillage territorial ; suppressions d’emplois et intensification du travail ; priorité donnée au versement des dividendes ; développement d’activités spéculatives au détriment du financement productif et social ; expansion du « private banking » (gestion de fortunes) au détriment des services accessibles à toutes et tous ; affaiblissement du partenariat avec les communes et le secteur public local.
Ces tendances existent déjà dans le secteur bancaire, y compris au sein de Belfius, mais l’entrée d’actionnaires privés ne ferait qu’accélérer et amplifier ces dérives.
6. Une porte ouverte à une privatisation totale
Un autre argument donné par le gouvernement est qu’il n’y a pas lieu de paniquer : on ne vend qu’une petite partie. L’État restera donc majoritaire et gardera le contrôle sur la banque. Il est permis d’en douter. L’histoire des privatisations montre qu’une ouverture partielle du capital est presque toujours le premier pas vers une privatisation complète, en Belgique comme ailleurs.
Prenons l’exemple de la banque Caisse générale d’épargne et de retraite (CGER). En 1993, l’État belge, pour « sauver la sécurité sociale » a vendu 49,9 % de ses actions au secteur privé (Fortis) en promettant que l’État resterait maître de la situation puisqu’il conservait 50 % + 1 voix. Pourtant, dès les années suivantes, de nouvelles cessions ont eu lieu : en 1997, Fortis détenait déjà 74,9 % du capital. À l’époque, le discours officiel se voulait encore apaisant : l’État, disait-on, gardait 25 % + 1 voix et donc une minorité de blocage suffisante pour influencer les décisions stratégiques. Mais en 1998, le processus s’est achevé : l’État a vendu sa participation restante et la CGER est devenue la propriété exclusive de Fortis.
Le gouvernement va-t-il nous rejouer le même scénario avec Belfius ? La question mérite d’être posée. Ce qui est présenté aujourd’hui comme une simple ouverture temporaire risque fort de devenir, demain, une privatisation complète et définitive.
7. Un État a vocation à gérer une banque
C’est un argument que l’on entend depuis des décennies : l’État n’aurait pas vocation à gérer une banque. Selon cette idée reçue, seul le secteur privé serait capable de le faire efficacement, parce qu’il serait « plus performant » et « mieux géré ». La réalité est tout autre. Depuis quarante ans, les banques privées ont démontré à quel point leur logique spéculative peut déstabiliser des économies entières et mettre en péril l’intérêt général.
Le secteur privé a d’ailleurs prouvé son incapacité à gérer les institutions financières de manière responsable. La crise financière de 2008-2009 n’a pas été causée par les pouvoirs publics, mais bien par les comportements spéculatifs et parfois criminels de grandes banques privées. Ce sont ces mêmes établissements qui ont dû être renfloués par les États, au prix de centaines de milliards d’euros et d’années d’austérité imposées aux citoyens.
L’histoire belge illustre parfaitement cette dérive. La CGER et le Crédit communal ont fonctionné pendant plus d’un siècle comme banques publiques solides, au service des ménages, des communes et de l’économie réelle – sans jamais coûter un centime au contribuable. Mais une fois privatisées, à la fin des années 1990, elles ont fusionné pour donner naissance à Dexia et Fortis. Moins de quinze ans plus tard, ces deux groupes ont explosé sous le poids de leurs propres excès, et l’État a dû intervenir massivement pour éviter leur effondrement total – aux frais du contribuable.
C’est donc l’inverse du discours dominant qui est vrai : une banque est trop importante pour être laissée aux mains du privé. Contrairement à ce que prétendent les partisans du tout-marché, l’État peut et doit gérer une banque, car il est le seul acteur capable de placer la stabilité économique et l’intérêt collectif au-dessus du profit immédiat.
8. Nous avons besoin d’une banque publique
Les crises financières successives – de 2008 à aujourd’hui – ont montré à quel point le secteur bancaire privé est instable, spéculatif et déconnecté de l’économie réelle. Une banque publique solide comme Belfius constitue donc un véritable atout collectif. Une banque publique peut évidemment offrir les mêmes services qu’une banque privée – comptes, épargne, crédits, cartes, gestion en ligne – mais sa finalité est différente. Si elle doit rester rentable pour garantir sa pérennité, elle n’a pas à maximiser le rendement pour des actionnaires. Elle peut décider de mettre la rentabilité au second plan, de refuser la spéculation, et jouer un rôle stabilisateur et social, en soutenant les investissements publics, la transition écologique et les besoins des citoyens.
Belfius gère aujourd’hui environ 200 milliards d’euros d’épargne et de placements et dispose d’un encours de crédits d’environ 120 milliards d’euros. Selon les choix d’orientation, ces montants peuvent soutenir les projets locaux, les communes, la rénovation énergétique ou, au contraire, être dirigés vers la spéculation et les profits rapides. C’est précisément pourquoi le contrôle public sur cette banque est un enjeu stratégique majeur. Vendre Belfius, c’est abandonner ce pouvoir de décision à des acteurs privés et perdre la capacité de piloter démocratiquement l’orientation du crédit au service de l’intérêt général.
Ajoutons que contrairement à une idée répandue, de nombreux pays réputés « libéraux » comme l’Allemagne, la Suisse ou le Luxembourg disposent d’un secteur bancaire public et coopératif beaucoup plus développé qu’en Belgique. Et ces institutions ont par ailleurs montré une plus grande résilience face aux crises.
9. C’est l’inverse qu’il faut faire : socialiser Belfius
Belfius n’est pas une entreprise comme les autres. Avec ses 6.500 salariés, ses millions de clients particuliers et ses liens historiques avec les communes, elle joue un rôle central dans le financement de l’économie belge. Pourtant, bien que 100 % des actions soient détenues par l’État, Belfius n’est pas véritablement une banque publique. À sa création, elle a reçu le statut de société anonyme de droit privé, avec pour mission principale la recherche de rentabilité maximale.
Cela ne signifie pas que tout est négatif dans sa gestion. Belfius reste plus inclusive que ses concurrentes privées : elle offre les services bancaires de base les plus accessibles, permet encore l’impression des extraits de compte et propose une gamme de produits sociaux destinés aux institutions à finalité sociale. Mais, hors de ces activités, elle se comporte comme une banque privée lucrative : priorité donnée au « private banking », financement de projets écologiquement discutables, restructurations et licenciements pour maximiser la rentabilité, fermeture d’agences.
Face à ce constat, il existe une alternative claire à la privatisation ou au modèle actuel : socialiser Belfius. Deux axes principaux devraient guider cette transformation :
Changer son statut et lui donner une mission de service public
Tout en assurant sa viabilité et sa stabilité, il faut donner à Belfius une mission de service public pour qu’elle serve durablement l’intérêt général notamment en :
- développant les investissements dans les services publics et les projets écologiquement responsables ;
- facilitant l’accès au crédit pour les PME et TPE ;
- garantissant un service bancaire accessible et de qualité à toutes et tous ;
- offrant aux épargnants un lieu sûr pour placer leur argent sans spéculation et au service de la collectivité.
- Démocratiser son fonctionnement
La gouvernance de Belfius reste loin du contrôle parlementaire et du débat public depuis sa nationalisation. Les différents acteurs concernés – usagers, employés, communes, entreprises – n’ont aucune représentation effective dans les décisions. Il est donc essentiel de mettre la banque sous contrôle démocratique, en intégrant tous les intérêts de la société à sa gouvernance.
10. Réguler le secteur privé et avancer vers un pôle bancaire public
La privatisation de Belfius irait à contre-courant de ce qu’il faut faire pour éviter de nouvelles crises. Après des décennies de dérégulation, de privatisations et de crises financières, il est temps d’admettre que les grandes banques privées jouent un rôle néfaste pour nos sociétés. En effet, leur activité principale ne consiste pas à financer l’économie réelle mais bien à organiser des opérations financières hautement spéculatives afin de générer un maximum de profits. De plus, lorsque les bulles spéculatives qu’elles ont créées explosent, elles mettent en danger tout le système économique et social.
Il ne s’agit donc pas seulement de protéger Belfius mais de construire un système bancaire cohérent et au service de l’intérêt général. Pour ce faire, il faudrait donc avancer dans deux directions.
Premièrement, encadrer le secteur privé afin qu’il joue véritablement son rôle : financer l’économie réelle et un développement économique socialement juste et écologiquement viable. Cela passe notamment par l’interdiction de certaines opérations spéculatives jugées à risque, l’interdiction pour les banques d’avoir des relations avec les paradis fiscaux, la levée du secret bancaire pour plus de transparence ; la taxation des banques et des transactions financières pour financer les services publics et réduire les inégalités.
Deuxièmement, créer un pôle bancaire public. Il faut avancer vers un équilibre entre un secteur public fort, un secteur coopératif dynamique et un secteur privé beaucoup plus petit et beaucoup mieux encadré. Rappelons que la monnaie, le crédit, l’épargne, les systèmes de paiement sont des éléments fondamentaux d’une économie et, à ce titre, relèvent de l’intérêt général.