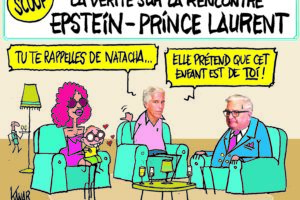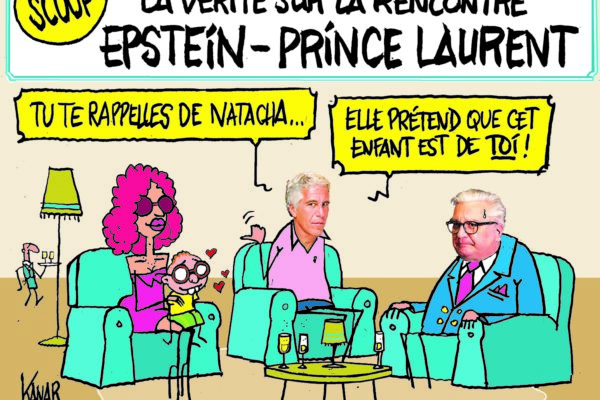À Bruxelles, la conjoncture économique actuelle est spécifique à plus d’un titre. Notamment, parce qu’elle n’est pas expliquée par les évolutions des 12-15 derniers mois mais bien par celles des 5 dernières années (2020-2025). Durant cette période, le chômage et l’emploi ont subi des transformations majeures qui redessinent le paysage socioéconomique bruxellois. Pour mieux en comprendre les causes et effets, MaTribune.be s’est entretenu avec Stéphane Thys, directeur de view.brussels, l’Observatoire bruxellois de l’emploi et de la formation.
- Comment a évolué le marché de l’emploi à Bruxelles au cours des cinq dernières années ?
Le marché de l’emploi bruxellois a traversé une période de fortes turbulences entre 2020 et 2025. De la crise du Covid-19 à la réélection de Donald Trump en passant par l’invasion de l’Ukraine et la phase inflationniste, les facteurs d’incertitude et de perturbation se sont succédé à un rythme soutenu sur fond de « crises budgétaires ».
Après une phase de paralysie liée à la crise sanitaire, on a observé un rebond en 2021 et 2022, avec une reprise partielle de l’activité et une hausse des recrutements dans plusieurs secteurs. Cependant, cette dynamique s’est essoufflée dès 2023, laissant place à une dégradation progressive : le chômage est en hausse, l’emploi stagne ou recule, et les offres d’emploi se font plus rares. Pendant la pandémie, le nombre de faillites avait fortement diminué grâce aux mesures de soutien aux entreprises et au moratoire temporaire sur les procédures de faillite. Mais cette tendance s’est inversée dès 2022, avec une forte augmentation des faillites, suivie d’un léger recul en 2023. En 2024, la hausse a repris, s’accélérant encore en 2025, notamment dans les secteurs du commerce, de la construction et de l’Horeca.
Cette évolution s’inscrit dans un contexte national marqué par des perturbations similaires dans les trois Régions du pays – Bruxelles, Wallonie et Flandre – bien que les effets aient varié en intensité selon les territoires. Toutes ont connu une paralysie en 2020, suivie d’une reprise en 2021. Mais dès 2023, les signes d’essoufflement se sont généralisés : raréfaction des offres, hausse du chômage et recrudescence des faillites.
1.1. Quels sont les principaux facteurs qui expliquent cette baisse de l’emploi ?
Plusieurs facteurs se conjuguent pour expliquer cette contraction. Tout d’abord, le contexte économique général est particulièrement défavorable. La croissance du PIB belge, qui était très dynamique en 2021 (+6,2 %), a fortement ralenti pour atteindre à peine +1,0 % en 2025. Cette perte de vitesse économique se reflète directement sur le marché du travail. En Région bruxelloise, le nombre de postes vacants a fortement diminué (-5,0 % en 2023, -9,3 % en 2024, et encore -9,1 % sur le premier semestre 2025). Par ailleurs, les faillites d’entreprises se sont multipliées, entraînant une hausse spectaculaire des pertes d’emploi : +76 % sur les huit premiers mois de 2025 par rapport à la même période en 2024.
Ensuite, il faut souligner le climat d’attentisme qui règne dans le secteur privé. L’incertitude politique en Région bruxelloise freine les décisions d’investissement et les embauches. Le secteur de la construction est particulièrement touché, notamment depuis l’arrêt des primes Renolution[1], qui a fortement impacté l’activité et les perspectives d’emploi.
Enfin, le ralentissement des recrutements dans le secteur public et l’associatif est également un élément d’explication. Les administrations bruxelloises ont réduit leurs engagements, avec une baisse de 33 % des recrutements entre 2023 et 2024.
Du côté des ASBL du secteur social et culturel, la situation est encore plus préoccupante : elles sont plongées dans une précarité et une instabilité budgétaire, aggravée par l’absence prolongée de nouvel exécutif régional ; difficile dans ces conditions de sécuriser les emplois ou de pérenniser les projets. En conséquence, elles réduisent leurs recrutements, quand elles ne sont pas contraintes de licencier.
1.2. Quel a été l’impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché du travail en Région bruxelloise ?
La crise du Covid-19 a marqué un tournant pour le marché du travail bruxellois. Après plusieurs années de croissance, l’année 2020 a brutalement interrompu cette dynamique. L’emploi a légèrement reculé, mais les dispositifs de soutien comme le chômage temporaire ou le droit-passerelle ont permis d’éviter une catastrophe sociale de grande ampleur. Grâce à ces mesures, la hausse du chômage est restée contenue et les faillites ont même diminué cette année-là, contrairement aux craintes initiales.
Dès 2021, l’économie a redémarré et l’emploi intérieur a connu une croissance importante pendant deux années consécutives. Cette relance s’explique par un effet de rattrapage post-Covid et une forte demande en main-d’œuvre. En 2022, Bruxelles a enregistré une hausse de près de 40.000 emplois, confirmant une dynamique positive malgré un contexte énergétique difficile. Mais à partir de 2023, les effets du rattrapage se sont essoufflés. L’inflation, la crise énergétique et les incertitudes économiques ont freiné l’activité. En 2024, on observe une nouvelle baisse du nombre d’emplois à Bruxelles, avec plus de 14.000 postes perdus en deux ans. Cette tendance contraste avec les autres régions du pays, qui ont continué à enregistrer des hausses.
Sur la dernière décennie, les trajectoires régionales sont très différenciées. Bruxelles affiche une progression notable sur le long terme (+14 % depuis 2014), mais cette tendance positive masque une fragilité récente avec une réduction marquée de l’emploi ces deux dernières années. À l’inverse, la Wallonie présente une évolution plus régulière et résiliente : elle enregistre une hausse de 3,1 % entre 2023 et 2024, soit environ 38.000 emplois supplémentaires, et une croissance de +9,7 % sur dix ans, confirmant une dynamique positive malgré les crises. La Flandre, quant à elle, connaît une progression modérée à court terme (+0,1 % entre 2023 et 2024), mais une hausse significative sur dix ans (+11,2 %), consolidant sa position dominante en volume d’emplois.
1.3. Comment a évolué le nombre de demandeuses et demandeurs d’emploi ?
Il a évolué en dents de scie. En 2020, il a augmenté, mais de manière limitée grâce aux aides. En 2021, il est resté stable. En 2022, il a même diminué… mais cette baisse masquait une détérioration progressive. À partir du second semestre, les inscriptions ont augmenté, notamment chez les jeunes. En 2023 et 2024, le nombre de demandeuses et demandeurs d’emploi est reparti à la hausse, atteignant plus de 91.000 personnes. Fin septembre 2025, on enregistre près de 95.000 demandeurs d’emploi inoccupés. Cette hausse est liée à la conjoncture économique, mais aussi à des phénomènes sociaux comme l’arrivée de jeunes diplômés qui ont prolongé leurs études durant la crise sanitaire ou encore de l’inscription des chercheurs d’emploi ukrainiens ; on observe des hausses de 1.000 à 2.000 jeunes diplômés et d’environ 2.500 pour les chercheurs d’emploi de nationalité ukrainienne.
1.4. Peut-on parler d’une transformation structurelle du marché de l’emploi ?
Oui, clairement. Le marché ne se contente plus de réagir à des chocs ponctuels. On s’installe dans une nouvelle réalité marquée par une fragilisation durable de certains secteurs, une instabilité politique et budgétaire, et une difficulté croissante à sécuriser les parcours professionnels. Les offres d’emploi enregistrées par les services publics de l’emploi (SPE) en sont un bon indicateur : leur volume diminue, traduisant une raréfaction des opportunités d’insertion. Les exercices de prévision et d’anticipation deviennent de plus en plus difficiles et aléatoires, et pas uniquement en raison des multiples et futurs changements consécutifs au développement de l’intelligence artificielle dans le monde du travail.
- 2. Quelles sont les particularités du marché de l’emploi à Bruxelles en lien avec les profils de la population et les enjeux urbains ?
Le marché du travail bruxellois est fortement marqué par la tertiarisation de son économie. Les services dominent largement l’activité, avec une concentration d’emplois dans les secteurs publics, financiers, scientifiques et technologiques. Cette configuration sectorielle attire des profils hautement qualifiés : en 2024, près des deux tiers des emplois à Bruxelles étaient occupés par des personnes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur. Avec diverses conséquences comme la forte attractivité extrarégionale pour les emplois bruxellois et un marché de l’emploi hautement concurrentiel sur lequel les phénomènes de surqualification à l’embauche ne sont pas rares, autant que ceux de déqualification susceptible d’en résulter.
Depuis plus de 40 ans, le marché de l’emploi bruxellois se caractérise par une forme de dualisation et de ségrégation socioterritoriale marquée.
Il existe un décalage important entre les exigences du marché du travail et les compétences de la population résidente. Bruxelles présente une polarisation marquée des niveaux de diplôme, avec une cohabitation de personnes très qualifiées et de personnes très faiblement qualifiées. Ce déséquilibre structurel s’est développé à la suite de la désindustrialisation progressive de la région. Historiquement, l’industrie offrait des débouchés accessibles aux personnes peu qualifiées. Or, avec la disparition de ces activités, ces opportunités se sont réduites, laissant une partie de la population sans perspective professionnelle adaptée. Ce phénomène a renforcé la vulnérabilité des travailleurs peu qualifiés, qui peinent à s’insérer dans les secteurs du tertiaire, de plus en plus exigeants en termes de formation ou n’offrant que des emplois de soutien souvent assortis de médiocres conditions de travail et/ou d’emploi. Le tiers des demandeurs d’emploi bruxellois sont des ouvriers et des ouvrières, soit une surreprésentation manifeste on regard de l’offre disponible.
Les discours sur les pénuries de main-d’œuvre ont tendance à occulter le fait que le chômage résulte fondamentalement d’une insuffisance d’emplois disponibles pour l’ensemble du spectre des qualifications. Si la formation peut remédier en partie à ce déséquilibre, elle n’engendre pas automatiquement la création d’emplois. Si le niveau de qualification de la population active n’a cessé de croître ces dernières années, celui des exigences à l’embauche a augmenté également.
Si près des deux tiers des emplois bruxellois exigent un diplôme de l’enseignement supérieur, plus de 60 % des demandeuses et demandeurs d’emploi n’en dispose pas, ou du moins ne dispose pas d’un diplôme reconnu. En raison de l’intensité et de l’importance des flux migratoires en région de Bruxelles-capitale, la problématique de la reconnaissance des diplômes obtenu à l’étranger est récurrente, de même que celle de la discrimination ethnique à l’embauche, qui touche aussi bien les primo-migrants que les populations d’origine étrangère nées en Belgique.
- 3. Comment le cadre institutionnel de la Région affecte la situation de l’emploi à Bruxelles ?
À Bruxelles, les dynamiques de l’emploi et du chômage ne peuvent être comprises uniquement à travers le prisme des politiques socioéconomiques classiques. Elles sont profondément conditionnées par des facteurs relevant d’autres sphères de compétences, comme la mobilité, le logement, l’éducation ou encore l’aménagement du territoire. Ces politiques façonnent de différentes manières le profil de la population active et les conditions d’accès à l’emploi.
3.1. Comment l’exode urbain a affecté la situation socioéconomique de Bruxelles ?
L’exode urbain continu, marqué par la suburbanisation des classes moyennes, a modifié le profil de la population active résidente. Motivés par l’accès à la propriété, les jeunes (+/- 35 ans) actifs occupés quittent Bruxelles pour des contrées souvent plus vertes. Parallèlement, les politiques de lutte contre les fractures urbaines peinent à enrayer les logiques de ségrégation spatiale et sociale, qui alimentent des contextes d’exclusion et de non-participation à la vie active. À cela s’ajoutent des leviers fédéraux – comme la fiscalité, la sécurité sociale ou les politiques de l’emploi – qui influencent directement les marges de manœuvre régionales, par exemple en termes d’amélioration de la qualité de l’emploi. Ainsi, le marché du travail bruxellois se trouve à l’intersection de multiples dynamiques structurelles, territoriales et institutionnelles, rendant toute action publique nécessairement multidimensionnelle et complexe.
L’exode urbain des classes moyennes s’inscrit dans un mouvement long et dans un ensemble plus large de dynamiques structurelles. Il accentue le fossé entre la richesse produite dans la capitale et la situation socioéconomique de ses habitants. Pour maintenir les travailleuses et les travailleurs bruxellois dans la région, il faut une politique du logement adaptée à la réalité de leurs revenus.
Pour prolonger sur l’exemple du logement, on sait que les ménages qui quittent Bruxelles sont généralement d’un niveau d’étude moyen ou supérieur et bénéficient d’un emploi stable. En changeant de lieu de résidence sans changer de lieu de travail, l’impact est double. Au niveau fiscal, l’impôt sur les personnes physiques sera perçu par la région de résidence et au niveau de la réalité socioéconomique, puisqu’ils participeront au taux d’emploi de la région dans laquelle ils vivent et non pas dans celle où ils travaillent.
La suburbanisation laisse derrière elle une population plus jeune, plus précaire, souvent moins qualifiée. Cette évolution démographique contribue à faire baisser mécaniquement le taux d’emploi des Bruxellois, indépendamment de la création réelle d’emplois dans la Région.
On pourrait également parler des politiques de mobilité qui ne sont pas sans influence sur les possibilités d’accès à l’emploi.
3.2. On parle souvent du taux d’emploi, mais qu’en est-il de la qualité de l’emploi à Bruxelles ?
La question de la qualité de l’emploi constitue un bel exemple de la connexion entre le niveau fédéral et les priorités régionales. En effet, la situation institutionnelle particulière de la Région de Bruxelles-Capitale complexifie la mise en œuvre d’une politique cohérente en matière d’emploi, notamment sur cette thématique pourtant jugée centrale par le Gouvernement bruxellois dans sa Déclaration de politique régionale 2019-2024. Ce dernier avait exprimé la volonté de mettre en place un monitoring de cette qualité de l’emploi à Bruxelles. View.brussels l’a mis en place.
Cela montre bien que l’enjeu ne se limite pas à créer des emplois, mais aussi à garantir qu’ils soient durables, décents et porteurs de perspectives. Augmenter le taux d’emploi sans détériorer la qualité des emplois et les conditions de travail reste un défi majeur dans le contexte actuel.
- 4. Le gouvernement fédéral Arizona a décidé d’une réforme de limitation des allocations de chômage. Les premières exclusions du chômage sont attendues dès janvier. Que va-t-il se passer à Bruxelles ?
4.1. Quel est l’impact selon les communes ?
L’impact de la réforme ne sera pas homogène sur le territoire bruxellois. Toutes les communes seront fortement impactées, mais certaines encore plus que d’autres. En effet, si l’on rapporte les chiffres des fins de droit à la population totale âgée de 18 à 64 ans, cela représente 5,1 % des Bruxellois, soit 1 personnes sur 20 qui sera impactée par cette mesure. Des écarts importants apparaissent entre communes : à Molenbeek-Saint-Jean, 6,8 % de la population adulte serait concernée, contre 2,6 % à Woluwe-Saint-Pierre. Bien que toutes les communes de la région soient fortement impactées, ces différences traduisent une vulnérabilité accrue dans les communes du croissant pauvre, où la précarité est plus forte. La proportion des personnes qui retrouveront de l’emploi variera aussi sensiblement d’une commune à l’autre.
La fin des droits aux allocations de chômage pour plusieurs milliers de personnes risque de provoquer un report massif vers les CPAS, qui devront absorber ce nouveau flux de demandeurs. L’impact sera loin d’être uniforme : certaines communes verront leur charge augmenter de manière significative, avec un afflux de bénéficiaires bien supérieur à leur volume habituel, alors que d’autres seraient relativement moins touchées. Dans tous les cas, le choc sera violent.
4.2. Quel est le profil des chercheurs d’emploi ciblés par la fin de droit ?
Les personnes les plus concernées sont souvent en situation de chômage de longue durée, avec des parcours professionnels discontinus ou interrompus. Parmi eux, les seniors sont particulièrement exposés. Ils cumulent plusieurs facteurs de vulnérabilité : âge avancé, durée d’inactivité prolongée, faible qualification ou « compétences obsolètes ».
La réforme cible principalement des personnes qui ont accumulé entre 2 et 20 ans de chômage complet au cours de leur carrière. Sur le plan du profil sociodémographique, ces chercheurs d’emploi en fin de droits sont en moyenne plus âgés que l’ensemble des inscrits chez Actiris. Parmi cette population, les personnes de plus de 50 ans sont majoritairement peu qualifiées ou sans diplôme reconnu, alors que celles âgées de 25 à 49 ans disposent plus souvent d’un diplôme. La majorité des personnes concernées est de nationalité belge.
En Région de Bruxelles-Capitale, les hommes sont surreprésentés parmi les personnes en fin de droit (55 % contre 45 % de femmes). Cette répartition varie aussi selon les communes : à Watermael-Boitsfort, les femmes représentent 56 % des personnes concernées, contre seulement 42 % à Bruxelles-Ville. Globalement, les hommes sont plus nombreux dans les communes précarisées, tandis que les femmes le sont dans les communes plus aisées. En parallèle, on observe que, au sein de cette population, les femmes sont plus diplômées que les hommes.
La situation familiale accentue encore les contrastes. Les femmes sont plus souvent sous le statut de cohabitantes ou cheffes de ménage, tandis que les hommes sont plus fréquemment isolés. Or, le revenu d’intégration sociale est moins garanti pour les cohabitants, ce qui pourrait entraîner une précarisation plus forte pour les femmes, voire un glissement plus marqué vers l’inactivité.
4.3. Quelles sont les possibilités pour les chômeuses et chômeurs de longue durée bruxellois de retrouver un emploi ? Cela relève-t-il de leur seule adaptabilité ?
Les chances de retour à l’emploi pour les personnes en fin de droit sont faibles. Plus une personne est éloignée du marché du travail de manière durable, plus il est difficile pour elle de retrouver un emploi. Si la durée de chômage est un marqueur central dans les probabilités de retrouver un emploi, l’âge avancé et le faible niveau de qualification sont autant de facteurs qui pèsent négativement sur les perspectives d’insertion. De nombreuses études ont démontré que la durée de chômage fonctionnait comme un stigmate générateur d’a priori négatifs chez nombre d’employeurs qui perçoivent la longueur de la durée de chômage comme un indice de perte d’employabilité.
Les pratiques de recrutement jouent donc un rôle important dans la persistance du chômage de longue durée. Les entreprises sont souvent réticentes à embaucher des profils jugés peu employables, en particulier les seniors. Ces derniers sont fréquemment perçus par les recruteurs comme moins adaptables, moins dynamiques ou trop coûteux, ce qui alimente potentiellement des discriminations à l’embauche. Nous avons calculé que pour un chômeur de plus de 55 ans avec plus de 2 ans de chômage, la probabilité de retrouver un emploi était inférieure à 5 %…
Sans mesures incitatives spécifiques et un accompagnement adapté de la part des pouvoirs publics, ces personnes risquent de rester durablement exclues du marché du travail. La recherche d’un travail sera d’autant plus difficile que cette réforme risque d’accentuer la pression sur le marché du travail. La concurrence accrue entre chercheurs d’emploi pourrait alors réduire davantage les opportunités d’insertion professionnelle pour des personnes déjà en difficulté surtout dans une période de conjoncture défavorable. De plus, la multiplication des flexi-jobs et du travail étudiant est également de nature à intensifier la concurrence (faussée) dans leurs recherches d’emploi.
Avec l’accumulation de ces obstacles, l’adaptabilité des chercheurs d’emploi ne peut donc jouer qu’un rôle secondaire dans leur chance d’insertion vers l’emploi, du moins pour un nombre significatif. Pour que cette réforme soutienne une croissance du taux d’emploi, il faudra non seulement investir significativement dans la formation mais il faudra également que les employeurs modifient leur regard et leur jugement sur les chômeurs de longue durée.
[1] Les primes Renolution sont un dispositif d’aides financières de la Région de Bruxelles-Capitale destiné à soutenir les travaux de rénovation et d’économie d’énergie dans les bâtiments résidentiels situés sur son territoire. Elles sont actuellement suspendues faute de budget et de gouvernement bruxellois.