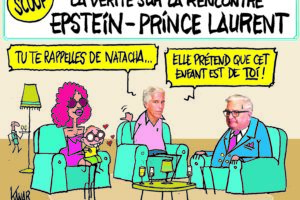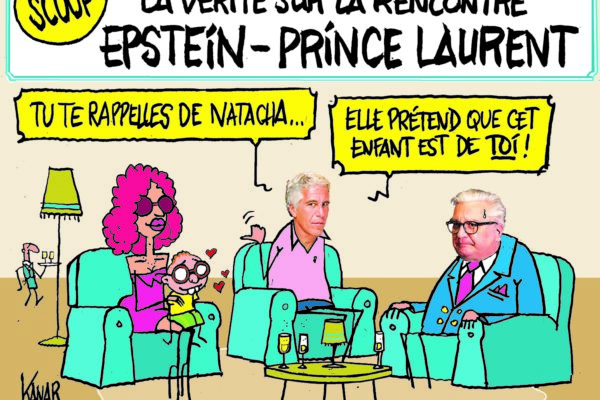La démocratie est un conflit permanent, où la colère est légitime et nécessaire. Sans elle, pas de progrès. Sans elle, les esprits renoncent, les bras tombent et le repli sur soi s’installe, avec comme perspective la fin même de cette démocratie. Mais cette colère, encore faut-il la structurer.
« Donne-moi un point d’appui et je soulèverai le monde ». Tous ceux qui, comme l’auteur de ces lignes, se sont noué les neurones au cours de physique, se souviennent probablement de ce précepte d’Archimède, le plus célèbre mathématicien de la Grèce antique : avec un bon levier, on peut faire bouger n’importe quoi. Encore faut-il, justement, un levier suffisamment long et, surtout, un point d’appui.
Selon les spécialistes de la question, Archimède en était d’ailleurs bien conscient. Le point d’appui devait être situé sur une autre planète et son levier était un mécanisme complexe de barres et de poulies de renvoi qui lui permirent, en attendant mieux, de sortir un grand navire de la mer pour le poser en cale sèche.
Une force subtile mais déterminée appuyée sur une base solide peut faire changer le monde… Notre bon Archimède avait peut-être aussi découvert le mécanisme des luttes politiques et sociales, simple dans son principe mais extraordinairement complexe à mettre en œuvre pour arriver à un résultat : le changement.
Le premier quart de ce XXIe siècle a enregistré bon nombre de mouvements sociaux aux allures pré-révolutionnaires. Le plus emblématique dans nos régions a été l’action des « Gilets jaunes ». Née en France à l’automne 2018 suite à la hausse du prix des carburants, elle s’est ensuite chargée de multiples revendications, parfois contradictoires d’ailleurs. Comme si, d’un coup, la société française avait vidé son sac de colères sur des ronds-points occupés en permanence parce que représentant l’image des diktats de la modernité technocratique (les automobilistes tournent désormais en rond et ne se croisent plus à un carrefour). Le Covid – mais aussi l’absence de résultats concrets – a eu raison du mouvement, qui se manifeste pourtant encore à l’occasion, symboliquement, dans une sorte de requiem social.
Mais d’autres actions, mues par les mêmes mécanismes de révolte, ont marqué les esprits. Les « Printemps arabes », qui, partis de Tunisie à la fin 2010, ont secoué avec une intensité variable l’ensemble des pays d’Afrique du Nord et de la péninsule arabique jusqu’à la mi-2012, exigeant le renversement des dictatures, le rétablissement de la démocratie et la suppression des inégalités ; « Nuit debout », né aussi en France ; les « 700 euros » en Grèce ; les « Indignés » en Espagne ; les « Parapluies » à Hong-Kong. Ou Occupy Wall Street, autour du slogan « Ce que nous avons tous en commun, c’est que nous sommes les 99 % qui ne tolèrent plus l’avidité et la corruption des 1 % restant ».
Bel exemple de succès sans lendemain, Occupy Wall Street. Le 15 octobre 2011, plusieurs millions de personnes se sont rassemblées sous cette bannière, dans 952 villes et 82 pays, selon le comptage du Monde Diplomatique qui y voyait la plus grande mobilisation planétaire de l’histoire. Pour un résultat nul : le mouvement n’a rien obtenu. Le constat est le même pour les autres expériences, qui n’ont pas débouché sur grand-chose ; ou alors des gains suivis de reculades, voire de violences, ou même de guerres civiles, comme ce fut le cas en Syrie, en Libye et au Yémen lors des « Printemps arabes ». À chaque fois il y avait plus de gens que nécessaire pour actionner le levier. Mais sa longueur n’était pas calculée. Et, surtout, il n’y avait pas de point d’appui.
Le même constat peut s’appliquer à l’opération « Bloquons tout !» menée depuis le 10 septembre. Initiée elle aussi en France, elle a jusqu’ici été un échec. Qu’il faudra comparer à l’impact de la mobilisation syndicale « classique » du 18 septembre.
Cette impression d’échec est de toutes façons regrettable, parce que percole dans l’opinion l’idée que la protestation ne sert à rien. Puisqu’elle n’obtient rien…
Bien sûr, les luttes sociales n’ont jamais été des guerres éclairs où il aurait suffi de descendre dans la rue pour conquérir un avantage. Les grands mouvements sociaux ont souvent débouché, à court terme, sur des échecs. Mais ils ont ébranlé, à chaque fois, les murailles des pouvoirs, de l’inégalité, de l’injustice. Les grandes avancées réformatrices des bases du système, en Europe de l’Ouest en tout cas, n’ont été enregistrées qu’à l’issue des conflits mondiaux qui avaient donné le rapport de force suffisant à la classe ouvrière devenue aussi, pour son malheur, la classe combattante. Pour le reste, les victoires étaient des grappillages, mais qui avaient un sens : celui d’un meilleur futur. On accumulait, en toute conscience de la lenteur des avancées, un capital social que les générations suivantes feraient fructifier. Une version prolétarienne du capitalisme, pourrait-on dire en boutade…
Cette perspective s’étiole. Dans les sondages réalisés dans les pays « occidentaux » sur l’état de l’opinion, les lignes statistiques les plus inquiétantes sont celles où il apparaît que la majorité des sondés pense que non, demain ne sera pas meilleur. Et les échecs des protestations telles qu’évoquées plus haut ne peuvent que conforter le sentiment de l’inutilité du combat.
Sous ces formes-là, plus ou moins spontanées, citoyennes (mais non exclusives de dérives ou de récupérations populistes, c’est une autre histoire). Mais aussi, par extension, sous les formes organisées du combat syndical structuré : la question « à quoi bon faire grève ? » s’entend désormais aussi même sur les piquets… Mais au moins ces résignés-là continuent-ils à s’indigner…
Et à faire vivre la démocratie, parce qu’il n’y a pas de démocratie sans colère du peuple et donc sans manifestations publiques de ces colères. Autrement dit, la colère est pour le peuple le moyen légitime d’exprimer ses insatisfactions et d’établir un rapport de force susceptible de faire fléchir le pouvoir. Ceux qui en douteraient n’ont qu’à regarder, a contrario, ce que font les régimes autoritaires lorsqu’ils y sont confrontés.
Cette colère, ce n’est évidemment pas l’épanchement ordurier sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas non plus la colère au nom du peuple, où le dirigeant politique « médiateur » de cette « colère » se transforme en une sorte de messie capable de tout. Il y en a eu de terribles exemples au XXe siècle, et le XXIe ne s’annonce hélas pas en retrait…
Il s’agit d’une colère qui doit pouvoir s’organiser, structurer des revendications pour les porter avec efficacité. Les expériences dont j’ai parlé plus haut étaient éminemment colériques, donc démocratiques. Mais elles n’ont pas pu, ou (plus probablement) pas voulu se traduire dans le système politique et elles se sont donc marginalisées.
Sauf à renoncer à ce qu’elle est, la démocratie implique qu’on la secoue au sein même du système quand on conteste ses choix. Le problème des initiatives telles que les « Gilets jaunes » est qu’elles ont voulu se positionner en dehors. C’était à la fois s’inscrire dans la défiance et dans le repli.
La défiance : contestés, les choix politiques ont engendré la méfiance vis-à-vis de la manière dont fonctionnaient les outils de la démocratie. Et cette critique des outils s’est transformée en un rejet du système lui-même. Un peu comme si, faute de trouver un point d’appui au bon endroit, on jetait à la poubelle la théorie d’Archimède.
Au bout du raisonnement il y a, dans l’opinion, le repli sur soi et le désintérêt pour la chose publique, qui est d’ailleurs encouragé par ceux des politiques qui ont fait le vœu de se passer de démocratie, finalement bien encombrante quand on gouverne.
Cela vaut pour les institutions politiques proprement dites, cela vaut aussi pour les relations du travail et la structuration des combats sociaux. Les mouvements type « Gilets jaunes » ont souvent manifesté une réticence à l’égard des organisations syndicales. Et réciproquement. C’était – c’est toujours – faire fausse route. Réfléchissons ensemble à cette citation : « Le citoyen, le travailleur doit pouvoir s’identifier au syndicat, à ses propositions et ses actions, pour le soutenir. Un des principaux enjeux me semble être de dépasser les intérêts spécifiques, sectoriels, pour mieux embrasser les enjeux du XXIe siècle. Les syndicalistes doivent être la somme des intérêts individuels et même plus. Les réseaux sociaux, les rassemblements avec des acteurs venus d’autres horizons constituent de nouveaux outils collectifs pour le ou la syndicaliste ».
Ces propos ne viennent pas d’un micro posé sur l’estrade d’une tribune près de la gare du Midi à l’issue d’une manif, mais d’une chronique parue dans le journal Le Soir du 17 septembre dernier. Signée de Marek Hudon, professeur à la Solvay Business School (Université libre de Bruxelles). Pas une école de militants syndicaux. En cet automne menaçant, il nous indique, si nous en doutions encore, où est le point d’appui.