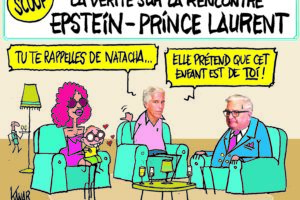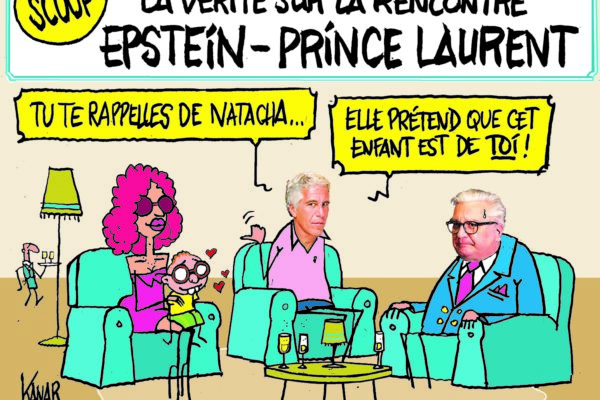Un gouvernement en affaires courantes depuis 13 mois et le plus gros projet d’investissement bruxellois sous tension, voilà ce qui rend explosif le dossier du projet de Métro 3. Au cœur des enjeux ? La mobilité intra et inter-régionale, l’environnement mais surtout les finances publiques régionales.
Près de quinze ans après son lancement, le projet d’une nouvelle ligne de Métro 3 à Bruxelles est confronté à une succession de défis techniques, financiers et politiques. Conçu pour améliorer la mobilité nord-sud dans la capitale, ce chantier d’envergure soulève de nombreuses interrogations sur sa faisabilité, son coût réel, et son intérêt public. Alors que les travaux patinent et que les dépenses s’envolent, plusieurs voix collectives plaident pour une remise à plat du projet, sans tabou.
En juin dernier, à la demande du gouvernement bruxellois en affaires courantes, la STIB, maître d’ouvrage, a présenté 5 scénarios sur la table. En attendant enfin un débat public sur ce projet qui concerne tous les citoyens bruxellois, tour d’horizon des enjeux et des tensions qui entourent ce dossier emblématique.
1. Une ambition de mobilité au cœur de la capitale
Le projet du Métro 3 démarre officiellement fin 2009, par un protocole d’accord signé entre la Stib (porteuse du projet), la Région de Bruxelles‑Capitale et Beliris – l’organe de coopération entre l’État fédéral et la Région bruxelloise[1]. L’objectif visait à répondre à la saturation croissante du réseau de surface en centre-ville et accompagner la croissance urbaine en facilitant les déplacements sur un axe structurant de la capitale. Au départ, l’investissement total est estimé à 1,6 milliards €, financé par Beliris (budget fédéral) à hauteur d’environ 500 millions €, le reste étant à la charge de la Région (soit 1,1 milliards).
Dans sa large majorité, la classe politique bruxelloise a soutenu le projet. Dès les premières annonces, le projet a toutefois suscité des oppositions. Des collectifs de riverains, des associations urbanistiques et environnementales, ainsi que certains experts ont mis en doute sa pertinence coûts/bénéfices, arguant que le projet ne rencontrait pas les besoins réels des Bruxellois, en plus de dénoncer l’ampleur de ce chantier dantesque. Ils se sont regroupés dans la plateforme Avanti, plaidant pour une modernisation du prémétro existant plutôt qu’une transformation lourde en métro. Et les premières étapes du projet ne leur ont pas donné tort…
2. Une mise en chantier progressive et rapidement complexe
La première phase du projet, entre Albert et la Gare du Nord, débute réellement en 2020-2021. Elle prévoit la transformation des infrastructures existantes, la construction de la nouvelle station Toots Thielemans et l’adaptation de plusieurs stations. Mais très vite, le chantier bute sur des obstacles techniques majeurs.
Pour creuser la jonction sous le Palais du midi (bâtiment construit sur l’ancien lit de la Senne, dans le quartier de Stalingrad), le choix est porté sur la technique du « jet grouting » (injection de béton dans le sol pour le stabiliser). Mais cela s’avère inefficace en raison de la nature hydrogéologique du terrain : le béton « fuit » et crée des risques supplémentaires. Pour garantir la stabilité du site, la Région décide de démanteler partiellement le Palais du midi, de conserver les façades et de creuser à ciel ouvert. Ce choix entraîne un dépassement budgétaire de près de 400 millions d’euros et des retards importants. Mais surtout, dans ce quartier du Palais du midi, il a fallu déménager de multiples commerçants et des associations qui oeuvraient pour les citoyens du quartier.
La situation se complique également à la Gare du Nord, où la présence d’une nappe d’eau « imprévue » bloque l’avancée du chantier. À cela s’ajoute l’inquiétude de la Commission royale des Monuments et Sites vis-à-vis des travaux prévus sous l’hôtel communal de Schaerbeek, classé, craignant un scénario similaire à celui du Palais du midi.
3. Une explosion des coûts et un calendrier glissant
En l’espace de quelques années, entre 2018 et 2024, le coût total estimé du projet passe de 1,6 à 4,5 milliards d’euros, soit une multiplication par près de 3ou 4 selon les phases. Une inflation due à des surcoûts techniques, des choix d’ingénierie contestés, des études bâclées et une planification jugée lacunaire. Ce débordement budgétaire fait grincer des dents : le gouvernement régional, en affaires courantes depuis les élections de 2024, refuse d’approuver un avenant budgétaire clé pour poursuivre les travaux à la Gare du Nord. L’opposition quant à elle parle d’un projet « inabordable » et potentiellement non-finançable. À ce jour, aucune solution de financement structurel capable de répondre au défi budgétaire que représente ce projet d’infrastructure bruxellois n’a été confirmée.Certains acteurs demandent même l’abandon pur et simple du projet au profit de solutions moins coûteuses, comme un « Prémétro+ ». Mais la Stib persiste à considérer le projet de Métro 3 comme la meilleure option.
La situation est aggravée par la fragilité des finances bruxelloises. La dette régionale, déjà sous surveillance, rend difficile tout engagement financier massif à long terme. Cette tension budgétaire, doublée de la limitation des pouvoirs de dépense du gouvernement bruxellois et de l’incertitude politique, limite les marges de manœuvre et accentue les interrogations sur la faisabilité du projet dans sa version complète. Sans compter qu’il s’agit là du plus gros investissement bruxellois, qui pourrait hypothéquer d’autres investissements essentiels (notamment en matière de logement et rénovation énergétique). Pour avoir un ordre de grandeur, « le Métro 3 dans son budget (ndrl : estimé) actuel, c’est plus de deux fois le coût total du vaste programme de construction de nouveaux logements sociaux à Bruxelles (2 milliards) ».
Quant au calendrier, les promesses de mise en service pour 2025 ont cédé la place à des projections plus lointaines : la Stib parle aujourd’hui d’une ouverture en 2032, voire 2033. D’autres évaluations, selon les options techniques retenues, évoquent un horizon allant jusqu’à 2035, voire au-delà.
4. Enfin un débat public ?
Ce dérapage général a relancé le débat sur la pertinence du projet dans sa forme actuelle.
Dans son dernier rapport commandé par le gouvernement en affaires courantes, la Stib évoque 5 pistes de solution pour la poursuite (ou non) des travaux du Métro 3 :
- Poursuivre l’intégralité du projet jusqu’à Bordet – surcoût de ~3,65 Md€ à partir de 2026, financés par la Région.
- Geler le chantier pendant une décennie, en attendant des conditions politiques et financières plus favorables. Mais ce choix ne résoudrait pas la saturation de certaines lignes de tram, il faudrait donc envisager d’autres solutions (de surface) à financer, comme augmenter le nombre de trams ou de bus.
- Abandonner totalement le projet. Il faudrait toutefois injecter encore 224 millions d’euros pour indemniser les entrepreneurs, refermer et sécuriser les chantiers en cours. Sachant que 546 millions ont déjà été dépensés depuis quinze ans dans ce projet, la facture s’élèverait à 770 millions que d’aucuns qualifieraient de « presque jetés à la poubelle ». Et il faudrait ajouter un budget d’environ 380 millions d’euros pour améliorer le réseau de trams.
- Se limiter au tronçon Albert–Gare du Nord, et abandonner l’extension nord – moins cher (≈ 1 milliard supplémentaire), mais ce choix réduit très fortement l’ambition de départ. La Stib soulève également un problème logistique : il n’y a actuellement aucun dépôt de trams sur cette ligne, il faudrait dès lors amener les rames chaque matin depuis un dépôt excentré, ce qui empêcherait une fréquence rapide entre les rames.
- Avancer étape par étape, en se laissant la possibilité d’arrêter entre les différentes grandes phases du projet (mais arrêter sera-t-il encore possible quand certaines phases auront été réalisées ?). La première étape consisterait à finir tous les tunnels et les voies déjà prévus, via notamment le démantèlement du Palais du midi et la création du tunnel sous la Gare du Nord. La Stib ferait ensuite rouler sur la ligne des trams, au lieu d’un métro. La Région bruxelloise déciderait dans un second temps d’aménager ou non les tunnels pour y faire rouler des métros. Le coût serait plus élevé : 3,8 milliards d’euros, au lieu de 3,6 milliards (scénario 1). Cependant, cette option coûterait moins cher sur le court terme, puisqu’elle permettrait de reporter les investissements. La mise en service du métro serait toutefois elle aussi reportée, à 2046 (au lieu de 2040).
La Stib continue de privilégier un métro – maintenant ou plus tard, complet ou pas – pour, selon elle, améliorer les fréquences et capacités de transport de passagers. À l’inverse, des organisations citoyennes et associatives, comme Inter-environnement Bruxelles (IEB), l’Atelier de recherches et d’actions urbaines (Arau) ou le Bral, proposent des alternatives plus souples et moins coûteuses, comme le scénario dit « Prémétro+ », qui préserve l’infrastructure actuelle en la renforçant. Elles s’inquiètent également que certaines décisions à court terme – comme par exemple le démantèlement du Palais du midi – obligent, par leur ampleur, à terminer le Métro 3 dans son entièreté. Regroupées au sein de la plateforme Avanti, elles lancent un appel à plus de transparence et de concertation : « Il est donc urgent que le gouvernement soit éclairé par une voix neutre analysant réellement les avantages et inconvénients de toutes les solutions possibles, dans un climat de confiance et sur la place publique plutôt que par le biais de notes réservées à un public très restreint (comme la note discutée ici) voire confidentielles (comme pour les problèmes au Palais du Midi en juin 2023). »
5. Conclusion
Les options sont sur la table, et si le manque de décisions a pâti de l’absence de gouvernement bruxellois depuis les élections de 2024, le gouvernement en affaires courantes va devoir trancher avant la fin de l’été. En effet, c’est le 1er septembre que le démantèlement du Palais du midi est programmé, pour pouvoir ensuite creuser en-dessous. Et ne pas décider reviendra à décider car « si cette partie (très coûteuse) du chantier est entamée, il sera alors très difficile – presque impossible nous glisse-t-on – de pouvoir revenir en arrière pour tout arrêter ».
Le Métro 3 illustre les questionnements stratégiques pour la mobilité bruxelloise. Mais son exécution soulève des questions fondamentales : sur la maîtrise technique, la capacité de pilotage politique, la soutenabilité budgétaire et l’intégration de la concertation citoyenne. Le projet est aujourd’hui à un tournant. Poursuivre à tout prix ? Repenser les modalités ? Geler et rouvrir la discussion ?
La réponse relève autant de la technique que du choix politique. Une chose est certaine : le Métro 3 est devenu un marqueur fort de la manière dont Bruxelles conçoit, ou peine à concevoir, ses grands projets d’infrastructure urbaine, mais aussi du soutien qu’elle reçoit (ou pas) à cet égard du gouvernement fédéral pour assurer ses fonctions de capitale internationale[2].
[1] Beliris travaille directement pour la Région bruxelloise mais s’intègre au SPF Mobilité et Transports pour sa gestion quotidienne.
[2] On rappellera à bon escient que l’accord de gouvernement Arizona a décidé de réduire le budget de Beliris et de le dédier à des projets « qui sont importants pour plusieurs Régions », et pas seulement pour la capitale bruxelloise, alors que c’était le cœur de l’action de Beliris.