Les grèves sur le rail défraient la chronique depuis plusieurs semaines. Ce sont principalement les projets de réforme du nouveau gouvernement fédéral, en particulier les mesures relevant l’âge légal de la pension et les restrictions budgétaires imposées à la SNCB, qui sont à l’origine des mouvements de contestation. Néanmoins, en ligne de fond de ces réformes, se trouve toujours le spectre de la « libéralisation », de « l’ouverture à la concurrence » et de la « privatisation ». Il faut dire que ces questions reviennent sur la scène médiatique à intervalles réguliers, notamment via la N-VA qui remet régulièrement la privatisation de la SNCB à l’agenda politique[1]. Ce 27 mars 2025, elle a déposé une proposition de loi visant à réduire la participation publique dans la SNCB (à 50 % + 1 action) et à ouvrir l’actionnariat à des partenaires commerciaux privés.
Que recouvrent exactement les notions de « libéralisation », d’« ouverture à la concurrence » et de « privatisation » dans le secteur ferroviaire ? Quelles en sont les conséquences pour la SNCB, les travailleurs et travailleuses du rail ainsi que ses usagers et usagères ?
1. Quelle différence entre la libéralisation et la privatisation ?
La libéralisation des industries de réseau, dont fait partie le transport ferroviaire (aux côtés des télécommunications, l’électricité, le gaz et la poste), désigne l’ouverture du marché à la concurrence et découle de la volonté de l’Union européenne de créer un marché intérieur, sans barrière douanière ou règlementaire, au sein duquel la concurrence régit les activités. L’ouverture à la concurrence ne signifie pas que l’État doit se défaire de ses entreprises publiques mais que les entreprises publiques, si elles subsistent, doivent entrer en concurrence avec les entreprises privées.
Privatiser un marché consiste à privatiser les entreprises agissant sur ce marché et donc à transférer tout ou partie des capitaux des entreprises du public au privé (ce qu’entend faire la N-VA dans un premier temps).
2. Qu’impose l’Union européenne ?
La libéralisation du rail s’est déroulée en étapes successives, à travers l’adoption, au niveau européen, de « paquets ferroviaires », composés de directives et règlements européen. L’un des premiers paquets (le « paquet de base ») impose notamment la séparation entre l’opérateur de transport et le gestionnaire d’infrastructure.
Le quatrième paquet ouvre à la concurrence le transport national de passagers. Cette ouverture à la concurrence peut s’opérer de deux manières. D’une part, en principe, tout opérateur ferroviaire, public ou privé, national ou étranger, peut demander au gestionnaire d’infrastructure des « sillons », c’est-à-dire des droits d’exploitation de certaines lignes pour y faire rouler des trains. On parle alors de concurrence sur ou dans le marché (qui s’opère en principe sur des lignes commerciales supposées rentables).
D’autre part, l’État peut donner une dotation (des subsides) à un opérateur ferroviaire déterminé pour assurer un service public (impliquant par exemple la couverture de plus petites lignes non rentables, de gares de proximité, des tarifs raisonnables, etc). Il s’agit alors d’un contrat de service public qui est attribué à un opérateur ferroviaire (c’est ce qu’on appelle la concurrence pour le marché). Pour l’attribution du contrat de service public, l’État a le choix entre deux procédures : un marché public, par principe, ou une attribution directe à un opérateur déterminé, par exception.
Dans le premier cas, l’État met en concurrence des opérateurs et choisit l’offre qu’elle estime la plus avantageuse. Dans le second cas, l’État octroie à un opérateur déterminé – par exemple, l’opérateur historique – le contrat de service public sans mise en concurrence préalable. Comme il s’agit là d’une entorse à la concurrence, cette possibilité est soumise à deux conditions. La première est qu’elle doit être justifiée par la taille et la complexité du réseau (les petits pays comme la Belgique sont directement concernés) et qu’elle améliore la qualité des services et/ou le rapport coût-efficacité. La deuxième condition est que l’État définisse des indicateurs de performance pour évaluer l’opérateur. Le contrat attribué selon cette procédure ne peut pas excéder 10 ans.
3. Quid en Belgique ?
La libéralisation du transport ferroviaire est actée sur le plan juridique. La séparation verticale entre le gestionnaire de l’infrastructure (Infrabel) et l’opérateur de transport (la SNCB) a été réalisée il y a plus de vingt ans, en 2004[2]. L’ouverture à la concurrence des activités de transport, la « concurrence sur ou dans le marché », a été réalisée : toute entreprise ferroviaire peut demander des sillons pour du transport de voyageurs.
Quant à la concurrence pour le marché, l’État belge a mobilisé l’exception et attribué à la SNCB le service public de transport ferroviaire de voyageurs, pour dix ans, à travers le nouveau contrat de gestion entré en vigueur le 1er janvier 2023 (il court donc jusqu’au 31 décembre 2032). La concurrence pour le contrat de service public n’est donc pas encore arrivée en Belgique, l’État belge peut choisir de maintenir la SNCB par le recours continu à l’attribution directe, moyennant le respect des conditions de la règlementation européenne.
4. Conséquences de la libéralisation et de la séparation SCNB/Infrabel
La séparation de l’opérateur ferroviaire du gestionnaire de l’infrastructure produit des effets contrastés au niveau européen : certaines études montrent une augmentation des coûts, notamment si le trafic ferroviaire est dense[3]. D’autres mettent en avant qu’une structure intégrée a un impact positif sur la part modale du transport de passagers[4]. En Belgique, il semble en tout cas que la séparation entre Infrabel et la SNCB complique la communication et la collaboration, ce qui induit des coûts de coordination.
Les conséquences concrètes de l’ouverture à la concurrence dans le rail sont difficiles à évaluer. Les résultats sont contrastés selon les variables et critères utilisés, les structures des opérateurs ferroviaires et les pays étudiés (les impacts de la libéralisation ne sont pas les mêmes au Royaume-Uni, en Suède et en Belgique, par exemple).
À ce jour, il n’y a pas de consensus clair sur les coûts que cela représente (notamment pour le contribuable), les tarifs ou encore la qualité du service (on ne peut pas dire avec certitude que dans les pays où il y a concurrence entre plusieurs opérateurs, le service s’est dégradé).
Il y a néanmoins trois éléments clairs qui se dégagent des expériences de libéralisation.
Premièrement, sur les marchés complètement libéralisés, une disparition des liaisons non rentables et un démantèlement des gares de proximité ont été observés lorsque l’État n’intervient pas en imposant des obligations de service public.
Deuxièmement, la libéralisation entraîne une détérioration et précarisation des conditions de travail des cheminots (fragilisation syndicale, flexibilisation des horaires et culture d’entreprise basée sur les standards de gestion du secteur privé).
Enfin, la libéralisation n’engendre pas avec certitude une diminution du prix du billet ni une augmentation. En revanche, elle produit une fluctuation des prix du billet (prix plus élevé en heure de pointe, moins élevé en heure creuse).
5. À quoi se préparer pour l’avenir ?
Le secteur ferroviaire est une belle illustration des effets plus larges des politiques issues du néolibéralisme. Ce mode de transport évolue doucement d’un service public en monopole avec des cheminots sous statut à un marché libéralisé où agissent différents opérateurs employant du personnel sous contrat, avec les conséquences que cela entraîne.
Rien n’est cependant joué pour la SNCB, ni dans un sens ni dans l’autre.
L’État belge peut décider de basculer en 2033 dans l’ouverture à la concurrence (éventuellement doublée d’une privatisation de la SNCB) ou maintenir la SNCB comme opérateur ferroviaire unique sur son territoire. Compte tenu de la taille de notre territoire, maintenir un opérateur unique a beaucoup plus de sens en termes d’exploitation des lignes ainsi que de coûts de gestion et de coordination (qui seraient plus élevés en présence de plusieurs opérateurs concurrentiels). Attribuer le contrat de service public directement à la SNCB est également l’occasion pour l’État belge de fixer des critères ambitieux tels qu’une diminution de l’empreinte écologique, amélioration du statut des cheminots, diminution du prix des billets, augmentation des fréquences… (pour autant qu’il y ait un refinancement à la clef).
[1] En 2019 déjà, la N-VA déposait une proposition de loi prévoyant une privatisation partielle de la SNCB.
[2] Entre 2004 et 2013, les deux entreprises étaient intégrées dans une holding qui gérait aussi le personnel. Depuis 2013, Infrabel et la SNCB sont totalement séparées et on a créé l’entité HR Rail qui constitue l’employeur unique des cheminots relevant des chemins de fer publics belges. Les trois sociétés sont détenues par l’État fédéral (HR Rail est partiellement détenu à parts égales par Infrabel et la SNCB). Notons que la N-VA a également déposé une proposition de loi visant à dissoudre HR Rail.
[3] M. Mizutani et S. Uranishi, « Does vertical separation reduce cost? An empirical analysis of the rail industry in European and East Asian OECD Countries », Journal of Regulatory Economics, vol. 43, n° 1, 2013, pp. 31-59.
[4] C. Laabsch et H. Sanner, « The Impact of Vertical Separation on the Success of the Railways », Intereconomics Review of European Economic Policy, n° 47, 2012, pp. 120-128.





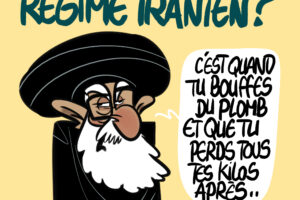




Un commentaire sur