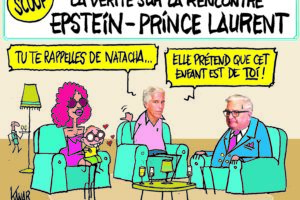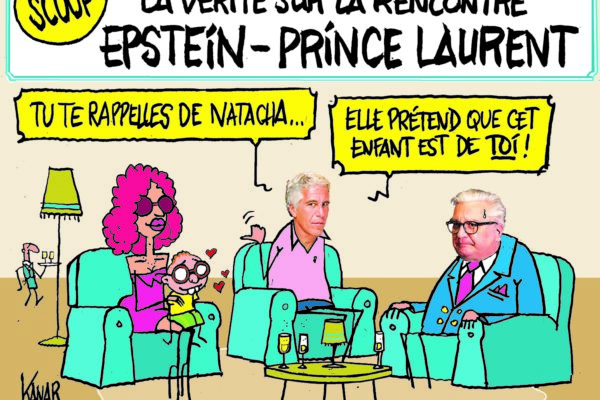Toute personne suivant de près ou de loin la politique aura forcément déjà entendu, comme une garantie de bonne morale, cet argument implacable : « nous prenons nos responsabilités ». Ou à l’inverse, comme un reproche adressé à un adversaire : « vous ne prenez pas vos responsabilités ». Que faut-il lire derrière ce moralisme récurrent dans les discours politiques ?
La responsabilité est, dans ce type de discours, associée à la prise de décision difficile, au fait d’assumer les conséquences de ses actes et des choix posés « pour le bien de tous ». Mais elle renvoie aussi à la conviction de détenir la bonne parole et la bonne attitude, celles qui guident les bons choix politiques. Ces choix seraient certes douloureux, mais nécessaires. Ils seraient presque entièrement imposés par un contexte qui nous contraint absolument, le fameux TINA – There is no alternative.
Cette morale rigide et caricaturale est, en somme, tout l’inverse de ce qu’un philosophe comme Jean-Paul Sartre a pensé avec la notion de responsabilité. Pour lui, il s’agit d’une obligation morale des intellectuels, d’un engagement qui découle de leur liberté totale d’agir sur leur situation pour la transformer. Pour la transformer. Si, dans l’après-guerre, Sartre insiste sur la dimension individuelle de cette responsabilité, il montrera plus tard (notamment dans sa Critique de la raison dialectique)la nécessité d’un engagement collectif et organisé au nom d’une justice sociale. Et ce type de responsabilité ne touche pas que les intellectuels mais tous les individus (dont les politiques) qui doivent porter leur action transformationnelle, leur praxis (osons dire « révolutionnaire ») à propos du monde tel qu’il est et tel qu’il devrait être : c’est bien le rôle de la politique au sens noble du terme.
La « responsabilité » invoquée comme un mantra par nos hommes et femmes politiques est tout l’opposé, à savoir une fatalité : fatalité d’un pouvoir qui les attend (bien sagement), fatalité de l’ordre économique (bien ordo-libéralisé), fatalité des réductions budgétaires (surtout publiques), fatalité des mesures austéritaires et impopulaires, fatalité d’une idéologie dominante qu’on ne peut plus contraindre, etc. La fatalité politique et économique, qui est une acceptation de l’ordre des choses, justifierait en ce sens une responsabilité du reniement.
Prendraient donc leurs responsabilités celles et ceux qui osent agir en « bons pères de famille », qui maitrisent les dépenses, qui acceptent d’exercer un pouvoir dont ils doivent bien malgré eux (il n’y a aucun doute là-dessus) assumer les conséquences. Ils sont les clairvoyants, les gestionnaires, les patrons de la société qu’ils administrent.
A contrario, les « idéalistes », les « romantiques » et les « irresponsables » seraient, selon cette grille de lecture stéréotypée, ces êtres ou ces groupes sans morale, sans sens du devoir, presque des individualistes égocentrés. Des enfants en somme. Et des enfants à éduquer, à redresser, à moraliser. Ceux qui refusent le pouvoir, par manque de lucidité ou par incompétence, ou n’y comprennent rien (les syndicats, les partis d’opposition, les collectifs contestataires, la politique extra-parlementaire) refusent d’être responsables. C’est bien connu.
Or, refuser un pouvoir, ce n’est pas refuser la politique, car la politique ne se résume pas au pouvoir. Et ce pouvoir ne se résume pas à une fatalité. Choisir de ne pas prendre des mesures allant dans le sens d’une précarisation, c’est être totalement responsable (au sens sartrien). Et, à l’inverse, ne pas se compromettre au nom d’une politique que l’on refuse sur le plan idéologique, c’est rejeter l’exercice autoritaire d’un pouvoir responsable (au sens néolibéral cette fois) des misères qu’il construit.
On voit donc que la responsabilité est convoquée dans certains discours politiques pour justifier une posture morale (moralisatrice même) qui accepte un état des choses, qui ne veut surtout pas lutter pour les transformer et qui joue sur un fatalisme et une absence d’alternative. Contre cette responsabilité du « bon père de famille », il reste à construire une responsabilité collective qui assume l’urgence d’une transformation allant dans le sens d’une amélioration des conditions d’existence.