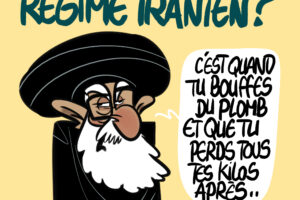Ce samedi 29 mars 2025, deux millions de personnes manifestaient à Istanbul pour protester contre l’arrestation d’Ekrem Imamoglu, maire d’Istanbul et premier opposant politique du président Erdogan, et pour un changement de régime, la démocratie et plus de justice sociale. Quelle que soit l’issue de cette mobilisation, elle est intéressante à plus d’un titre.
D’abord, elle nous montre, une fois de plus, l’importance de la jeunesse dans les mouvements d’émancipation. Ensuite, elle nous montre comment une contestation qui part de quelques centaines d’étudiants peut se transformer en un mouvement d’une ampleur nationale. S’il n’existe pas de stratégie miracle, c’est toujours dans l’action concrète que s’allument les consciences et que les grands mouvements sociaux émergent. Enfin, elle nous rappelle que l’histoire n’est jamais écrite d’avance. Quelle que soit la répression ou la chape de plomb qui pèse sur les peuples, ils sont toujours capables de se lever en masse, pour tenter de changer les rapports de force et avancer vers un monde basé sur la justice sociale.
1. L’origine de la mobilisation étudiante : le retrait d’un diplôme
Le 19 mars, Ekrem Imamoglu, le populaire maire d’Istanbul, figure majeure de l’opposition à Recep Tayyip Erdogan et sur le point d’être désigné comme candidat de l’opposition aux prochaines élections présidentielles (2028), est arrêté. Cette arrestation s’accompagne d’une autre décision : l’annulation rétroactive du diplôme universitaire d’Imamoglu, nécessaire pour être candidat à la présidence. En effet, en Turquie, tout candidat à la présidence doit justifier de quatre années d’études supérieures. En supprimant ce diplôme, le régime rend Imamoglu inéligible, en particulier pour les élections présidentielles de 2028.
Cette décision provoque l’indignation de la jeunesse étudiante, et une poignée de ceux-ci, appauvrie mais politisée et engagée dans des collectifs de gauche, féministes ou syndicaux, décident de ne pas laisser passer. Ils lancent sur WhatsApp un appel à se rassembler le lendemain devant l’Université d’Istanbul, là où Imamoglu avait obtenu son diplôme. Les autorités annoncent alors rapidement l’interdiction de ce rassemblement.
2. L’étincelle : un barrage policier est forcé et filmé
Malgré cette interdiction, environ 600 étudiants se retrouvent devant l’Université. Les policiers bloquent mais petit à petit le nombre d’étudiants augmente. Ils poussent, ils reculent, poussent à nouveau, et après 40 minutes, les étudiants arrivent à forcer le cordon policier. C’est un exploit, et cet exploit est filmé. Ces images deviennent rapidement virales. L’étincelle est créée.
Cette victoire contre les forces de l’ordre est vue comme une libération. L’espoir renaît. Tout devient possible. Les mobilisations s’élargissent et se développent alors à une vitesse fulgurante. Le nombre de manifestants augmente de jour en jour, pour atteindre deux millions de personnes samedi 29 mars, soit dix jours après l’arrestation du maire d’Istanbul !
Bien sûr, ce mécontentement ne surgit pas de nulle part. La population turque vit dans la précarité et la peur depuis de nombreuses années : crise économique, absence de perspectives, inflation galopante, scandales de corruption, négation de l’État de droit, arrestations régulières et arbitraires, répression de l’opposition politique, atteintes aux libertés civiles, répression des minorités, violence envers les femmes et les minorités LGBTQ+, …
Mais, une fois de plus, Rosa Luxembourg avait vu juste quand elle écrivait : « L’étincelle de la conscience révolutionnaire s’allume dans l’action. »
3. Perspectives
Cette mobilisation va-t-elle aboutir à un résultat probant ? Rien n’est moins sûr. La répression est très forte, et même si beaucoup de manifestants déclarent ne plus avoir peur et n’avoir plus rien à perdre, les jeunes le savent : protester, c’est risquer l’emprisonnement. On peut aussi être sûr que le gouvernement autoritaire d’Erdogan ne va pas reculer facilement. Plus de 2.000 personnes, dont des journalistes, ont déjà été arrêtées depuis le début de la mobilisation.
Il faudra ensuite observer comment ce mouvement réussira à se structurer et comment les forces d’opposition pourront s’organiser face à un pouvoir de plus en plus répressif. Le parti républicain du peuple (CHP), principal parti d’opposition dont est issu le maire d’Istanbul, promet de maintenir la pression en organisant des rassemblements réguliers chaque mercredi dans différents quartiers d’Istanbul et chaque semaine dans différentes villes du pays.
Quoi qu’il advienne, cette mobilisation nous rappelle que l’histoire n’est jamais écrite d’avance et que des bouleversements sont toujours possibles, et souvent inattendus.
4. Rompre avec le fatalisme
Le soulèvement populaire en Turquie s’est développé de manière spectaculaire et inattendue. Mais en réalité, l’histoire nous apprend que c’est souvent le cas. Donnons quelques exemples.
Qui aurait pu imaginer qu’en janvier 2011, suite à une action désespérée d’un homme s’immolant sur une place publique, le peuple tunisien allait se soulever et, en moins de trois semaines, « dégager » le dictateur Ben Ali ? La même année, qui aurait pu imaginer qu’un acte de protestation isolé d’une vingtaine de jeunes Espagnols à Madrid allait donner naissance au mouvement des Indignés, mouvement massif entrainant avec lui des millions de personnes dans l’action citoyenne et militante ? De nombreux autres exemples existent, comme celui des Gilets jaunes en France, le mouvement « Y’en a Marre » au Sénégal, etc.
Bien sûr, toute mobilisation, même extraordinaire et même victorieuse, ne débouche pas toujours sur des victoires durables et de nouvelles conquêtes démocratiques et sociales.
Mais comment réfléchir sereinement à un autre monde si on part du principe qu’on ne pourra pas le changer ? Comment s’engager à lutter pour un monde meilleur si on pense que, de toute façon, « c’est foutu » ?
On ne pourra jamais être certain que nos actions porteront leurs fruits. Un combat n’est jamais gagné́ d’avance. Mais construire l’alternative commence par refuser de se laisser endormir par les idées préconçues qui visent notre renoncement. Puis agir, avec humilité et courage, en essayant d’être à la hauteur des défis à relever.
Par ses actes, le peuple turc, faisant face à un régime autoritaire et extrêmement répressif, nous donne de l’espoir et nous nous devons d’être solidaires de leur lutte, car la victoire d’un peuple sera toujours la victoire de tous les peuples.
« Il arrive à ceux qui se battent de gagner, au contraire des résignés qui sont les éternels défaits. Les seuls combats perdus d’avance sont ceux qu’on ne mène pas. L’abstention du plus grand nombre est toujours une victoire des puissants. »
Cyrille Sironval, L’Engagement, Éditions du Cerisier, 2014.
Résistant contre le nazisme, professeur émérite à l’Université de Liège et membre de l’Académie royale de Belgique.