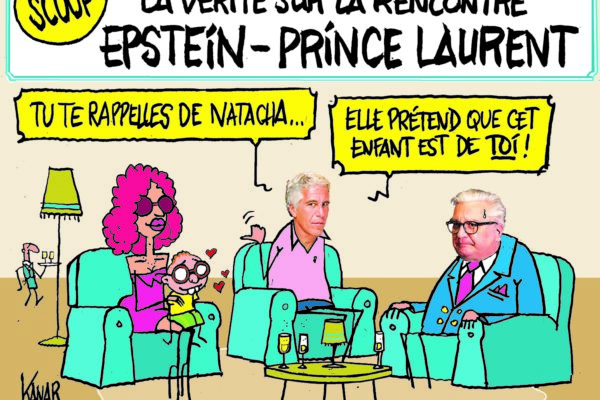Parallèlement à l’accord de gouvernement fédéral, le gouvernement a présenté un tableau budgétaire qui synthétise les « efforts » à fournir et la trajectoire budgétaire à respecter pour la législature 2025-2029 (voir document pdf en-dessous de l’article). Ce tableau commence par présenter la trajectoire à politique constante, qui montre que, sans changement de politique, on passerait d’un déficit de 20 milliards € en 2025 (3,1 % du PIB) à un déficit de 42 milliards en 2029 (6 % du PIB).
Afin de respecter les critères européens et d’éviter une procédure pour déficit excessif, le gouvernement entend ramener le déficit sous le seuil des 3 % d’ici la fin de la législature. Rappelons que le déficit budgétaire s’est élevé à 28 milliards en 2024, soit 4,6 % du PIB. Pour y arriver, le gouvernement compte réaliser un effort total de 23 milliards sur la législature[1].
Cette trajectoire budgétaire ne tient absolument pas la route, pour plusieurs raisons.
1. Faux départ et aquaplaning
À peine quelques semaines après la présentation de la trajectoire, dévoilée le 4 mars 2025, il apparait déjà que plusieurs milliards manquent à l’appel. Le dernier rapport du Comité de monitoring – organe chargé d’analyser les budgets –, daté du 6 mars, prédit en effet une dégradation du déficit de 2,5 milliards € en 2025 à politique inchangée. Concrètement, cela signifie que le déficit initial de 2025 n’est plus de 20,2 mais bien de 22,7 milliards.
Si on ajoute à cela les marches arrière concernant la taxe sur les plus-values et la fin de la déduction sur les résidences secondaires (cf. point 4), il apparait que les chiffres budgétaires sont déjà à jeter à la poubelle. Et nous ne sommes qu’au troisième mois de l’année… À plus long terme, la Banque nationale de Belgique (BNB) affirme que les objectifs budgétaires de l’Arizona ne seront tout simplement pas atteints, et qu’il est possible que le déficit ne diminuera même pas au cours des prochaines années. En cause, une évolution des dépenses primaires sous-estimée et des effets retour surestimés (cf. point 3).
2. Conduite en dehors des clous et excès de vitesse
En 2024, les dépenses militaires s’établissaient à 8 milliards €, soit 1,3 % du PIB (PIB belge de 615 milliards). Dans sa trajectoire budgétaire, l’accord fédéral prévoyait d’augmenter progressivement les dépenses militaires du pays pour atteindre 2 % du PIB en 2029, puis 2,5 % du PIB en 2034. Cela représentait alors un effort de 4 milliards sur l’ensemble de la législature.
Cependant, étant donné le nouveau contexte géopolitique qui pousse les gouvernements européens à augmenter fortement leurs efforts en matière de défense, cet accord serait déjà caduc. En effet, le Premier ministre belge, Bart De Wever, compte porter l’effort de défense à 2 % du PIB dès juin 2025. Concrètement, cela signifierait de faire passer le budget de la Défense de 8 milliards à 12 milliards € dès l’année 2025, et ainsi de trouver 17 milliards € supplémentaires sur la législature.
Que l’on soit d’accord ou pas avec cette orientation guerrière, d’un point de vue budgétaire, il s’agit d’un quasi doublement de l’effort total, déjà considéré par beaucoup comme irréalisable et irréaliste. En effet, l’effort total prévu dans la trajectoire budgétaire, était de 23 milliards sur l’ensemble de la législature…
Pour financer cet énorme effort supplémentaire, ce gouvernement de droite dure a déjà ses idées : vente des bijoux de familles (Belfius, BNP Paribas Fortis, Bpost, Proximus…) ; économies supplémentaires dans la santé, les pensions et les services publics ; nouvelles dettes (qui seraient exclues du calcul du déficit) ou encore nouvelles « contributions » des « épaules les plus larges », mais on peut douter de cette dernière proposition, tant ce gouvernement aime répéter, faussement, qu’il n’existe pas de marge de manœuvre en termes de recettes.
3. Conduite en état d’ivresse et tête à queue
Pour trouver les 23 milliards initiaux (effort total sur 2024-2029), le gouvernement compte sur des effets retours de 8 milliards. C’est quoi cet effet retour ? C’est la croyance – naïve – que les réformes qui seront mises en œuvre vont donner de bons résultats économiques, notamment en matière de création d’emplois et de productivité, et ainsi améliorer la situation des finances publiques. En effet, qui dit création d’emplois, dit moins de dépenses de chômage, plus de cotisations sociales, plus de précompte professionnel, plus de consommation et donc plus de recettes TVA…
Pour arriver à ce résultat, le gouvernement escompte en particulier un taux d’emploi de 80 % de la population active[2]. Par comparaison : le taux d’emploi des 20-64 ans s’est établi à 72,3 % en 2024.
Même si cet effet retour a été revu à la baisse (en août 2024, Bart De Wever présentait un autre tableau budgétaire avec des effets retours équivalents à 50 % de l’effort total), prévoir un effet retour de 33 % (8 milliards sur un effort total de 23 milliards) paraît encore très largement surestimé.
Le Président de la BNB, Pierre Wunsch, a exprimé de sérieux doutes sur ces effets retour. Statbel, l’agence fédérale de statistiques, en a rajouté une couche. Elle a en effet calculé que, pour atteindre ce taux, il faudrait créer 550.000 nouveaux emplois, soit plus que le nombre total de demandeurs d’emploi inoccupés que compte la Belgique (536.000). Cela signifie que cet objectif de 80 % de taux d’emploi serait tout simplement impossible à atteindre…
Cet objectif est d’autant plus douteux que ces créations d’emploi devront s’inscrire dans une conjoncture économique européenne et belge qui s’assombrit, avec notamment les secteurs de l’industrie et de la construction qui souffrent.
4. Ralentir à 30 km/h, alors qu’il faudrait rouler à 120 km/h
Alors que l’essentiel de l’effort provient de coupes budgétaires (dans la protection sociale, les services publics, la migration, la coopération au développement, …) et d’effets retours (illusoires), il est frappant de remarquer que les nouvelles recettes provenant des « épaules les plus larges » ne comptent que pour 10 % dans l’effort, soit 2,3 milliards.
Et encore, ces 2,3 milliards sont loin d’être garantis. D’une part, parce qu’il s’agit d’estimations et, d’autre part, parce qu’on voit déjà apparaitre toute une série de « marche arrière », avec notamment :
- La fin de la déduction sur les résidences secondaires ne s’appliquerait pas avant 2026, ce qui ferait un trou budgétaire de 200 millions supplémentaires en 2025 ;
- La taxe sur les plus-values, déjà rikiki, pourrait être revue à la baisse : le MR propose de ne pas taxer les plus-values sur les actions conservées pendant 10 ans, tandis que le CD&V propose de faire passer l’exonération aux premiers 20.000 € de plus-values (l’exonération est prévue pour l’instant à 10.000 €).
Pourtant, comme de nombreuses analyses et rapports l’ont démontré ces dernières années, les possibilités d’augmenter les recettes sans recourir à l’endettement et sans faire payer les travailleuses et travailleurs, sont nombreuses[3] :
- Augmenter la progressivité de l’impôt et globaliser les revenus (5 milliards) ;
- Créer un impôt de solidarité sur la fortune (5 milliards) ;
- Lutter contre la fraude fiscale et la criminalité financière (5 milliards) ;
- Augmenter l’impôt sur les bénéfices des sociétés (4 milliards) ;
- Taxer les plus-values boursières (3 milliards) ;
- Taxer correctement les dividendes (1 milliard) ;
- Instaurer une taxe sur tous les superprofits (5 milliards) ;
- Instaurer une taxe supplémentaire sur les banques (1 milliard).
Un gouvernement qui aurait réellement la volonté d’assainir les finances publiques devrait se saisir, d’une manière ou d’une autre, de ces opportunités.
5. Queue de poisson aux entités fédérées
La trajectoire budgétaire de l’entité 1 (État fédéral + sécurité sociale) est une chose, mais quand on parle de trajectoire budgétaire, il faut tenir compte de l’ensemble des pouvoirs publics, et donc aussi des trajectoires des Régions, Communautés et pouvoirs locaux (ce qu’on appelle l’entité 2). Or, à ce niveau, le moins qu’on puisse dire est que les choix budgétaires du gouvernement fédéral vont avoir un impact négatif sur les autres entités. Citons :
- Le Ministre-Président wallon, Adrien Dolimont, considère que les mesures décidées par le gouvernement De Wever vont coûter 270 millions € par an à la Région ;
- Les réformes fédérales affecteront aussi le budget flamand : plus de 600 millions € en moins en 2029 ;
- Les mesures du gouvernement fédéral pourraient coûter 1,6 milliard € aux pouvoirs locaux bruxellois ;
- La FGTB a calculé que 125.000 personnes (dont 55.000 en Wallonie) pourront être exclues du chômage et donc retomber à charge des Centres publics d’action sociale (CPAS).
Voilà donc la politique du gouvernement fédéral en partie démasquée : elle met en place des soi-disant politiques de réduction de dépenses, mais qui, au final, se reportent sur les autres exécutifs.
6. Pilotage à l’aveugle et sortie de route violente
Ce ne sont pas des dépenses inutiles ou insensées des pouvoirs publics qui ont provoqué une augmentation de la dette publique et ont fait déraper les finances publiques ces dernières années et décennies, mais bien essentiellement des « chocs capitalistes ».
Or, les bombes à retardement qui menacent actuellement nos économies sont nombreuses. Certaines sont déjà en cours, tandis que d’autres pourraient survenir et exploser à tout moment: récession généralisée dans la zone euro ; augmentation brutale des taux d’intérêts ; aggravation de la crise écologique et climatique, avec de nouvelles potentielles catastrophes dramatiques comme les inondations de juillet 2021 ; nouvelle crise financière ; nouvelle pandémie ; aggravation des conflits armés ; aggravation des guerres commerciales, entre les États-Unis et l’Union européenne d’une part et entre les États-Unis et la Chine d’autre part…
La question n’est pas tant de savoir si un nouveau choc surviendra, mais quand il surviendra. Et ce choc aura pour conséquence que les pouvoirs publics devront à nouveau intervenir de manière forte et que les finances publiques se dégraderont de manière brutale.
La décision récente du gouvernement belge d’augmenter rapidement et fortement ses dépenses militaires, décision qui risque de coûter 17 milliards € aux finances publiques belges dans les prochaines années, constitue un exemple frappant.
7. On peut se tromper de chemin 14 fois, mais pas 15
Si le gouvernement parle d’effet retour, il y a un autre effet qu’il oublie totalement de mentionner, à savoir l’effet récessif de l’austérité. Ne pas en tenir compte constitue une énorme erreur en matière de politique économique et budgétaire.
En effet, cet effet est bien connu, et pour cause, l’austérité a déjà été testée de nombreuses fois, et les résultats sont connus : elle provoque une contraction de l’économie et, au final, aggrave les déficits et la dette. Couper dans les dépenses et les investissements publics alors que l’économie européenne ralentit, il n’y a pas pire choix d’un point de vue économique, et cela d’autant plus que tous les États européens s’apprêtent à le faire en même temps, ce qui ne fera qu’aggraver l’effet récessif de l’austérité.
Il faudrait au contraire soutenir l’activité économique (pas n’importe laquelle bien sûr) en menant des politiques de relance par l’investissement (ce qu’on appelle en économie des politiques contra-cycliques). Olivier Blanchard, ancien économiste en chef du FMI, ne disait pas autre chose en mars 2024 : « Les prévisions de croissance pour l’Europe viennent d’être révisées à la baisse. Il faut donc être prêt à soutenir encore l’économie, même si cela implique un déficit plus important ».
De nombreux responsables politiques ont admis ces dernières années que cet effet était bien réel et que les politiques d’austérité appliquées dans les années 2010 ont aggravé la situation. Citons Jean-Luc Crucke, lorsqu’il était ministre MR du Budget wallon en 2021 : « Le problème a été 2010 et 2011 parce que nous avons resserré la vis beaucoup trop vite et sommes rentrés dans des politiques d’austérité qui ont cassé la dynamique (…). Au nom de dogmes en matière budgétaire, cela a rendu la situation beaucoup plus difficile. »
On aurait pu penser que les dirigeants avaient retenu la leçon des années 2010. Il n’en est rien. On pourrait donc se tromper de chemin quatorze fois, mais pas quinze… ah bah si en fait.
À moins d’admettre que ce n’est pas une erreur, que ce n’est pas le bon sens économique ou l’intérêt général qui dirigent ce monde, et que l’objectif n’est en réalité pas d’assainir les finances publiques, mais bien d’accélérer le démantèlement des droits sociaux conquis, et de servir, logiquement dans un monde capitaliste, les intérêts du capital.
Conclusion : Le gouvernement Arizona a donc adopté une trajectoire totalement imprudente et irresponsable. À peine quelques semaines après l’accord de coalition, il se voit déjà dans l’obligation de revoir sa copie. Par ailleurs, il fonce tête baissée dans l’impasse de l’austérité, ignorant tous les avertissements et les signaux d’alarme. Enfin, il croit voir des « chemins retours » qui n’existent pas, comme si c’était un conducteur de Tesla sous kétamine. Les dérapages sont déjà incontrôlés et la sortie de route semble inévitable. Une telle conduite devrait avoir pour conséquence un retrait de permis immédiat, suivi d’une formation obligatoire en conduite budgétaire et économique.
[1] Il s’agit d’un effort de 18 milliards « de base », demandé par la Commission européenne, auquel il faut 5 milliards supplémentaires pour compenser les 5 milliards de « nouvelles politiques » que le gouvernement compte mettre en œuvre.
[2] Pour rappel, pour calculer le taux d’emploi, on divise l’ensemble de la population qui déclare avoir un emploi par la population en âge de travailler, soit les personnes de 20 à 64 ans. Ce chiffre est tiré d’une enquête réalisée tous les trois mois. Les étudiants de moins de 20 ans et les travailleurs de plus de 64 ans, de même que les flexi-jobs, ne comptent pas dans la statistique de taux d’emploi.
[3] Les montants sont indiqués à titre indicatifs mais se situent dans la fourchette basse des différentes études réalisées en la matière.