Mais pourquoi donc autant de débats sur la taxation des plus riches ? En quoi s’agit-il d’égalité et surtout de justice fiscale et sociale ? On vous dit tout dans cet article qui décortique la fausse progressivité de l’impôt belge.
Détenteur d’une fortune estimée à 160 milliards de dollars, l’homme d’affaires américain Warren Buffet, 94 ans, est reconnu pour son flair légendaire. Depuis des décennies, il incarne le capitalisme dans ce qu’il a de plus efficace : l’art d’accumuler du capital. Mais le milliardaire est aussi célèbre pour ses déclarations iconoclastes, qui tranchent avec le discours habituel du monde des affaires.
Sa phrase la plus connue, souvent citée à gauche parce qu’elle confirme sans détour l’analyse marxiste, reste celle-ci : « Oui, la lutte des classes existe, et c’est nous (les capitalistes) qui sommes en train de la gagner ». Mais c’est une autre de ses « sorties » qui nous intéresse ici. En 2011, W. Buffet reconnaît publiquement qu’il paie proportionnellement moins d’impôts que sa secrétaire et déclare alors vouloir être davantage taxé. Le milliardaire précise avoir versé 6,9 millions de dollars d’impôts sur un revenu imposable de 39,8 millions, soit un taux effectif de 17,3 %. Et d’ajouter : « Cela peut sembler beaucoup d’argent. C’est en fait le taux d’imposition le plus bas de l’ensemble des vingt personnes de notre bureau. Leurs taux d’imposition varient de 33 à 41 % ».
Cette situation d’injustice fiscale flagrante se limite-t-elle aux États-Unis ? Pas du tout. Elle est également valable pour la Belgique. Dans notre pays (et dans de nombreux autres), le principe de progressivité de l’impôt cesse de s’appliquer dès qu’on atteint les très hauts revenus. Cette injustice fiscale est rendue possible par l’existence de plusieurs dispositifs, parfaitement légaux, permettant aux plus hauts revenus de réduire considérablement leur imposition. Dans certains cas, ce taux d’imposition peut même descendre jusqu’à 5 %…
Quelle progressivité de l’impôt en Belgique ?
La Constitution belge garantit l’égalité devant l’impôt[1] et notre système fiscal a été conçu pour être progressif : plus on gagne, plus on contribue, en valeur absolue mais aussi et surtout en proportion de ses revenus.
Mais les données du livre collectif « Inégalités en Belgique, un paradoxe ? »[2], coordonné par André Decoster, Koen Decancq, Bram De Rock et Paula Gobbi – économistes belges reconnus –, montrent une autre réalité. Cet ouvrage, qui emploie une méthodologie inédite[3] en Belgique, apporte un double éclairage sur la distribution des revenus au sein de la population et sur la charge fiscale des différents groupes de revenus.
Tout d’abord, il confirme que les revenus les plus élevés se rémunèrent davantage via le capital. Cette observation est illustrée dans le graphique ci-dessous, qui montre la composition des revenus au sein de la population[4] : les revenus du travail ; les revenus des indépendants ; les revenus provenant des capitaux mobiliers (dividendes, intérêts) ; les revenus provenant des capitaux immobiliers (revenus locatifs réels et loyers fictifs) ; les bénéfices non distribués. Ce graphique montre clairement que la part des revenus du travail augmente jusqu’au quatrième quintile[5], puis diminue pour les 20 %, 10 %, 5 % et 1 % les plus riches. À partir du top 10 %, les revenus du travail représentent moins de la moitié des revenus, tandis que pour le top 1 %, ils représentent moins de 20 % (environ 80 % des revenus proviennent des capitaux mobiliers (dividendes, intérêts, …) et des bénéfices non distribués).
Graphique 1 : Répartition et composition du revenu des facteurs en 2022 (en euros par mois)
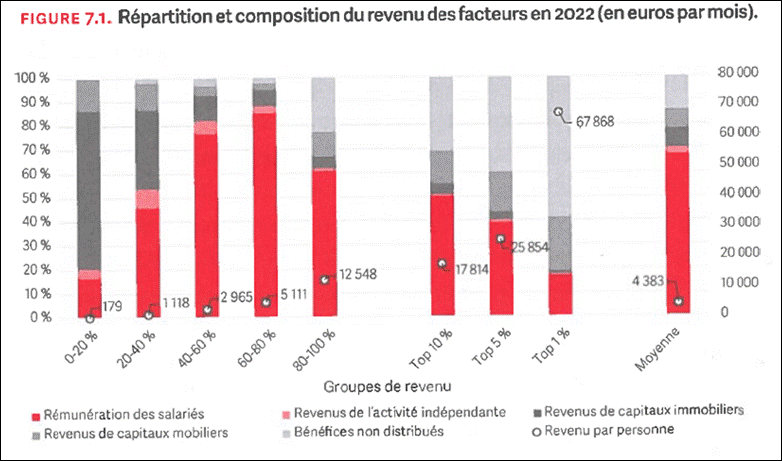
Les riches se rémunèrent plus via le capital que via le travail. On pouvait s’en douter. Mais ce n’est pas tout. Comme le montre le graphique suivant (graphique 2), également tiré du livre « Inégalités en Belgique, un paradoxe ? », l’impôt sur les revenus des personnes physiques est loin d’être progressif, particulièrement quand on distingue la fiscalité directe (sur le revenu principalement) et indirecte (e.a. la taxe sur la valeur ajoutée qui s’applique à tous de la même façon quel que soit le revenu).
Graphique 2 : Répartition de la charge fiscale totale entre les différents groupes de revenus en 2022
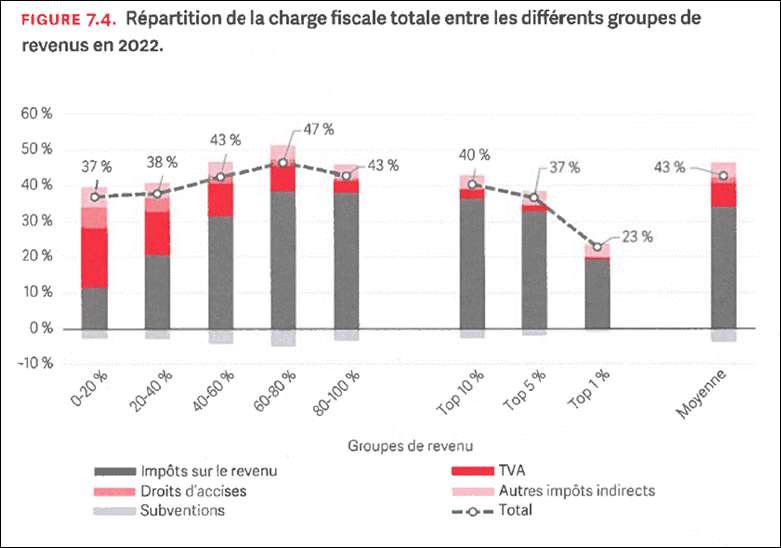
Le graphique 2 montre deux choses importantes :
- L’impôt sur le revenu des personnes physiques (partie grise) est dans un premier temps fortement progressif : il passe d’environ 12 % pour le premier quintile à environ 38 % pour le quatrième quintile. Mais cette progressivité est stoppée net pour le dernier quintile (les 20 % des revenus les plus élevés) avec un taux d’imposition global de 37 %. Et si on décompose ce dernier quintile, la situation s’intensifie : le top 5 % des revenus paie 34 % tandis que le top 1 % des revenus paie 19 % d’impôts des personnes physiques.
- Cette progressivité du système fiscal diminue très fortement lorsqu’on prend en compte la fiscalité indirecte (TVA, droits d’accise et réductions de cotisations sociales). La charge fiscale globale pour les plus faibles revenus est en effet triplée : elle passe de 12 % à 37 % ! Cela s’explique assez facilement : comme les ménages les plus pauvres dépensent presque tout ce qu’ils gagnent, ils paient plus de taxes indirectes comme la TVA en proportion de leur revenu.
La conclusion est sans appel. Quand on prend en compte la charge fiscale totale (fiscalité directe et indirecte), le système fiscal belge n’est pas progressif : tandis que les 20 % les plus pauvres paient 37 % de leur revenu sous forme d’impôts et de taxes, le top 20 % paie un tout petit peu plus (43 %), et le top 1 % des plus riches ne paie que 23 %.
Les principaux mécanismes d’évitement de l’impôt pour les très hauts revenus
Afin d’illustrer comment les très riches peuvent diminuer fortement les impôts qu’ils paient, nous allons comparer la situation fiscale d’un travailleur wallon gagnant le salaire brut moyen (3.900 €) avec celle d’un « très haut revenu » gagnant 340.000[6] euros bruts par an (28.300 euros bruts par mois) et montrer que la charge fiscale de ce dernier peut varier fortement selon les formes de revenus qu’il perçoit.
1. Un travailleur moyen avec un salaire de 3.900 € : 36 %
Selon les chiffres de l’IWEPS, un travailleur wallon à temps plein avec un revenu moyen gagne 3.794 € bruts par mois en 2022, ce qui correspond à 3.918 € bruts par mois en 2025. Sur une année, en prenant en compte la prime de fin d’année et le double pécule de vacances, cela correspond à un revenu brut annuel d’environ 54.540 €.
Sur ce montant, le travailleur devrait payer en 2025 des cotisations sociales à hauteur de 7.128 € (13,07 %), une cotisation spéciale de sécurité sociale de 534 € et un impôt personne physique (IPP) de 12.051 €[7]. Au total, la charge fiscale pour ce travailleur s’élève donc à 19.713 €, ce qui correspond à un taux d’imposition de 36,15 %.
2. Un dirigeant avec un salaire mensuel de 28.300 € : 53 %
Dans l’hypothèse où le dirigeant perçoit l’intégralité de ses revenus sous forme de salaire, sa charge fiscale s’élève à 180.877 euros décomposés de la manière suivante :
- 44.438,00 € de cotisations sociales personnelles (180.877x 0,1307) ;
- 731,27 € de cotisation spéciale de sécurité sociale ;
- 135.708,5 € d’IPP[8].
Son taux d’imposition dans ce cas de figure s’élève donc à 53,20 % (180.877 / 340.000).
3. Un dirigeant qui se paie en dividendes via une société de management : 35 %
Les revenus versés sous forme de dividendes, bénéficiant d’une moindre taxation, poussent les hauts revenus à opter pour un passage en société de leurs activités, leur permettant de réduire leurs revenus du travail et de les compléter par un versement de dividendes[9].
Sans rentrer trop dans les détails, le principe de base est le suivant : les bénéfices d’une société sont taxés à 25 %, auxquels s’ajoute un précompte mobilier de 30 % lors de leur distribution. Les revenus versés sous forme de dividendes sont donc en principe soumis à un taux de taxation de 47,5 %[10].
Signalons que ce taux est déjà plus avantageux que celui appliqué aux revenus du travail, taxés à 50 % pour les tranches supérieures à 49.840 € (pour les revenus perçus en 2025). Plusieurs exceptions et mécanises viennent encore alléger cette imposition :
- Les « starters » (nouvelles PME) bénéficient d’un taux réduit de 20 % durant leurs quatre premières années.
- Ce taux de 20 % peut ensuite être maintenu sur la première tranche de 100.000 euros de bénéfices, à condition que le dirigeant se verse un salaire annuel minimum de 45.000 euros (50.000 à partir de l’an prochain).
- Le régime VVPR-bis (« Verlaagde Voorheffing / Précompte Réduit bis ») permet de distribuer des dividendes à un taux réduit de 15 % si certaines conditions sont remplies (capital apporté en numéraire après le 1ᵉʳ juillet 2013, détenu au moins trois ans, société de taille limitée).
- Avec la réserve de liquidation, moyennant une taxe préalable de 10 %, les bénéfices mis en réserve peuvent ensuite être distribués après cinq ans avec une taxation de seulement 5 % (ou de 6,5 % après trois ans, modification prévue dans l’accord de coalition et devant entrer en vigueur dès l’an prochain)
N.B. : rappelons ici un chiffre plus qu’interpellant (et qui mériterait d’être actualisé) : sur les 66 milliards de dividendes belges en 2021, 52 milliards ont été taxés à 0 %[11]… En effet, il existe d’autres nombreux mécanismes à la limite de la légalité qui permettent aux très riches, aux grandes banques, aux grandes entreprises, de réduire radicalement la taxe payée sur les dividendes (opérations « CumCum », conventions bilatérales, RDT, …). La taxe de 30 % sur les dividendes (précompte mobilier) est donc en réalité beaucoup moindre pour ceux qui peuvent s’adjoindre les services de fiscalistes professionnels.
Reprenons maintenant notre exemple. Le dirigeant réduit ses revenus du travail à 50.000 €, pour se verser le reste (soit 290.000 €) sous forme de dividendes via une société de management. Sur les 50.000 euros de salaires, il va payer 17.294 € d’impôts[12]. Les 290.000 euros de dividendes pourraient être taxés de la façon suivante :
- Un impôt sur les bénéfices de la société (Isoc) de 67.500 €[13]
- Et un précompte mobilier de 33.375 €[14].
Au total (impôts sur son salaire et impôts sur les dividendes perçus), il paiera donc un impôt de 118.169 € soit un taux global de 34,76 %. Ce niveau d’imposition constitue donc un niveau inférieur à celui du travailleur moyen wallon, ayant pourtant un revenu 6 fois inférieur. Mais il y a encore de « meilleures options » pour réduire son taux d’imposition.
4. Un dirigeant qui perçoit une plus-value sur action : 13 % ou 5 %
Nous avons déjà développé une analyse relativement approfondie de la taxe sur la plus-value (ici, ici et encore ici) dans Matribune.be qui devrait rentrer en vigueur dans les mois qui viennent. Rappelons-en l’essentiel et le principe de base, redonnons deux exemples marquants, avant de revenir à notre cas théorique.
L’essentiel : Cette nouvelle taxe est beaucoup trop faible, en particulier si on la compare avec la France (30 %) ; elle est mal pensée (de nombreuses incertitudes demeurent) ; elle sera sans doute remise en cause (elle l’est déjà) ; elle va rapporter très peu (et sans doute encore moins prévu) ; elle ne participe pas à réduire les inégalités (les grandes fortunes vont pouvoir y échapper) et elle est dans tous les cas totalement insuffisante par rapport aux défis à relever, qu’ils soient budgétaires, économiques, sociaux ou écologiques.
Le principe de base : Si vous êtes un petit ou moyen investisseur, vous paierez une taxe de 10 % sur tout ce qui dépasse 10.000 € de plus-value. Si vous êtes un grand actionnaire, c’est-à-dire si vous possédez au moins 20 % des actions de la société sur laquelle vous réalisez une plus-value, alors le premier million d’euros est totalement exonéré et tout ce qui dépasse sera taxé de manière progressive, allant d’un taux de 1,25 % à 10 %.
Deux exemples avec l’hypothèse que la nouvelle taxe entre en vigueur :
Thibaut, 50 ans est un « petit investisseur » qui dispose d’une épargne de 300.000 €. Il fait donc partie de la classe moyenne supérieure. Afin de faire fructifier son épargne, il décide d’acheter des actions de la marque Apple. Une action Apple vaut à ce moment 165 €. Il investit pour 100.000 €, et devient donc propriétaire de 606 actions Apple. L’année suivante, il décide de revendre ces actions. Cette même action Apple vaut alors 255 euros. Il reçoit 154.530 €. Il réalise donc un gain, une plus-value de 54.530 €. Les 10.000 premiers euros de plus-value sont exonérés tandis qu’il paie une taxe de 10 % sur les 44.530 € restant, soit 4.530 €. Cela fait donc une taxe effective de 8 % (4.530 / 54.530).
Bernard Arnoudt est un grand investisseur : il détient 30 % dans une grande société cotée en Bourse et décide de vendre toutes ses parts. Il réalise une plus-value de 12.000.000 €. Le premier million d’euros de cette plus-value sera exonéré. Sur 1.500.000 €, il paiera 1,25 % de taxe, soit 18.750 €. Sur 2.500.000 €, il paiera 2,5 %, soit 62.500 €. Sur 5.000.000, il paiera 5 %, soit 250.000 €. Et sur les 2 derniers millions, il paiera 10 %, soit 200.000 €. En tout, Bernard paiera une taxe de 531.250 € sur sa plus-value de 12 millions, soit un taux effectif global de 4,4 %.
Adaptons maintenant ces deux exemples à notre dirigeant d’entreprise qui gagne 340.000 euros au total, avec un salaire de 50.000 euros et une plus-value sur actions de 290.000 euros :
S’il est un petit investisseur, il paiera 17.294 € d’impôts sur son salaire + 28.000 euros de taxe sur la plus-value (10 % sur 280.000 car les 10.000 premiers euros sont exonérés). Il paiera donc au total 45.294 euros, soit un taux d’imposition de 13,32 %.
S’il est un grand investisseur, et que par exemple la plus-value de 290.000 € provient de la vente de son entreprise familiale, qu’il détient à plus de 20 %, l’exonération fiscale sur la plus-value s’élève à 1 million €. Son impôt total se limite donc à celui prélevé sur les 50.000 € de revenus professionnels, soit 17.294 €. Sur un revenu total de 340.000 €, le taux d’imposition se situe alors à 5,09 %.
Graphique 3 : Taux d’imposition pour un « très haut revenu » gagnant 340.000€/an et pour un travailleur au salaire moyen (synthèse)
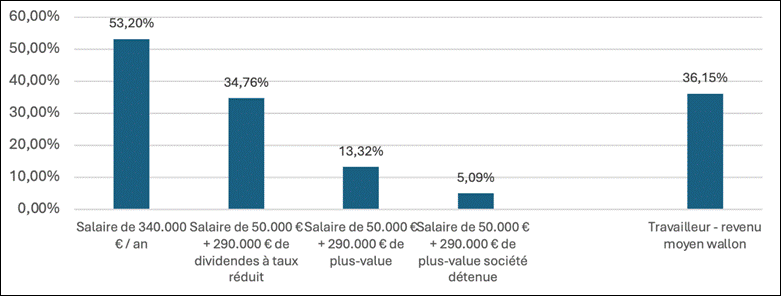
Conclusion
Au terme de cette analyse, un constat s’impose : le système fiscal belge est très loin d’être progressif, et devient même régressif pour les plus hauts revenus. Plus les revenus augmentent, plus la contribution réelle diminue. Alors que les travailleurs voient près de 40 à 50 % de leur salaire partir en impôts et cotisations pour financer les services publics, les plus riches bénéficient de multiples dispositifs leur permettant, en toute légalité, de ramener leur taux effectif à des niveaux dérisoires. Ce renversement du principe d’égalité devant l’impôt constitue une profonde injustice sociale et contribue au définancement des services publics.
Les négociations fiscales actuellement en cours au niveau fédéral ne laissent entrevoir aucune réforme sérieuse capable de remédier à ce problème. Les débats se concentrent sur des ajustements techniques à la marge, sans jamais remettre en cause les privilèges fiscaux les plus coûteux et les plus inéquitables.
Pourtant, réformer la fiscalité belge pour qu’elle redevienne réellement progressive constitue une exigence démocratique de base, et cela passera nécessairement par une remise en cause des mécanismes qui permettent à certains d’échapper à l’effort collectif.
[1] Articles 10, 11 et 172 de la Constitution belge.
[2] Decoster A., Decancq K., De Rock B. & Gobbi P., Inégalités en Belgique, un paradoxe ?, Louvain: Racine, 2024.
[3] Cat ouvrage combine des données d’enquête sur le niveau de vie, le patrimoine, les dépenses des ménages, avec les données administratives reprises dans les déclarations fiscales et les comptes nationaux. Les comptes nationaux permettent notamment de répartir, parmi les actionnaires au sein de la population, les bénéfices non distribués dans les entreprises.
[4] Avant prestations sociales, cotisations sociales et impôts.
[5] Notons également la part importante de revenus des capitaux immobiliers chez les 20 % les plus pauvres. Cela s’explique par le fait qu’il y a beaucoup de retraités dans le quintile inférieur. Ne percevant plus de revenus du travail, ils sont repris dans cette catégorie (car les prestations sociales, donc les pensions, ne sont pas prises en compte dans la définition de revenu utilisée dans le graphique). Parmi les retraités, beaucoup sont propriétaires de leur logement.
[6] Nous choisissons ce montant de 340.000 euros brut par an car, depuis le 1er juillet 2025, le gouvernement a décidé que les employeurs ne paieraient plus de cotisations patronales au-delà de ce montant. Ce cadeau fait aux très hauts salaires touchera environ 1.700 personnes (un tiers de sportifs – principalement des footballeurs – et, pour le reste, surtout des cadres du privé) et coûtera 75 millions d’euros à la sécurité sociale dès 2026.
[7] Sur base des tranches d’imposition 2025 pour un revenu imposable net de 41.481 : 54.540 – 7.128 – 5.930 de frais professionnels forfaitaires.
[8] Calculé sur un revenu imposable net de 289.632 €, soit 340.000 – 44.438,00 – 5.930 de frais professionnels forfaitaires.
[9] Ce n’est pas pour rien que le passage en société de management a explosé ces dernières années : leur nombre a plus que doublé en cinq ans, passant ainsi de 20.000 à 55.000 structures.
[10] Exemple : un bénéfice de 100 € est taxé à 25 %. Il reste 75 €. Si ces 75 € sont versés en dividendes, une taxe (précompte mobilier) de 30 % sera prélevée dessus, ce qui revient à 22,5 €. Au total, un impôt de 47,5 sera donc prélevé sur ce montant de 100, ce qui fait 47,5 %.
[11] Cette information a été donnée par Vincent Van Peteghem (alors ministre fédéral des Finances) en réponse à une question parlementaire à la Chambre des représentants le 16 février 2022.
[12] Répartis comme suit : 6.535 € de cotisations sociales personnelles (13,07 %), 10.275 € d’IPP (calculé sur un revenu imposable net de 37.535 € (soit 50.000 – 6.535 – 5.930 de frais professionnels) et 484,14 € de cotisation spéciale de sécurité sociale.
[13] 20 % sur la première tranche de 100.000 et 25 % sur la tranche des 190.000 restants.
[14] (290.000 – 67.500) x 0,15.


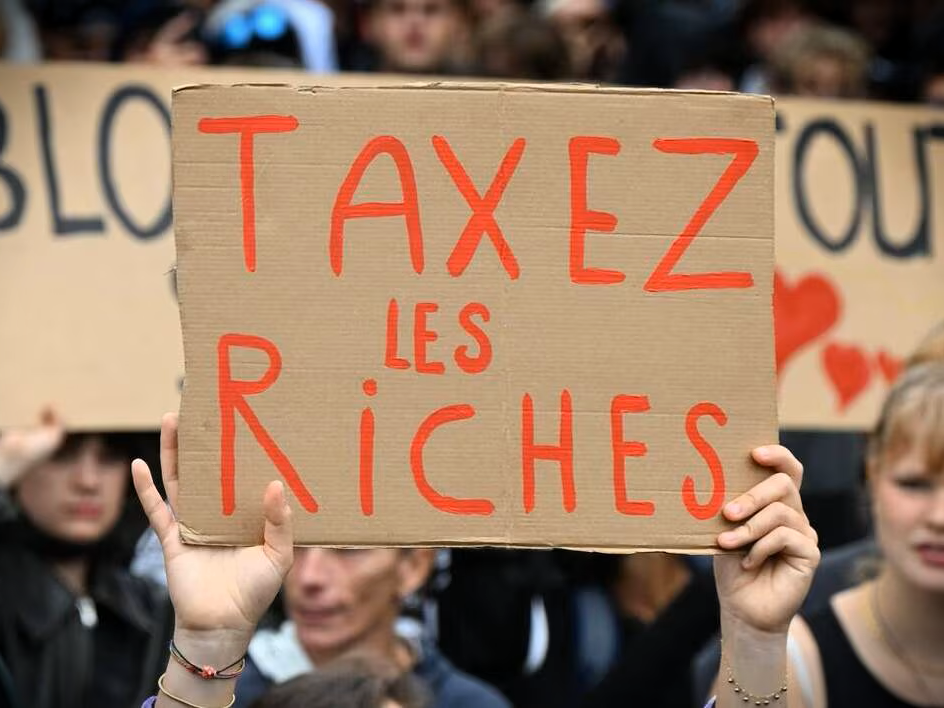







Un commentaire sur