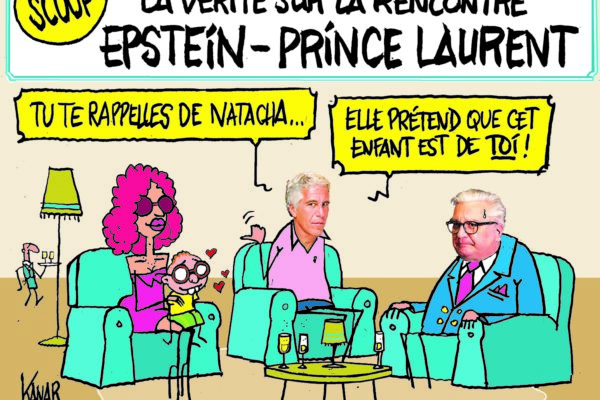Historiques, les quatre jours d’action que vient de connaître le pays en cette fin novembre. La grève reste bien un moyen d’action démocratique sans égal. Et tant pis pour tous ceux qu’elle débecte.
« Idiots, ceux qui désobéissent ; hors-la-loi, ceux qui croisent les bras pour ne pas se rendre ; irresponsables, ceux qui protestent quand la vie est insupportable : telle est notre réputation depuis l’aube des temps ou plutôt depuis le moment où nous avons admis que les uns donneraient des ordres et que les autres s’y soumettraient gentiment. Aucun rebelle n’échappe au blâme, aucun esclave non plus ; celui qui subit n’a qu’un droit d’obéissance, une seule carte dans son jeu. »
À peu près à l’époque de la grande secousse du covid, un journaliste de Radio-France International, Léonard Vincent, résumait d’une plume rebelle les appréciations des « autorités », publiques ou privées, à propos de ceux qui osaient se mettre en grève[1].
Ce qu’elles disaient depuis tous temps. Et encore aujourd’hui : le gréviste est un perturbateur, un emmerdeur à remettre dans le droit chemin. Ou un inconscient qui enclenche des mécanismes plus nuisibles encore que ce contre quoi il proteste.
Grévophobie
Ces grèves de fin novembre n’auront dès lors pas échappé à l’opprobre des milieux gouvernementaux ou patronaux. Il suffisait de lire les journaux, d’allumer radios ou TV pour le constater : haro sur les grévistes, les organisations syndicales qui avaient lancé le mot d’ordre, les associations ou groupes qui s’étaient joints au concert.
Il en est toujours ainsi… En Belgique, un des pics de cette grévophobie a d’ailleurs peut-être été atteint non pas cette fois-ci, mais le coup d’avant, après les actions du 14 octobre dernier. À la tribune de la Chambre « des Représentants », le chef de groupe N-VA (le parti du Premier ministre) éructe. La majorité a « bien entendu le message. Celui envoyé par 5 millions de personnes. Des enseignants, des ouvriers, des indépendants… Tous ces gens qui étaient au travail et qui nous disent : de grâce, continuez, prenez des mesures difficiles, c’est le moment, faites en sorte que nos enfants puissent s’épanouir grâce aux politiques que vous osez mettre en œuvre ».
Un sommet de cynisme qui montre qu’aux yeux de nombreux élus, les protestations des citoyens, même respectueuses des normes démocratiques comme ce fut le cas ce jour-là, ne sont qu’urinage dans un violon. Un sommet de cynisme qui rappelle aussi que le terreau de la N-VA est bien une idéologie qui a des problèmes avec la démocratie quand celle-ci s’affiche en toute démocratie.
Au pied des pyramides
La grève est un des plus anciens moyens que le peuple ait utilisé pour faire valoir ses droits, protester contre les injustices, changer l’ordre des choses, à toute petite échelle ou sur un plan très large.
Les historiens s’accordent : la première grève dont la trace nous est parvenue date de l’Egypte ancienne, du temps du Pharaon (empereur) Ramsès III (1150 ans avant notre ère). Le scénario est banal. Sur un chantier de construction d’une pyramide comme les maîtres de l’Egypte les affectionnaient, des ouvriers (des ouvriers, et pas des esclaves, parce que les architectes avaient besoin d’une main d’œuvre spécialisée pour que leurs ouvrages défient le temps – on n’a rien inventé), des ouvriers donc ne recevaient plus leur salaire depuis plusieurs semaines. Ils cessèrent le travail jusqu’au retour de leur paye, arriérés compris. Ce qui n’empêchera pas, on n’a rien inventé là non plus, des retards de paiement ultérieurs qui vont enclencher d’autres mouvements.
La grève remonte encore plus loin dans le temps : le premier best-seller de la littérature, L’Iliade du poète grec Homère, commence pile par un arrêt de production. Le récit retrace la guerre entre les Grecs et les Troyens. Au début, le plus vaillant des guerriers grecs, Achille, cesse de se battre parce que le chef de son armée ne lui a pas donné l’esclave promise comme salaire. Les Grecs ramasseront alors quelques pâtées au combat, et leur chef devra céder aux exigences d’Achille pour qu’il reprenne son travail de tueur de Troyens. On n’a, vraiment, rien inventé…
La grève, c’est pas le Club Med’
La grève n’a rien perdu de son efficacité, ce qui explique qu’elle soit systématiquement délégitimée par ceux qu’elle vise. Elle est bien sûr purement et simplement interdite dans les régimes autoritaires. Cela n’empêche pas les travailleurs d’y recourir parfois avec un courage décuplé : même entre 1940 et 1944, on a connu des grèves dans des usines et mines belges…
La grève est un outil dans les mains des travailleurs. Nos relations sociales restent fondées sur la définition d’un rapport de forces qui se jauge dans la concertation entre ce qu’on appelle chez nous les interlocuteurs sociaux. Ceux-ci disposent chacun de moyens de pression sur l’autre. La puissance de ces moyens, réelle ou ressentie, oriente les solutions. Le patron sait que le travailleur peut lui causer un tort économique en arrêtant le travail ; il doit estimer à partir de quel moment ce tort est plus important pour lui que le fait de satisfaire tout ou partie des revendications des travailleurs. De même, les grévistes doivent arbitrer entre ce que leur coûte leur action et ce qu’elle pourrait leur rapporter. Remarquons que bien des observateurs oublient fréquemment que la grève coûte (cher) au travailleur, et qu’elle n’est pas un agréable congé autour de quelques barbecues.
Mais une distorsion existe quant au pouvoir de décision, qui affaiblit d’entrée de jeu la position des travailleurs. La décision patronale de laisser la grève s’enclencher et se poursuivre le cas échéant est le choix d’un seul homme, le patron, ou d’une oligarchie (comité de direction, conseil d’administration, actionnaires). Cela pousse à des positions dures. D’autant plus dures lorsque les contextes politique et sociétal sont répressifs : et nous sommes entrés dans une phase de ce type depuis une quarantaine d’années.
Par contre, la décision des travailleurs d’entrer en grève et, ensuite, de poursuivre le mouvement est une décision collective, démocratique. La radicalité des travailleurs n’est en fin de compte que la radicalité des maillons les moins durs de la chaîne. Quiconque a un jour mis les pieds dans une assemblée syndicale en période de grève sait que, quels que soient sa popularité, son charisme, sa compréhension, sa force idéologique et sa vision à long terme, aucun leader syndical ne peut longtemps imposer à « sa base » de poursuivre un mouvement auquel elle a cessé de croire. Pour le dire plus crûment et contrairement à ce que colportent certains médias, la grève – je ne parle pas des coups de sang sociaux – n’est jamais l’affaire de quelques exaltés.
La sentir passer
La grève n’a pas de sens si elle est indolore. Des patrons rêvent de grèves organisées dans un entrepôt ad hoc où se regrouperaient les candidats protestataires. Anecdote : j’ai connu une rédaction de magazine qui structura son action autour d’un arrêt de travail un jour entre midi et quatorze heures. Ce moment fut consacré au chant de quelques protest songs bien militants soutenu par un journaliste ma foi talentueux… guitariste. Le tout dans un bâtiment où n’erraient, en cette heure de déjeuner, que quelques travailleurs d’autres titres du même groupe de médias venus voir ce qui se passait. Au moins les grévistes prirent-ils le soin de rédiger un communiqué de presse qui, confraternité aidant, fut repris de-ci de-là.
La grève doit menacer de causer un tort parce que nous sommes dans un système pacifique, mais de rapport de force, et qu’il n’y a pas d’autre moyen pacifique pour un travailleur de faire valoir ses droits que celui de réduire le profit du patron et de ceux qui détiennent le capital. A priori, c’est d’ailleurs d’autant plus facile que le monde économique a lui-même organisé sa propre fragilité. Les politiques de « flux tendus » ou de « zéro stock » sont finalement un appel au blocage. Il fallait autrefois deux ou trois jours pour « couvrir » proprement un haut fourneau et le mettre en pause de manière réversible. Aujourd’hui, en une ou deux heures, les manutentionnaires au turbin dans les grandes sociétés de fret aérien peuvent faire s’effondrer mondialement leur réseau…
Dénigrée à l’infini
Cette fragilité du système de production est peut-être un des éléments d’explication des vociférations de plus en plus hargneuses des « anti-grèves » qui font des mouvements sociaux non l’expression ferme d’un point de vue, mais une agression contre la démocratie. Les médias jouent un rôle désastreux dans ce pivotement de la perception de la grève dans l’opinion. Recensant différents articles de presse, un collectif d’auteurs, en 2010, constatait : « Parce qu’ils ne la feraient pas correctement, parce que le moment choisi ne serait pas le bon ou parce que les motifs ne seraient pas légitimes, les travailleurs auraient le droit de faire grève mais ne pourraient jamais l’exercer. (…) En outre la grève est de plus en plus souvent traitée comme une calamité dans les bulletins de radio guidage. Elle est annoncée pour prévenir divers usagers qu’elle amènera des ″perturbations probables″, comme s’il s’agissait d’annoncer les conséquences d’un orage violent, en lieu et place d’une information sociale sur le contenu du mouvement de grève. (…) Le discours médiatique dominant a donc une portée véritablement large et constitue un élément central du travail idéologique visant à dénigrer la grève. »[2]
La grève devient un outil dénigré, parfois même par des citoyens qui, le cas échéant, auront profité sans vergogne du résultat des actions enclenchées par d’autres.
La grève qui se déclenche est-elle un échec, comme le prétendent certains ? À mon sens, non. Elle est, certes, la preuve que la concertation n’a pas eu de résultat et qu’il faut aller plus loin dans la quête d’une solution. Elle ressemble en ceci plutôt à une seconde session d’examen qu’à un échec. Il s’agit toujours, au terme du processus, de sortir du conflit plutôt que d’écraser un protagoniste comme dans une sorte de guerre sociale. La grève est un palier de plus dans la contestation, mais elle reste encadrée par les mécanismes de la démocratie. Elle est en quelque sorte un supplément d’âme lorsqu’une lutte sociale se durcit, galvanisant ceux qui y participent et leur donnant un moyen plus radical d’interpeller l’opinion.
Au-delà de la grève, c’est la révolte ou le désenchantement. La première, historiquement, aboutit souvent, à court terme du moins, à des désastres humains. Le second aboutit à l’esclavage social consenti, à la banalisation de l’injustice, à l’abolition de la pensée. Et c’est plutôt ça qui nous menace pour le second quart de ce siècle si nous cessons de recourir, désabusés, à une forme d’action qui est au fond, pour reprendre les mots du journaliste Léonard Vincent que je citais en début de chronique, « un geste de haute civilisation ».
[1] Éloge de la grève, Éditions du Seuil, Paris, 2020.
[2] A. Decoene, A. Dufresne, J. Faniel, C. Gobin, « Le droit de grève au 21ème siècle : d’un droit consacré à un droit décrié ? » in R. Cusso et al., Le conflit social éludé, Academia Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2008.